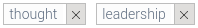Your new post is loading...
 Your new post is loading...
Comment utiliser au mieux la Revue de presse Théâtre
Quelques astuces pour tirer profit de tous les services de la Revue de presse théâtre Les publications les plus récentes se trouvent sur la première page, mais en pages suivantes vous retrouverez d’autres posts qui correspondent aussi à l’actualité artistique ou à vos centres d’intérêt. (Navigation vers les pages suivantes au bas de la page) Les auteurs des articles et les publications avec la date de parution sont systématiquement indiqués. Les articles sont le plus souvent repris intégralement. Chaque « post » est un lien vers le site d’où il est extrait. D’où la possibilité de cliquer sur le titre ou la photo pour lire l’article entier dans son site d’origine . Vous retrouverez la présentation originale de l'article : les titres, les photographies et les vidéos voulues par le site du journal ou l’auteur du blog d’où l’article est cité. Pour suivre régulièrement l’activité de la Revue de presse : vous pouvez vous abonner (bouton bleu turquoise INSCRIPTION GRATUITE ) et, en inscrivant votre adresse e-mail ou votre profil Facebook, recevoir des nouvelles par mail des publications les plus récentes de la Revue de presse Vous pouvez aussi, si vous êtes inscrits sur Facebook, aller sur la page de la revue de presse théâtre à cette adresse : https://www.facebook.com/revuedepressetheatre et vous abonner à cette page pour être tenu à jour des nouvelles publications. sur X (anciennement Twitter), il y a un compte "Revue de presse théâtre" qui propose un lien avec tous ces posts, plus d'autres articles, brèves et nouvelles glanés sur ce réseau social : @PresseTheatre https://twitter.com/PresseTheatre Vous pouvez faire une recherche par mot sur 12 ans de publications de presse et de blogs théâtre, soit en utilisant la liste affichée ci-dessus des mots-clés les plus récurrents , soit en cliquant sur le signe en forme d’étiquette à droite de la barre d’outils - qui est le moteur de recherche de ce blog ("Search in topic") . Cliquer sur le dessin de l'étiquette et ensuite taper un mot lié à votre recherche. Exemples : « intermittents » (plus d’une centaine d’articles de presse comportant ce mot) « Olivier Py» ( plus de cinquante articles ), Jean-Pierre Thibaudat (plus de cent articles), Comédie-Française (plus de cent articles), Nicolas Bouchaud (plus de cinquante articles), etc. Nous ne lisons pas les "Suggestions" (qui sont le plus souvent jusqu'à présent des invitations, des communiqués de presse ou des blogs auto-promotionnels), donc inutile d'en envoyer, merci ! Bonne navigation sur la Revue de presse théâtre ! Au fait, et ce tableau en trompe-l'oeil qui illustre le blog ? Il s'intitule Escapando de la critica, il date de 1874 et c'est l'oeuvre du peintre catalan Pere Borrel del Caso
Par Gilles Renault dans Libération - 12 mai 2024 Seule sur scène, dans un spectacle qui cartonne depuis deux ans, la comédienne retrace une histoire personnelle d’émancipation, à coups de mots et de poings. Aurait-on beau préconiser un équilibre absolu des relations homme-femme, que certaines questions achopperaient encore sur la bienséance. Comme celle consistant à demander son poids à une personne du sexe jadis présumé faible. Pourtant, dans le cas de Julie Duval, le sujet froisse d’autant moins que l’interlocuteur valse illico dans les cordes : «Catégorie moins de 54 kilos.» Option boxe thaïe, en l’occurrence. «Tout sauf un sport de riches, mais avec des valeurs nobles, beaucoup de discipline, de rigueur, et un excellent remède pour évacuer la colère qu’on peut avoir en soi.» En témoignent une dizaine d’années de pratique, acharnée – «Jusqu’à six jours sur sept, et deux entraînements quotidiens» –, complétée par de la course à pied et du renforcement musculaire, que valident trois combats officiels au compteur : deux victoires, une défaite. Un palmarès modeste qui, avouons-le, ne suffirait pas à éveiller la curiosité médiatique. Sinon que ladite boxe accapare le spectacle de Julie Duval, l’Odeur de la guerre. Une victoire par KO qui, pour le coup, met tout le monde OK : du off d’Avignon à la salle parisienne de la Scala, chaque séance, à guichets fermés, récolte son lot de vivats. Et la critique suit, jusqu’à l’aréopage radiophonique du Masque et la Plume, arbitre volontiers vipérin des élégances germanopratines, qui, sur France Inter, a même baissé la garde. Une heure quinze durant, seule sur scène, Julie Duval se raconte, volubile et cash – doutes, regimbements, blessures et rédemption compris –, englobant dans la performance une dizaine de personnages qui, famille, proches ou enseignants, ont jalonné la sortie de la chrysalide. C’est au premier étage d’une maison, dans une rue calme de Montreuil, propriété de son compagnon, le cinéaste Léopold Legrand (le Sixième Enfant), que la trentenaire rembobine le cheminement. Une certaine quiétude émane du salon au parquet de bois foncé, tout juste démentie par l’intitulé des ouvrages dispersés sous le verre de la table basse, de l’antédiluvien Art de la guerre de Sun Tzu aux bourlingues du Jack London photographe, via les cartes de la Féminité sacrée, «oracle thérapeutique de la femme sorcière» dont l’argumentaire garantit qu’il «libère de tous les carcans afin de vivre pleinement sa destinée et ses rêves». Un vade-mecum qui conduit donc à cette hôtesse gracile qui, jeans noir, pull gris et jambes repliées dans le fauteuil, transite sans barguigner de la scène au séjour ; une différence notable résidant néanmoins dans le ton, la faconde de la comédienne se substituant, hors plateau, à la parole posée, limite studieuse de quelqu’un qu’on devine peu rompu à la joute médiatique. Pourtant, comme on le disait en préambule, l’Odeur de la guerre a bien la baraka, après déjà plus d’une centaine de rounds et la perspective de nombreux mois fructueux encore à venir. . Un marathon qui nécessite des plages de récupération, comme ces deux semaines de vacances, en Martinique, puis en Normandie, qui ramènent la brunette au teint hâlé, reposée, à défaut de rassérénée. «De même qu’il faut enchaîner des centaines de gauche droite avant d’en placer une correctement, presque un an de travail a été nécessaire pour parvenir à cette version , moins vindicative et plus joyeuse qu’à l’origine. Et si je pense avoir évacué certaines fêlures du passé, je n’en reste pas moins une grande anxieuse qui, malgré les encouragements, peine à savourer le moment présent. Peut-être en souvenir de ce combat où, ayant convié plein de gens autour du ring, tu te retrouves au sol et dois te relever.» «A ses débuts, Julie était très organique et sauvage. Au point qu’elle a pu faire presque peur à des profs d’art dramatique qui, à tort, ont cherché à lui mettre un carcan», se souvient Juliette Bayi, qui la connaît depuis une douzaine d’années et a vécu avec elle en colocation. «Mais je pense qu’elle a appris à soigner ses blessures et ses démons, jusqu’à être en mesure d’accepter la notion de vulnérabilité. De même qu’elle commence à se protéger un peu, face aux sollicitations de plus en plus nombreuses, et, succès aidant, à rêver de faire pleinement ce métier», complète celle qui, avec Elodie Menant, cosigne la mise en scène. Quiconque a déjà humé l’Odeur de la guerre apprendra fatalement moins de choses, en lisant ces lignes, que les profanes, tant l’on suit un fil autobiographique que l’autrice évalue elle-même à «100 %». De fait, Jeanne (qu’elle incarne) est Julie. Qui égratigne un cadre familial frustrant, entre un père taiseux et brutal, et une mère dépassée qui escamote les sujets sensibles en préférant parler du chien. Détaille l’éveil cru à la féminité, des premières règles à une sortie alcoolisée en boîte où un connard fait fi du mot «consentement». Galèje une scolarité foireuse, bordurée par une bonne copine certifiée cagole et une sœur cadette, aujourd’hui aide-soignante. Célèbre l’arrivée à Paris, rimant avec épiphanie, quand la Varoise, qui vivote avec un CAP esthétique et un BEP hôtellerie-restauration, découvre le poids des mots, de Hugo, de Molière, de Racine, avant François Cheng, Annie Ernaux, ou bell hooks, en s’inscrivant au cours Florent – avec la bénédiction de son parrain, qui la sponsorise –, et le choc des jabs et high kicks, à la Team Alamos, un club parisien symbolisé sur scène par un banc et un sac de frappe. Autant de contextes dont les authentiques acteurs ont poussé, un soir ou l’autre, la porte du théâtre pour découvrir la performance de Julie Duval. «Mes parents, purs transfuges de classe, aujourd’hui retraités, mais autrefois commercial et employée à Pôle Emploi, se souciaient plus des conventions que des émotions. Si bien qu’à la maison, on ne parlait pas. D’où une adolescence compliquée, marquée par un renvoi du collège et ce goût de la bagarre donnant à une fille, qui voulait être tout sauf elle-même, l’illusion d’exister. Mon père a pleuré, en comprenant, à travers le spectacle, ce que fut notre vie à l’époque. Ma mère, d’un tempérament pudique, a préféré ne pas se reconnaître. Mon coach de boxe, qui avait mis un costume pour l’occasion, lui, s’y est retrouvé.» Préférant «écouter les poètes, plutôt que les candidats politiques», qui jusqu’à présent ne l’ont jamais incitée qu’à «voter contre», Julie Duval n’en est pas moins, dans son style, une activiste, qui a participé à des collages nocturnes pour dénoncer la précarité et les violences faites aux femmes. De même qu’elle enseigne la boxe au Palais de la femme, emblématique centre d’hébergement parisien, et va régulièrement raconter son parcours dans des bahuts de banlieue. Où elle s’inquiète de trouver les jeunes «bien sages, sans envies ni repères, comme épuisés, sinon résignés», tandis qu’elle les enjoint à prendre en main leur destinée. A ses heures perdues (sic), la jeune femme dessine aussi, «d’un trait, qui ne lâche jamais la feuille». Ni, elle, l’affaire. Gilles Renault / Libération 1989 Naissance à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes). 2014 Découverte de la boxe thaïe. 2021 Création de l’Odeur de la guerre au Théâtre La Flèche (Paris). 2022 et 2023 Off du Festival d’Avignon. 2024 L’Odeur de la guerre à la Scala (Paris) et à Avignon.
Par Armelle Héliot dans son blog - 9 mai 2024 Pour la troupe d’acrobates de la compagnie Akoreacro, Pierre Guillois a réglé un formidable spectacle qui s’appuie sur l’excellence des artistes. Ayons une pensée pour Titouan Maire, brillantissime élève du CNAC, mort après une chute, lors d’une répétition. Que dire ? Ils ont trouvé le metteur en scène idéal qui donne à leurs époustouflantes prouesses ce « petit plus » qui fait de Dans ton cœur, spectacle déjà bien rodé, né il y a plusieurs années, un supplément d’esprit, d’humour, et de fluidité narrative. Au Rond-Point, dans la grande salle, ce soir-là, la jeunesse est en présence forte ! Et quel bonheur sentir comment ils retiennent leur souffle, comment ils font crépiter des applaudissements qui disent à la fois bravo et merci avant l’explosion finale. C’est en 2018 qu’a été créé cette merveilleuse pièce liant une compagnie exceptionnelle d’art circassien et d’acrobatie, en particulier, à un homme de théâtre d’une intelligence et d’une sensibilité bouleversantes. Comment a-t-on fait pour qu’il faille attendre le Rond-Point pour les applaudir ?! Sous la haute charpente de ce qui fut le théâtre de la compagnie Renaud-Barrault à la gare d’Orsay (bien avant le Musée !), les artistes d’Akoreacro sont chez eux : au cirque ! Sur le très large plateau, des éléments scéniques translucides ou opaques, selon les lumières de Manu Jarousse, assurant la régie générale au millième de seconde, glissent, composant, défaisant, recomposant, un univers urbain d’immeubles silencieux. Et, perchée à cour, une plate-forme qui ne cache pas qu’elle est un tremplin pour envols et autres hallucinants numéros de trapèze. Un décor circassien de Jani Nuutinen et Circo Aero, avec la touche onirique d’Alexandre de Dardel… Ici, il faudrait citer chacune et chacun, des accessoires aux costumes, car tout est réglé d’une manière aussi plaisante et harmonieuse, qu’efficace. Du grand art, à tous les postes. Pas de secret. Une rigueur qui se farde d’humour, jusqu’aux clowneries, mais quelle maîtrise ! On ne vous racontera pas tout, mais saluons le couple des amoureux-voltigeurs, qui s’envoient en l’air avec les bébés (de chiffon, rassurez-vous), l’hallucinante Marion Rouillard, un Tanagra tout en jolis muscles et présence d’esprit, une plume qui doit peser quarante kilos toute mouillée, et sans doute moins… Ravissante, forte d’une autorité naturelle, harmonieuse, espiègle, irrésistible. Face à elle, Antonio Segura Lizan, un Puck des pistes et des airs, merveilleux comédien, en plus ! Saluons les acrobates, porteurs, jongleur ou as du trapèze Washington, des mecs, des vrais, comme les dessine le metteur en scène, saluons les musiciens, indissociables du projet de la compagnie, intégrés au jeu, contrebasse, batterie, percussions, guitare, saxophone, claviers, flûte. L’orchestration spectaculaire est aussi sublime que jubilatoire. On retient son souffle. Ils sont dans les airs comme portés par une grâce, une poésie qui illuminent tout. C’est magnifique. Théâtre du Rond-Point, du lundi au vendredi, sauf mardi, à 20h30, samedi 19h30, dimanche 15h00. Jusqu’au 26 mai. Durée : 1h15. Relâches, jeudi 9 mai, dimanche 19, lundi 20 mai. Tél :01 44 95 98 21. theatredurondpoint.fr Distribution au Rond-Point : Manon Rouillard Voltigeuse
Romain Vigier Acrobate, porteur
Maxime Solé Acrobate, trapèze Washington
Basile Narcy Acrobate, porteur, jongleur
Maxime La Sala Porteur cadre Antonio Segura Lizan Voltigeur
Pedro Conscienca ou Tom Bruyas porteur, acrobate Joan Ramon Graell Gabriel porteur, acrobate. Saluons Pedro, qui va vers d’autres chemins, pensons à Titouan Maire, mort d’une chute au CNAC, lors d’une répétition. Mourir à 23 ans, au sortir d’une troisième année, cela ne devrait pas être possible La Ministre de la Culture, Rachida Dati, demande une enquête.
Par Joëlle Gayot dans Le Monde - 10 mai 2024
La metteuse en scène s’est fixée pour trois ans dans ce lieu singulier du Pas-de-Calais, où elle ouvre un nouveau chapitre de son aventure artistique avec « Lear ? », présenté les 11, 17 et 18 mai.
Lire l'article sur le site du "Monde" :
https://www.lemonde.fr/culture/article/2024/05/10/le-chateau-d-hardelot-son-theatre-elisabethain-et-son-roi-lear-revisites-par-irina-brook_6232541_3246.html
Planté sur la Côte d’Opale, d’où il observe les rives britanniques voisines (à 30 kilomètres à vol d’oiseau), le château d’Hardelot (Pas-de-Calais), avec ses pierres claires arc-boutées les unes sur les autres, détonne dans un paysage verdoyant où les forêts domaniales d’Hardelot et d’Ecault s’étendent à perte de vue. Construit au XIXe siècle par un Anglais sur les ruines d’une forteresse médiévale, il est surmonté d’un drapeau franco-britannique et agrémenté, sur ses pelouses, d’un théâtre en bois circulaire. L’ensemble est devenu, en 2009, le Centre culturel de l’Entente cordiale. Une volonté du département du Pas-de-Calais, qui en finance à lui seul le train de vie : 1,1 million d’euros de crédits en 2024. C’est assez pour que le directeur, Eric Gendron, entrecroise, dans une programmation binationale, expositions, concerts, cinéma en plein air, ateliers pour les scolaires ou spectacles de théâtre. « Nous sommes une vingtaine de permanents. A l’exception de janvier, nous ne fermons jamais. Du British Jazz Festival au Printemps médiéval, en passant par les Shakespeare Nights, chaque mois est consacré à un thème. Notre mission est d’être attractif sur les plans touristique et culturel », explique le patron, qui se désole, trousseau de clés à la main, du caractère singulier de la visite, ce mardi 7 mai. « Les tempêtes qui ont ravagé la région ne nous ont pas épargnés. A cause des infiltrations d’eau, nous devons mettre les œuvres à l’abri. » Sur place, les équipes déménagent avec précaution peintures à l’huile, sculptures et meubles ouvragés. Un crâne en marbre attend son heure, le canon offert par la reine Victoria également. Le fumoir, la bibliothèque, la salle à manger, l’immense escalier de bois : pas un mètre carré qui ne soit sécurisé. Les randonneurs devront se contenter, pendant quelques mois, d’admirer le château de ses jardins. Réplique du Globe de Londres Même le théâtre circulaire, autre atout (et non des moindres) de ce site éclectique, a subi les caprices de la météo. Les hauts bambous qui l’encerclent ont été retirés, pour éviter le risque de les voir chuter sur les passants. L’édifice n’en reste pas moins impressionnant. Et pour cause : surgi de terre en 2015, il est la réplique du Théâtre du Globe, qui, à Londres, accueillait les pièces de Shakespeare. C’est donc ici qu’avec évidence se sont dirigés les pas d’Irina Brook, pour qui l’œuvre de l’élisabéthain est une source de jouvence permanente (elle a adapté et mis en scène Roméo et Juliette, Tempête !, Le Songe). L’artiste franco-britannique n’est pas pour rien dans la construction de cet écologique bâtiment : « Avec l’architecte Andrew Todd, nous l’avions rêvé comme le croisement entre le Globe londonien et les Bouffes du Nord parisiens. A l’origine, il devait être implanté en bordure de Seine, près de Ris-Orangis [Essonne]. Je me suis retirée du projet, et c’est finalement sur la Côte d’Opale qu’Andrew l’a bâti. » En 2023, la metteuse en scène était venue, pour la première fois, jouer à Hardelot. Elle en garde le souvenir inoubliable de l’énergie naissant des rondeurs boisées de la salle, un pur violoncelle où résonnent et vibrent les mots des acteurs. « Les murs parlent », affirme Irina Brook. Le choc est tel qu’elle n’envisage plus de repartir. Associée au Centre culturel de l’Entente cordiale, elle sera son ambassadrice pour les trois ans à venir. Une fonction qu’elle souhaiterait assumer au-delà du temps imparti : « J’aimerais obtenir des financements européens pour pérenniser ma présence. Le théâtre a besoin de plus de temps pour se déployer. » « Changer le monde est mission impossible » A-t-elle enfin trouvé son port d’attache ? Celle qui partage désormais son temps entre la France et le Kent (elle peut voir Hardelot de son appartement de Folkestone) a quitté en 2019 la direction du Centre dramatique national de Nice après un unique mandat. « Je suis partie pour sauver ma peau. Je m’étais épuisée dans le désir idéaliste de rallier le public au théâtre. Je n’avais que ça en tête, je ne me suis occupée de rien d’autre, jusqu’à ce que je comprenne que changer le monde est mission impossible. » Faute de changer le monde, elle se réinvente. Une métamorphose qui n’est pas sans rapport avec la mort de son père, Peter Brook, en juillet 2022. « Je pense avoir passé ma vie à essayer de faire du théâtre pour lui plaire. Je suivais ses préceptes. Je m’acharnais à concevoir des spectacles simples et pour tous. Il me semblait que je n’avais rien de personnel à raconter. » Ces entraves ont volé en éclats. Si aujourd’hui Irina Brook revient à Shakespeare, elle le fait en ne cachant rien de ce qu’elle ressent « au plus profond » d’elle-même. Elle monte donc Lear ?, d’après Le Roi Lear. Un drame qu’elle projette dans une maison de retraite et dans lequel elle greffe des textes inédits, fruits d’improvisations menées avec ses comédiens. Une histoire d’enfants et de parents, de vieillards au seuil de la mort. « Nous passons par l’esprit de Lear, une folie qui nous autorise à circuler dans toutes sortes de mondes. » Sur la scène, un lit médicalisé et un fauteuil roulant. Les filles de Lear portent des robes à paillettes sous leurs blouses d’infirmière. Le roi endosse un manteau de fourrure élimé. A quelques jours de la première, l’acte V de la pièce est encore à inventer. Irina Brook travaille d’arrache-pied et dort trois ou quatre heures par nuit. Elle ne s’en plaint pas, au contraire. Elle sait qu’elle ouvre un nouveau chapitre de son histoire artistique. Et qu’elle s’apprête à livrer d’elle, au théâtre, ce qu’elle n’a jamais osé y déposer. « Quand les croulants tombent, la jeunesse se dresse ! » : les mots claquent sur le plateau. Sont-ils de Shakespeare ou de la metteuse en scène ? Le doute est permis. Lear ?, adaptation et mise en scène d’Irina Brook d’après Shakespeare. Avec Geoffrey Carey, Kevin Ferdjani, Marjory Gesbert, Emmanuel Guillaume, Maïa Jemmett, Irène Reva, Augustin Ruhabura, Maximilien Seweryn. Château d’Hardelot, Condette (Pas-de-Calais), dans le cadre de la 7e édition des Shakespeare Nights. Les 11, 17 et 18 mai à 20 heures. De 3 € à 12 €. Chateau-hardelot.fr Joëlle Gayot (Condette (Pas-de-Calais)) / LE MONDE Légende photo : Les répétitions de « Lear ? », d’après Shakespeare, par Irina Brook, au château d’Hardelot, à Condette (Pas-de-Calais), en avril 2024. IRINA JANE BROOK
Par Sandrine Blanchard dans Le Monde - 7 mai 2024 « 4 211 km », d’Aïla Navidi, a été récompensé deux fois tout comme « Le Cercle des poètes disparus » et Rudy Milstein pour « C’est pas facile d’être heureux quand on va mal ».
Lire l'article sur le site du "Monde" :
https://www.lemonde.fr/culture/article/2024/05/07/molieres-une-35-ceremonie-feministe-et-politique-marquee-par-un-palmares-eclectique_6231976_3246.html ` Féministe et politique dans ses discours, éclectique dans son palmarès : la 35e Nuit des Molières, retransmise lundi 6 mai sur France 2, n’a pas attribué une flopée de statuettes à un même spectacle, pour une fois, mais elle n’a pas échappé aux sujets d’actualité qui bouleversent le monde et aux inquiétudes du secteur du spectacle vivant en France. Sur la scène parisienne des Folies-Bergère, l’humoriste Caroline Vigneaux, maîtresse de cérémonie, a eu beau promettre, avec énergie, que le « seul but » de la soirée était de « divertir », les intermèdes sans grand éclat n’ont pas suffi à détendre l’ambiance. L’heure était surtout aux messages. Sophia Aram (Molière du spectacle d’humour pour Le Monde d’après) a dénoncé le « silence » du monde de la culture après les massacres du 7 octobre. « Comment être solidaires des milliers de civils morts à Gaza sans être aussi solidaires des victimes israéliennes ? Comment exiger d’Israël un cessez-le-feu sans exiger la libération des otages israéliens ? Comment réclamer le départ de Nétanyahou sans réclamer celui du Hamas ? », s’est interrogée la chroniqueuse de France Inter, largement applaudie. Des « nuages qui s’amoncellent » La cause des femmes, le sexisme et les violences qu’elles subissent, a presque été le fil rouge de la soirée, sous l’impulsion de la féministe Caroline Vigneaux. Quant à la ministre de la culture, Rachida Dati, elle n’a pas seulement été interpellée par un comédien de la CGT-Spectacle sur les coupes budgétaires qui touchent la culture. Même le président des Molières, Jean-Marc Dumontet, toujours prompt, habituellement, à vanter les bienfaits de la politique culturelle, n’a pas caché ses inquiétudes face aux « nuages qui s’amoncellent » sur le système de l’intermittence du spectacle. S’adressant à la ministre, le producteur a également souligné à quel point, « dans une société fragmentée et face à la montée des extrêmes, la culture a un vrai rôle à jouer ». Rappelant avec force que « sans liberté d’expression et de création, il n’y a pas de démocratie », le président des Molières a aussi évoqué le sort du rappeur iranien Toomaj Salehi, « un jeune artiste victime de la barbarie et de l’obscurantisme d’un régime moyenâgeux condamné à mort pour une chanson ». Côté palmarès, c’est d’ailleurs un spectacle évoquant l’exil en France d’un couple iranien fuyant dans les années 1980 le régime islamique, 4 211 km, d’Aïla Navidi, qui a été récompensé à deux reprises (meilleur spectacle de théâtre privé et révélation féminine pour Olivia Pavlou-Graham). Plusieurs surprises Une fois n’est pas coutume, les pièces qui cumulaient le plus de nominations n’ont pas tout accaparé. Ainsi de Courgette, mise en scène par Pamela Ravassard et Garlan Le Martelot. Spectacle tout public, plein de bons sentiments, sur l’histoire d’un enfant d’une dizaine d’années placé dans un foyer, il figurait dans sept catégories. Finalement, il repart uniquement avec le prix de la comédienne dans un spectacle de théâtre public pour Vanessa Cailhol. Quant au Cercle des poètes disparus (adaptation du film de Peter Weir, qui fait salle comble au Théâtre Antoine à Paris), nommé six fois, il obtient deux récompenses, celle de la mise en scène dans le privé pour Olivier Solivérès et celle de la révélation masculine pour Ethan Oliel. Les surprises sont aussi venues des victoires remportées par des outsiders au détriment de têtes d’affiche. Ainsi, à la statuette reçue par la jeune comédienne Vanessa Cailhol, pourtant opposée à un trio renommé – Emmanuelle Bercot, Laetitia Casta et Marina Hands – est venue s’ajouter l’attribution du Molière du meilleur seul en scène à Eva Rami, pour son saisissant Va aimer ! préféré à Dominique Blanc, Ludivine Sagnier et Franck Desmedt. Rudy Milstein n’en revenait pas, lui aussi, de décrocher non seulement le Molière de la meilleure comédie (en concurrence notamment avec Vidéo Club, de Sébastien Thiéry), mais aussi de l’auteur francophone pour sa pièce C’est pas facile d’être heureux quand on va mal, qui met en scène cinq quadragénaires seuls et dépressifs. Cristiana Reali enfin récompensée Moins surprenant, et justifié : Vincent Dedienne, désopilant Fadinard dans l’excellent Chapeau de paille d’Italie, mis en scène par Alain Françon, a été récompensé du Molière du comédien dans un spectacle de théâtre privé et Micha Lescot de celui du comédien dans le théâtre public pour sa prestation étincelante dans Richard II, mis en scène par Christophe Rauck. Quant à Cristiana Reali, elle a enfin décroché, après avoir été nommée à six reprises ces dernières années, son premier Molière de la meilleure comédienne dans le privé pour sa prestation émouvante dans Un tramway nommé désir. Spectacle issu de la décentralisation, le provocant et hilarant 40° sous zéro, créé à La Filature de Mulhouse par la compagnie Munstrum Théâtre, a décroché les deux convoités Molières de la mise en scène (pour Louis Arene) et du théâtre public. Multirécompensée en 2022 pour Féminines, Pauline Bureau brille de nouveau grâce à son féerique Neige qui obtient deux Molières (jeune public et création visuelle et sonore). « Je partage ces prix avec toutes les compagnies qui travaillent dans des conditions de plus en plus précaires et avec des moyens de tournée en baisse », a souligné la metteuse en scène. Le palmarès de la 35ᵉ cérémonie des Molières Molière du théâtre privé 4 211 km, texte et mise en scène d’Aïla Navidi, Studio Marigny et Théâtre de Belleville. Molière du théâtre public 40° Sous zéro, de Copi, mise en scène de Louis Arene, Compagnie Munstrum Théâtre. Molière de la comédie C’est pas facile d’être heureux quand on va mal, de Rudy Milstein, mise en scène de Rudy Milstein et Nicolas Lumbreras, Théâtre Lepic. Molière de la création visuelle et sonore Neige, texte et mise en scène de Pauline Bureau, scénographie d’Emmanuelle Roy, costumes d’Alice Touvet, lumière Jean-Luc Chanonat, Compagnie La part des anges. Molière du spectacle musical Spamalot, d’Eric Idle, mise en scène de Pierre-François Martin-Laval, Théâtre de Paris. Molière de l’humour Sophia Aram, dans Le Monde d’après, mise en scène de Sophia Aram et Benoît Cambillard. Molière du jeune public Neige, texte et mise en scène de Pauline Bureau, Compagnie La part des anges. Molière du seul/e en scène Va aimer ! de et par Eva Rami, Théâtre Lepic. Molière du comédien dans un spectacle de théâtre public Micha Lescot, dans Richard II, de William Shakespeare, mise en scène de Christophe Rauck. Molière de la comédienne dans un spectacle de théâtre public Vanessa Cailhol, dans Courgette, de Paméla Ravassard et Garlan Le Martelot, mise en scène de Paméla Ravassard. Molière du comédien dans un spectacle de théâtre privé Vincent Dedienne, dans Un chapeau de paille d’Italie, d’Eugène Labiche, mise en scène d’Alain Françon. Molière de la comédienne dans un spectacle de théâtre privé Cristiana Reali, dans Un tramway nommé désir, de Tennessee Williams, mise en scène de Pauline Susini. Molière du metteur en scène dans un spectacle de théâtre public Louis Arene pour 40° sous zéro. Molière du metteur en scène dans un spectacle de théâtre privé Olivier Solivérès pour Le Cercle des poètes disparus. Molière de la révélation féminine Olivia Pavlou-Graham, dans 4 211 km, texte et mise en scène d’Aïla Navidi. Molière de la révélation masculine Ethan Oliel, dans Le Cercle des poètes disparus, adaptation de Gérald Sibleyras, mise en scène d’Olivier Solivérès. Molière du comédien dans un second rôle Guillaume Bouchède, dans Je m’appelle Asher Lev, d’Aaron Posner, mise en scène d’Hannah-Jazz Mertens. Molière de la comédienne dans un second rôle Jeanne Arènes, dans L’Effet miroir, de Léonore Confino, mise en scène de Julien Boisselier. Molière de l’auteur/trice francophone vivant/e Rudy Milstein pour C’est pas facile d’être heureux quand on va mal. Sandrine Blanchard / Le Monde Légende photo : L’actrice Olivia Pavlou-Graham reçoit le Molière de la révélation féminine pour « 4 211 km » lors de la 35ᵉ cérémonie de remise des Molières, aux Folies-Bergère, à Paris, le 6 mai 2024. THOMAS SAMSON/AFP
Par Eric Delivré pour le site de l'Officiel - 6 mai 2024 Tout savoir sur la 35e cérémonie des Molières (palmarès et nominations), récompensant les meilleurs spectacles de l'année écoulée programmés dans les théâtres français.
La 35e cérémonie des Molières a lieu le lundi 6 mai 2024 aux Folies Bergère. Elle est diffusée sur France 2 et présentée par l'humoriste et comédienne Caroline Vigneaux.
Décernés par l'association éponyme au cours d'une cérémonie télévisée, les Molières récompensent chaque année les spectacles de théâtre présentés sur le territoire français au cours de l'année précédente, ainsi que les artistes et techniciens inhérents. La période de référence pour la 35e Nuit des Molières s’étend du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, avec une possibilité de repêchage pour certains événements à cheval sur deux périodes.
L'association « Les Molières » a été créée en 1987 par des directeurs de théâtres publics et privés, son premier président était le comédien et metteur en scène Jean-Louis Barrault. Elle est actuellement dirigée par Jean-Marc Dumontet, en tant que président, et Cécile Backès, en tant que vice-présidente.
Le palmarès complet des Molières 2024 Les nominations de la 35e cérémonie des Molières étaient réparties en 19 catégories. Découvrez ci-dessous tous les artistes lauréats des Molières 2024. Un Molière d'honneur a été remis au comédien Francis Huster. Molière du Théâtre privé Lauréat : 4211 km de Aïla Navidi, mise en scène Aïla Navidi
Studio Marigny et Théâtre de Belleville Les autres nommés : Molière du Théâtre public Lauréat : 40° sous zéro de Copi, mise en scène Louis Arene
Compagnie Munstrum Théâtre Les autres nommés : Molière de la Comédie Lauréat : C’est pas facile d’être heureux quand on va mal de Rudy Milstein, mise en scène Rudy Milstein et Nicolas Lumbreras - Théâtre Lepic Les autres nommés : Molière de la Création visuelle et sonore Lauréat : Neige de Pauline Bureau, mise en scène Pauline Bureau, scénographie Emmanuelle Roy, décors Emmanuelle Roy, costumes Alice Touvet, lumière Jean-Luc Chanonat - Compagnie La Part des Anges Les autres nommés : - 40° sous zéro de Copi, mise en scène Louis Arene, scénographie Louis Arene, costumes Christian Lacroix, lumière François Menou
Compagnie Munstrum Théâtre - Le Cercle des poètes disparus, adaptation de Gérard Sibleyras, mise en scène Olivier Solivérès, costumes Chouchane Abello-Tcherpachian, décors Jean-Michel Adam, lumière Denis Koransky
Théâtre Antoine - Denali de Nicolas Le Bricquir, mise en scène Nicolas Le Bricquir, scénographie Juliette Desproges, lumière Maxime Moro
Studio Marigny Molière du Spectacle musical Lauréat : Spamalot de Éric Idle, mise en scène Pierre-François Martin-Laval - Théâtre de Paris Les autres nommés : - Mamma Mia, de Catherine Johnson, mise en scène Phyllida Lloyd
Casino de Paris - Molière, le spectacle musical de Ladislas Chollat d’après François Chouquet et Dove Attia, mise en scène Ladislas Chollat
Dôme de Paris - Palais des Sports - L’Opéra de quat’sous de Thomas Ostermeier, mise en scène Thomas Ostermeier
Comédie-Française Molière de l’Humour Lauréate : Sophia Aram dans Le Monde d’après de Sophia Aram et Benoît Cambillard, mise en scène Sophia Aram et Benoît Cambillard Les autres nommés : Molière du Jeune public Lauréat : Neige de Pauline Bureau, mise en scène Pauline Bureau - Compagnie La part des Anges Les autres nommés : Molière du Seul/e en scène Lauréate : Va aimer ! avec Eva Rami, de Eva Rami - Théâtre Lepic Les autres nommés : Molière de la Mise en scène dans un spectacle de Théâtre public Lauréat : Louis Arene pour 40° sous zéro de Copi Les autres nommés : Molière de la Mise en scène dans un spectacle de Théâtre privé Lauréat : Olivier Solivérès pour Le Cercle des poètes disparus, adaptation de Gérald Sibleyras Les autres nommés : Molière de l’Auteur/trice francophone vivant/e Lauréat : Rudy Milstein pour C’est pas facile d’être heureux quand on va mal Les autres nommés : Molière de la Comédienne dans un spectacle de Théâtre public Lauréate : Vanessa Cailhol dans Courgette de Paméla Ravassard et Garlan Le Martelot, mise en scène Paméla Ravassard Les autres nommées : - Emmanuelle Bercot dans Après la répétition/persona de Ivo van Hove, mise en scène Ivo van Hove
- Laetitia Casta dans Une journée particulière de Ettore Scola, mise en scène Lilo Baur
- Marina Hands dans Le Silence de Lorraine de Sagazan et Guillaume Poix, mise en scène Lorraine de Sagazan
Molière du Comédien dans un spectacle de Théâtre public Lauréat : Micha Lescot dans Richard II de William Shakespeare, mise en scène Christophe Rauck Les autres nommés : - Charles Berling dans Après la répétition/persona de Ivo van Hove, mise en scène Ivo van Hove
- Laurent Lafitte dans Cyrano de Bergerac de Emmanuel Daumas, mise en scène Emmanuel Daumas
- Roschdy Zem dans Une journée particulière de Ettore Scola, mise en scène Lilo Baur
Molière de la Comédienne dans un spectacle de Théâtre privé Lauréate : Cristiana Reali dans Un tramway nommé Désir de Tennessee Williams, mise en scène Pauline Susini Les autres nommées : - Pascale Arbillot dans Interruption de Pascale Arbillot, Hannah Levin-Seiderman, Sandra Vizzavona, mise en scène Hannah Levin-Seiderman
- Ariane Ascaride dans Gisèle Halimi, une farouche liberté de Agnès Harel, Philippine Pierre-Brossolette et Léna Paugam, mise en scène Léna Paugam
- Noémie Lvovsky dans Vidéo club de Sébastien Thiéry, mise en scène Jean-Louis Benoît
Molière du Comédien dans un spectacle de Théâtre privé Lauréat : Vincent Dedienne dans Un chapeau de paille d’Italie de Eugène Labiche, mise en scène Alain Françon Les autres nommés : - Maxime d’Aboville dans Pauvre Bitos - Le dîner de têtes de Jean Anouilh, mise en scène Thierry Harcourt
- Stéphane Freiss dans Le Cercle des poètes disparus, adaptation de Gérald Sibleyras, mise en scène Olivier Solivérès
- Thierry Frémont dans Le Repas des fauves, adaptation de Julien Sibre, mise en scène Julien Sibre
Molière de la Comédienne dans un second rôle Lauréate : Jeanne Arènes dans L'Effet miroir de Léonore Confino, mise en scène Julien Boisselier Les autres nommées : - Cécile Garcia-Fogel dans Richard II de William Shakespeare, mise en scène Christophe Rauck
- Charlotte Matzneff dans Le Huitième Ciel de Jean-Philippe Daguerre, mise en scène Jean-Philippe Daguerre
- Alysson Paradis dans Un tramway nommé Désir de Tennessee Williams, mise en scène Pauline Susini
- Lola Roskis dans Courgette de Paméla Ravassard et Garlan Le Martelot, mise en scène Paméla Ravassard
- Josiane Stoleru dans James Brown mettait des bigoudis de Yasmina Reza, mise en scène Yasmina Reza
Molière du Comédien dans un second rôle Lauréat : Guillaume Bouchède dans Je m’appelle Asher Lev de Aaron Posner, mise en scène Hannah-Jazz Mertens Les autres nommés : - Lionel Abelanski dans Un tramway nommé Désir de Tennessee Williams, mise en scène Pauline Susini
- Florian Choquart dans Courgette de Paméla Ravassard et Garlan Le Martelot, mise en scène Paméla Ravassard
- Kevin Razy dans Passeport de Alexis Michalik, mise en scène Alexis Michalik
- Laurent Stocker dans Cyrano de Bergerac de Emmanuel Daumas, mise en scène Emmanuel Daumas
- Vincent Viotti dans Courgette de Paméla Ravassard et Garlan Le Martelot, mise en scène Paméla Ravassard
Molière de la Révélation féminine Lauréate : Olivia Pavlou-Graham dans 4211 km de Aïla Navidi, mise en scène Aïla Navidi Les autres nommées : - Justine Bachelet dans Après la répétition/persona de Ivo van Hove, mise en scène Ivo van Hove
- Nassima Benchicou dans Freud et la femme de chambre de Leonardo de la Fuente, mise en scène Alain Sachs
- Lucie Brunet dans Denali de Nicolas Le Bricquir, mise en scène Nicolas Le Bricquir
- Lila Houel dans Daddy de Marion Siéfert, mise en scène Marion Siéfert
- Cléo Sénia dans Music-Hall Colette de Cléo Sénia et Alexandre Zambeaux, mise en scène Léna Bréban
Molière de la Révélation masculine Lauréat : Ethan Oliel dans Le Cercle des poètes disparus, adaptation de Gérald Sibleyras, mise en scène Olivier Solivérès Les autres nommés : - Audran Cattin dans Le Cercle des poètes disparus, adaptation de Gérald Sibleyras, mise en scène Olivier Solivérès
- Martin Karmann dans Je m’appelle Asher Lev de Aaron Posner, mise en scène Hannah-Jazz Mertens
- Garlan Le Martelot dans Courgette de Paméla Ravassard et Garlan Le Martelot, mise en scène Paméla Ravassard
- Louis Peres dans Daddy de Marion Siéfert, mise en scène Marion Siéfert
- Hey Yuming dans Les Bonnes de Mathieu Touzé, mise en scène Mathieu Touzé
Les critères d'éligibilité aux Molières 2024 Les critères d'éligibilité au catalogue de vote des Molières sont le nombre de représentations du spectacle et, pour les spectacles d'humour, le nombre d'entrées payantes. Dans le détail : → Pour le Théâtre privé : les spectacles doivent avoir totalisé au moins 60 représentations durant la période de référence (du 1er avril 2023 au 31 mars 2024) dans les théâtres privés de plus de 90 places (hors festivals et tournées). On retrouve dans cette liste des spectacles tels que Passeport (mise en scène Alexis Michalik) au Théâtre de la Renaissance, Le Cercle des poètes disparus (mise en scène Olivier Solivérès) au Théâtre Antoine, ou encore La Maison du Loup (mise en scène Tristan Petitgirard) au Théâtre Rive Gauche. → Pour le Théâtre public : les spectacles doivent avoir totalisé au moins 25 représentations durant la période de référence dans des théâtres nationaux, centres dramatiques nationaux, scènes nationales ou théâtres municipaux d’au moins 200 places. Par exemple, sont éligibles dans cette liste Notre vie dans l'art au Théâtre du Soleil ou Courgette, coproduit par Le théâtre - Scène conventionnée d’Auxerre. → Pour la catégorie Humour : les spectacles sont sélectionnés sur la base de 8 000 spectateurs effectifs/payants, durant l'année civile. Ils doivent également avoir été joués à Paris dans une salle de plus de 200 places. → Pour le jeune public : dans la période impartie, les spectacles doivent avoir été produits ou diffusés au moins 40 fois pour le Théâtre privé et 25 fois pour le Théâtre public. → Pour les spectacles musicaux : les spectacles doivent avoir été produits ou diffusés au moins 60 fois durant la période de référence par les salles de spectacle de plus 90 places sur Paris et de plus de 200 places en province. Pour être éligibles, les spectacles musicaux doivent être en français (50 % minimum) avec des parties chantées et parlées équilibrées au service d’une continuité dramatique. Les dates des spectacles joués en festival ne sont pas comptabilisées. À noter que les spectacles déjà éligibles lors des trois années précédentes ne le sont pas pour la cérémonie à venir. Et un spectacle ayant déjà reçu un Molière n'est plus éligible pendant les douze années qui suivent sa récompense. Le règlement complet de la 35e cérémonie des Molières est disponible sur le site de l'association. Qui vote pour les Molières ? Le vote est effectué par un collège électoral composé de professionnels actifs du milieu théâtral : artistes, collaborateurs artistiques, metteurs en scène, auteurs, agents, journalistes, directeurs des théâtres privés adhérents du SNTP ou de l'ASTP, dix principaux tourneurs (liste établie en accord avec le Syndicat National des Entrepreneurs de Spectacle), directeurs des théâtres nationaux, des centres dramatiques nationaux, des principales scènes nationales et conventionnées, et des théâtres.
Par Rosita Boisseau dans Le Monde - 6 mai 2024 Figure de proue de la danse moderne et contemporaine, l’artiste avait fondé le festival des Baux-de-Provence en 1962, avant d’être nommé inspecteur de la danse au ministère de la culture, poste qu’il occupa de 1989 à 1991. Il est décédé mercredi 1er mai, à Paris.
Lire l'article sur le site du "Monde" :
https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2024/05/06/la-mort-du-choregraphe-dominique-dupuy_6231937_3382.html
Son esprit pénétrant, sa vibration profonde auréolaient chaque rencontre même fugace avec Dominique Dupuy d’une tension électrique. Libre et aventureux, l’artiste et chorégraphe, tête de proue de la danse moderne et contemporaine, aussi présent sous les feux de la rampe que militant dans les bureaux des institutions, est mort mercredi 1er mai chez lui, à Paris. Un an et demi après la disparition, en septembre 2022, de Françoise Dupuy, sa femme et complice de création, cet homme au tempérament trempé s’est effacé. Dominique Dupuy est né Jean-Dominique Dupuy le 31 octobre 1930, à Paris. Curieux, gourmand, fonceur, passé par l’apprentissage du ballet, de l’acrobatie et du théâtre, il travaille avec le chorégraphe allemand installé en France Jean Weidt (1904-1988) à la fin des années 1940 pour la pièce Cellule, où il croise celle qu’il épousera. En 2005, au Théâtre de Chaillot, à Paris, il rend hommage à Weidt et à la danse expressive allemande dans le spectacle W.M.D., qui reprenait le superbe Vieilles gens, vieux fers, conçu en 1929 par Weidt. Ce soin amoureux apporté à l’histoire et à sa transmission draine toutes les vies de Dominique Dupuy. De sa première compagnie, Françoise et Dominique, qui joue dans les cabarets dès les années 1950, aux Ballets modernes de Paris, fondés en 1955, du festival des Baux-de-Provence, qu’il crée en 1962, au ministère de la culture, où il est inspecteur de la danse de 1989 à 1991, Dominique Dupuy remet sans fin son ouvrage sur le métier. Un programmateur affûté Dans le livre Une danse à l’œuvre, de Dominique et Françoise Dupuy (Coédition Centre national de la danse - scène nationale de La Roche-sur-Yon, 2001), la pionnière américaine Anna Halprin (1920-2021) souligne en introduction le rôle du couple : « Leur détermination, dès les années 1940, à changer l’art de la danse (…) témoign[e] de leur véritable nature d’artistes iconoclastes. Pour relever ce défi de longue haleine d’un travail à contre-courant de la marée culturelle, ils ont dû se dépasser et endosser bien des rôles. (…) Ils sont devenus des artistes, doublés d’éducateurs, professeurs, écrivains, directeurs, chorégraphes, organisateurs, politiques et activistes. » Programmateur affûté, Dominique Dupuy présente en 1962, pour la première fois, le chorégraphe américain Merce Cunningham (1919-2009) au Théâtre de l’Est parisien. Pédagogue, il crée en 1969 le centre de formation des Rencontres internationales de danse contemporaine (RIDC) et donne des cours notamment au Centre national de danse contemporaine d’Angers. C’est là que le chorégraphe Amala Dianor travaille avec lui en 2001. « Pour moi qui venais du hip-hop et dont le mouvement était démonstratif et musclé, il m’a appris à trouver une autre densité au geste, à déplacer l’air, comme il disait, avec la même intensité physique mais avec une conscience complète de ce qui est mis à l’œuvre », résume Dianor. « Il se battait contre l’oubli » Interprète tranchant, il irradie dans nombre de ses spectacles jusqu’en 2016 parmi lesquels Le Cercle dans tous ses états (1979), Ballum circus (1986), sous influence du cirque, et Solo-Solo (2010) ou encore Acte sans paroles 1, de Samuel Beckett (2013), avec l’acrobate Tsirihaka Harrivel. De 1999 à 2001, il est artiste associé avec Françoise Dupuy au Ballet atlantique, dirigé par Régine Chopinot, et collabore à La Danse du temps. En 2016, celui qui affirmait que « danser est le choix courageux et ambitieux d’un homme qui choisit d’être sans paroles » concevait l’opération Silence(s), cycle de conférences et spectacles. Ses multiples activités, nourries d’analyses, Dominique Dupuy les consignait dans des écrits et des conférences. L’ultime entreprise de ce poète à la langue aussi riche que méticuleuse était de témoigner sur sa traversée artistique. « Il se battait contre l’oubli et l’une de ses obsessions était de conserver l’histoire de la danse moderne dont il était l’une des figures, aux côtés de Françoise, avec Jacqueline Robinson, Karin Waehner, Jérôme Andrews, précise Sonia Soulas, ex-directrice adjointe de la scène nationale de La Roche-sur-Yon. Cette branche a été occultée par celle des Etats-Unis mais elle a joué un rôle crucial pour extraire la danse de l’emprise du ballet et de l’opéra en France. Il avait déjà le titre de son livre pour lequel nous avions fait des entretiens ensemble : “Pour ne pas en finir avec la danse moderne”. » Rosita Boisseau / LE MONDE Dominique Dupuy en quelques dates 31 octobre 1930 Naissance à Paris 1957 Danse avec Françoise Dupuy dans Epithalame, de Deryk Mendel 2005 Création de W.M.D., hommage aux chorégraphes Jean Weidt et Deryk Mendel, ses compagnons de route 2013 Chorégraphie d’Acte sans paroles 1, de Samuel Beckett 1er mai 2024 Mort à Paris Légende photo : Dominique Dupuy, dans le spectacle « Le Regard par-dessus le col », au Théâtre national de Chaillot, à Paris, le 24 avril 2007. LAURENT PHILIPPE/ DIVERGENCE
ENTRETIEN - Propos recueillis par Sandrine Blanchard pour Le Monde - 5 mai 2024 Je ne serais pas arrivé là si… » Chaque semaine, « Le Monde » interroge une personnalité sur un moment décisif de son existence. L’auteur et metteur en scène multirécompensé raconte comment la mort de son père l’a « libéré » d’un destin dont il ne voulait pas.
Lire l'article sur le site du "Monde" :
https://www.lemonde.fr/culture/article/2024/05/05/joel-pommerat-dramaturge-quand-je-reve-de-mon-pere-ce-sont-des-reves-de-culpabilite_6231635_3246.html?lmd_medium=al&lmd_campaign=envoye-par-appli&lmd_creation=ios&lmd_source=twitter
A la tête de sa compagnie Louis Brouillard, Joël Pommerat, 61 ans, incarne l’une des aventures théâtrales les plus brillantes de ces vingt dernières années. Il met en scène avec succès son propre répertoire, Les Marchands, Cendrillon, Ça ira (1) Fin de Louis, Contes et légendes, qui tournent en France ou à l’étranger. Jusqu’au 14 juillet, au Théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris, il redonne vie, plus de dix ans après sa création, à La Réunification des deux Corées, mosaïque de fragments explorant la complexité de l’amour. Je ne serais pas arrivé là si… … Si je n’avais pas perdu mon père à 15 ans. Avec lui à mes côtés, je n’aurais pas pu prendre la voie du théâtre parce qu’il me destinait à autre chose. Mon père était très particulier, pas forcément un « bon parent » comme on l’entend généralement. Sans parler d’emprise, j’étais très influencé par sa conception de la vie. Nous avions une grande complicité, mais ce qu’il voulait pour moi, je ne me voyais pas ne pas le faire. Que voulait-il pour vous ? Que je sois enseignant. Orphelin, abandonné à la naissance par sa mère, mon père a été à l’assistance publique. Il s’est engagé très jeune dans l’armée et y a passé dix-huit ans. Puis il est devenu fonctionnaire au Trésor public. Un métier qui l’a complètement déprimé. S’il avait pu avoir une vie moins chaotique, choisir sa voie, il aurait enseigné. Pour lui, c’était la plus belle chose qui soit. Il le voulait pour moi. Il pensait, par transfert, pouvoir vivre ce que lui aurait aimé faire. Il est tombé malade au moment où je commençais à avoir des doutes, à me dire que ce n’était pas mon choix. Il est mort d’une leucémie en quelques mois. Cette perte m’a procuré beaucoup de chagrin et en même temps m’a libéré. A l’adolescence, il est difficile d’accepter ce paradoxe-là. Cela entraîne une culpabilité que je continue à ressentir. Quand je rêve de mon père, ce sont des rêves de culpabilité : il revient et je suis mal. Il vous imaginait enseignant, mais vous, quel rapport entreteniez-vous avec l’école ? J’étais en 2de quand il est mort. J’avais un an d’avance. Bon élève en primaire, on m’avait fait sauter une classe. Le collège m’avait démotivé et au lycée je décrochais. Mais si mon père était resté en vie, je serais allé au bout de mes études. Quelques mois après son décès, j’ai arrêté d’aller en cours. Aviez-vous l’accord de votre mère ? Elle ne m’a pas culpabilisé, elle m’a responsabilisé et m’a fait confiance. Je lui ai dit : « Je m’ennuie, je ne serai pas enseignant, donc ça ne sert à rien que je continue, je préfère arrêter plutôt que de perdre du temps. » Elle m’a répondu : « Si tu es sûr de toi, alors d’accord. » Avec le recul, je trouve son attitude incroyable face à un môme de 17 ans. Ma mère a commis un acte libérateur. Quel a été votre premier contact avec le théâtre ? Au collège, j’avais une professeure de français-latin, fan de théâtre, qui, en lien avec une association d’éducation populaire, proposait à ses élèves de les emmener certains soirs au Théâtre Charles-Dullin à Chambéry. J’ai eu envie d’y aller et tout m’a enchanté : dans ce petit théâtre à l’italienne je découvrais un monde parallèle. Ma sœur, de six ans mon aînée, imprégnée du mouvement culturel post-68, m’a aussi éveillé à la culture. Je l’ai accompagnée, adolescent, au Festival d’Avignon. Ce fut un nouveau choc. J’y ai vu un spectacle au Théâtre du Chêne-Noir qui m’a beaucoup marqué, Fantastic Miss Madona de Gérard Gelas, mêlant musique, texte, masques. Quelles sont vos envies après l’arrêt de vos études ? Vers 17 ans, j’ai eu un petit moment de révolte. Issu d’une culture très à gauche, une sœur post-soixante-huitarde, j’ai tout d’un coup eu une réaction un peu de droite ! Je ne voulais pas devenir un hippie, j’avais envie d’être un mec qui assume de gagner de l’argent, de faire du business. Pendant un an et demi, j’ai fait une école d’hôtellerie à Aix-les-Bains [Savoie] pour devenir barman. Puis, vers 19 ans, je me suis réveillé un matin en me disant : mais qu’est-ce que tu fais, tu as pris ton indépendance pour faire ça ? Le souhait d’être comédien était en moi, mais je n’osais pas le formuler. Auteur ou metteur en scène, c’était inenvisageable, je ne me sentais pas légitime pour ça. Jouer, c’était plus excitant. Mon idée était de me donner les moyens de faire du théâtre une vie, de prendre le risque de me jeter dans un autre monde. Donc je suis parti à Paris, avec très peu de contacts. Ma sœur, à nouveau, m’a soutenu en m’hébergeant à mon arrivée. J’avais choisi ma voie. Que faites-vous à Paris ? Je me suis d’abord inscrit dans un conservatoire d’arrondissement. Je n’y suis resté que trois mois, ça ronronnait. Puis, j’ai eu la chance, par l’intermédiaire d’amis de ma sœur, d’intégrer une troupe amateur à Château-Thierry, dans l’Aisne. Très vite, j’ai été engagé dans une compagnie, le Théâtre de la Mascara à Nogent-l’Artaud [Aisne], et je suis devenu comédien professionnel, autodidacte. J’ai eu le sentiment d’être à l’endroit le plus exaltant que je pouvais connaître. Mais assez rapidement j’ai eu un doute sur la place du comédien, toujours dépendant d’un metteur en scène, d’un projet, toujours en attente d’être choisi. J’étais intermittent, je faisais mes heures, mais avec un sentiment d’amertume de devoir accepter des compromis. Je me sentais enfermé dans un système avec une assez médiocre ambition de vie. J’étais parti à l’aventure, mais celle-ci finalement pouvait aussi devenir un peu plan-plan. Je ne voulais pas faire ce métier dans ces conditions-là, en pointant à l’ANPE [Agence nationale pour l’emploi, aujourd’hui France Travail]. J’avais besoin de trouver mon indépendance, un chemin plus personnel. Durant cette période où j’étais comédien, j’ai tenté les concours du Conservatoire national et de l’école du Théâtre national de Strasbourg. J’ai été très déçu de ne pas avoir été retenu. J’ai aussi pris conscience que j’avais arrêté de me cultiver à 17 ans en abandonnant les études. Quelle décision prenez-vous ? D’arrêter d’être comédien, sans abandonner le théâtre. J’ai décidé de chercher un boulot alimentaire et de prendre du temps pour lire à nouveau, noter des phrases qui me touchaient et commencer à écrire. J’ai passé l’équivalent du bac pour m’inscrire en fac de philo. Je suis devenu modèle pour un sculpteur puis, pendant quatre ans, veilleur de nuit dans un hôtel. La lecture de [l’écrivain et poète portugais] Fernando Pessoa m’a énormément marqué. Ce n’est pas la reconnaissance sociale qui compte. C’est presque une philosophie de l’échec, la grâce de l’invisibilité sociale. Je suis imprégné de ça et j’ai remis en question cette envie très conventionnelle de réussir à être comédien, à exister par le regard des autres. Ça m’a apaisé, je me suis senti moins dans l’urgence de prouver quelque chose et j’ai pris le temps. Je vivais un peu comme un ermite : je travaillais la nuit, la journée je lisais et j’allais à la fac, j’écrivais sans même avoir la prétention de devenir un écrivain. J’ai arrêté d’avoir un projet établi de carrière. Je me suis donné comme seul objectif de faire les choses dont j’avais envie. Pendant cinq ans j’ai fait mes « universités » de manière autonome, personnelle, chaotique. J’étais assez solitaire, mais pas malheureux. Comment s’est opérée la création de votre compagnie Louis Brouillard en 1990 ? J’avais écrit quelques textes, notamment un monologue, Le Chemin de Dakar. En 1990, je loue un théâtre pour trois soirs à Paris et je travaille avec une amie comédienne pour le présenter. Je crée une structure juridique, la compagnie Louis Brouillard, juste pour pouvoir établir des factures. Ce n’est qu’une association. Je choisis Louis comme le prénom de mon père et Brouillard parce que je voulais être sous le patronyme d’un personnage fictionnel et que j’étais déjà dans une esthétique où la nuit, le flou et l’ambiguïté prévalent sur la clarté. Dix ans plus tard, j’ai créé une vraie compagnie. J’avais pour modèle des aventures collectives, comme le Théâtre du Soleil d’Ariane Mnouchkine. Pourquoi proposer un « pacte » aux membres de votre compagnie ? La fidélité ne s’est installée que dix ans après la création de la compagnie. Les dix premières années, j’ai fait beaucoup de rencontres qui n’étaient pas bonnes et je me suis retrouvé dans des situations horribles de conflit. Après ces expériences douloureuses, j’ai arrêté le théâtre pour faire du cinéma, pensant que c’était plus tranquille. Au moins, quand le tournage est fini, on n’a plus les gens sur le dos. J’ai donc fait un break d’environ deux ans pour écrire un scénario à partir d’une de mes pièces, Les Evénements. Mais ça a foiré, je n’ai pas trouvé l’argent pour le film. Ça a été un coup d’arrêt violent, j’ai fait une dépression. Je me suis juré de ne plus jamais refaire ce pas de côté, cette erreur, et de retourner vers le théâtre. Il m’a fallu du temps pour comprendre que si je voulais garder le plaisir, ne pas m’user, il fallait que je m’entoure des bonnes personnes, que la relation humaine et pas seulement de travail était primordiale. J’ai réuni les gens que j’aimais. De cette frustration au cinéma est née une très grande détermination. D’avoir chuté m’a donné une énergie, une envie de faire. D’où le pacte : voilà, moi j’ai la pêche, si vous voulez me suivre, je ferai au moins un spectacle par an pendant dix ans. Il y avait une envie de rattraper le temps perdu, d’être au travail tous les jours et de jouer les spectacles longtemps. Et le succès, public et critique, va arriver. Comment le vivez-vous ? Tout s’est fait progressivement, presque quinze ans après ma première création. Je n’étais plus un jeune homme. Mais ça m’a beaucoup touché de voir soudain les salles complètes au Théâtre Paris-Villette, qui nous a longtemps accompagnés. Des soutiens plus forts sont arrivés, des conditions meilleures nous ont été données. J’ai commis une ou deux erreurs, en acceptant de multiples sollicitations. Je me suis mis parfois à tricher avec le temps, à sentir que je frôlais la catastrophe. La reconnaissance, il faut l’apprécier mais la garder à distance. La création de « Ça ira (1) Fin de Louis » a été particulièrement difficile… Olivier Py a été parmi les premières personnes à m’apporter un fort soutien. Lorsqu’il dirigeait le Centre dramatique national d’Orléans puis le Théâtre national de l’Odéon, il m’avait très bien accompagné. Nommé, en 2013, directeur du Festival d’Avignon, il me propose de réfléchir à un projet pour la Cour d’honneur. Je lui dis : « Bien sûr, pourquoi pas », mais avec un peu d’angoisse. On n’en finit pas de vouloir non pas faire en fonction de nos désirs à nous, mais de coller à celui des autres. Dans le fond, mon désir n’a jamais été de faire un spectacle dans la Cour d’honneur, ce lieu ne correspond pas à mon esthétique. J’ai cherché néanmoins à être à la hauteur de cet engagement et petit à petit l’idée d’écrire sur la Révolution, de créer un espace où scène et salle soient reliées autour d’un débat d’assemblée est arrivée. Mais c’était une période où j’étais au paroxysme de ma productivité. Ma chambre froide, Cendrillon, La Grande et Fabuleuse Histoire du commerce, mon premier opéra à Aix-en-Provence… En un an et demi, j’avais écrit trois spectacles, un livret et fait quatre mises en scène. J’y suis arrivé, mais je me suis cramé, j’ai fait un burn-out. Et j’ai eu un gros pépin dans ma vie personnelle. J’ai sombré, j’ai fait une dépression, j’ai pleuré, j’ai pris des tonnes de calmants parce que j’avais mal partout. Et j’avais cet engagement pour Avignon. Quand j’annonce à Olivier Py que je n’y arriverai pas, il le prend mal. Ce que je comprends. Mais moi je prends mal qu’il n’ait pas une parole de compassion, la moindre sollicitude. Ça, je ne lui pardonnerai jamais. Avignon a sauté, mais ce spectacle, Ça ira (1) Fin de Louis, a existé grâce aux gens géniaux qui m’entouraient, à des conditions humaines qui ont fait que j’ai pu tenir. Après cette parenthèse intense de création, j’allais toujours mal. Ce qui me constituait, le travail, me détruisait. Il fallait trouver des solutions. Et vous vous êtes reconstruit en faisant du théâtre en prison avec des groupes de détenus ? La reconstruction est d’abord passée par des choses personnelles. Mais aussi par la volonté de prendre mon temps, de ne pas repartir dans un rythme fou de travail avec des engagements intenables. Et j’ai recommencé le théâtre d’une façon complètement différente avec des personnes que je n’avais pas l’habitude de côtoyer, qui m’ont appris des choses, donné de l’amitié et, en retour, une forme de reconnaissance dont je devais manquer un peu. Ils me remerciaient d’être là. Ils me faisaient ressentir ce que je leur apportais. Ça m’a fait beaucoup de bien. Propos recueillis par Sandrine Blanchard / LE MONDE « La Réunification des deux Corées », création théâtrale de Joël Pommerat au Théâtre de la Porte Saint-Martin, à Paris, jusqu’au 14 juillet.
Par Fabienne Darge dans Le Monde - 2 mai 2024 Le metteur en scène aborde la colonisation algérienne par la France par le biais d’une enquête linguistique passionnante, dans un savant cocktail d’humour, de charme et de gravité.
Lire l'article sur le site du "Monde" :
https://www.lemonde.fr/culture/article/2024/05/02/au-theatre-de-la-bastille-a-paris-salim-djaferi-demele-les-mots-embrouilles-de-la-koulounisation_6231198_3246.html
L’homme debout sur la scène, tel qu’on le découvre en entrant dans la petite salle du Théâtre de la Bastille, à Paris, s’acharne à démêler une grosse pelote de bolduc, ce ruban plat en plastique dont l’usage principal est de ficeler les paquets cadeaux. La tâche n’est pas facile, et pour cause : c’est bien un gros nœud dont il va s’agir ici de tirer les fils emberlificotés. Rien de moins que ceux de la colonisation de l’Algérie par la France, que l’auteur et acteur Salim Djaferi aborde par le biais d’une enquête linguistique passionnante, restituée sur scène en un savant cocktail d’humour, de charme et de gravité. Tout est parti, raconte-t-il, du jour où il a demandé à sa mère, une Algérienne immigrée en France, comment on disait « colonisation » en arabe. « Koulounisation », lui a-t-elle répondu. Evidemment, Salim Djaferi a été un peu surpris. « N’y a-t-il pas un mot arabe pour le dire ? », s’est-il étonné. Et il a commencé sa quête, sur le fil tendu de l’histoire entre les deux pays, les deux rives de la Méditerranée. Il a d’abord consulté le dictionnaire, qui lui a appris que colonisation est traduit par « isti’ammar », qui est un dérivé du verbe « amaar », lequel signifierait « construire ». Sauf que, selon les interlocuteurs qu’il rencontre ensuite, le verbe « amaar » peut avoir bien d’autres significations : « posséder » et même « posséder sans autorisation », « ordonner », au sens aussi bien de « commander » que de « mettre en ordre », ou « remplir ». « Après, tu peux remplir ce que tu veux. Tu peux remplir un village si tu veux. Mais il faut le vider avant. Tu vides et tu remplis : tu remplaces, en fait », précise l’homme, qui propose cette interprétation. Réflexion sur l’effacement Salim Djaferi découvre alors qu’un autre mot arabe existe pour traduire « colonisation ». Il a été inventé en 1963, un an après l’indépendance de l’Algérie, par les traducteurs des Damnés de la terre (Maspero, 1961), l’essai de Frantz Fanon sur les guerres de libération. Lesquels traducteurs ont refusé le mot « isti’ammar », qu’ils ont jugé mensonger. Ils ont proposé à la place « istidammar », un dérivé du verbe « dammar », qui, en arabe, veut dire « détruire ». Ainsi le jeune comédien dévide-t-il sa pelote, de surprise en surprise, en convoquant sur le plateau un autre langage, plastique, celui-là : à l’aide de plaques de polystyrène, il agence à vue de petites constructions qui disent l’enfermement ou la destruction. Ou met en scène, avec une vraie-fausse spectatrice invitée dans le jeu, les différences de point de vue à l’aide d’une éponge et d’une bouteille. La question de ce que la colonisation fait au langage − ou l’inverse − se pose, encore, dans ce passage de « colonisation » à « koulounisation », et dans les divers termes qui ont été utilisés, d’une rive et d’une époque à l’autre, pour définir la guerre d’Algérie : « événements algériens », « guerre de libération nationale » ou « révolution algérienne ». L’affaire prend peu à peu un tour plus personnel, quand l’enquête menée par Salim Djaferi le ramène vers les rivages maternels, et les glissements d’identité qu’a connus cette femme qui, au départ, s’appelle Fatima Djellal, et se nomme aujourd’hui Milène (ou Milena) Castel. Que s’est-il passé ? A partir de ce qu’il s’est joué là-dedans, l’acteur et auteur ouvre une réflexion sur l’effacement, tel qu’il peut s’inscrire au cœur même de la manière dont la langue se construit. Salim Djaferi ne donne pas de leçons – sauf à la toute fin de son spectacle, hélas, en une coda qui opère, de manière tout à coup bien simpliste, un lien avec l’actualité du conflit israélo-palestinien en cours. Ce jeune comédien français, qui a été formé au conservatoire de Liège, en Belgique, a été à bonne école en matière d’écriture documentaire, puisqu’il joue dans les spectacles de la metteuse en scène Adeline Rosenstein, devenue une figure incontournable en la matière avec ses pièces Décris-ravage et Laboratoire poison. Quant à sa manière d’aborder le plateau et le public, elle n’est pas sans évoquer le grand Nicolas Bouchaud, qui, dans l’autre salle du Théâtre de la Bastille, est de retour avec son formidable spectacle La Loi du marcheur (2010). En se mettant en scène comme une sorte de Candide toujours étonné par ce qu’il découvre, Salim Djaferi embarque les spectateurs avec lui. C’est en tirant les fils de son sujet de manière ludique, sans vouloir reconstituer une pelote trop ordonnée, que Koulounisation joue son rôle sensible et réflexif. Les glissements permanents du langage qu’il s’attache à décortiquer montrent une histoire en marche, qui ne cesse de se chercher et de se reconstruire, entre vérité et mensonge, recherche historique et idéologie. Lesquels sont souvent bien emmêlés. Koulounisation, de et par Salim Djaferi. Théâtre de la Bastille, Paris 11ᵉ. Jusqu’au 12 mai. De 15 € à 25 €. Theatre-bastille.com Fabienne Darge : LE MONDE Légende photo : Salim Djaferi, dans « Koulounisation », au Théâtre de la Bastille, à Paris, en avril 2024. JEAN-HENRI THOMAS
Par Thibaut Sardier dans Libération, le 2 mai 2024 Anciens profs et auteurs d’une précédente pièce sur l’orthographe, Arnaud Hoedt et Jérôme Piron livrent dans leur «spectacle documentaire» une réflexion drôle et documentée pour que le système scolaire cesse d’être une simple machine à trier les élèves. A l’école, Kevin n’était pas une flèche. Personne ne sait ce qu’il est devenu dans la vie (pêche-t-il sur son bateau à Bora-Bora ?), mais une chose est sûre : année après année, son orientation l’a destiné à des filières et des établissements parmi les moins sélectifs. Que Kevin ait été un peu con, Arnaud Hoedt et Jérôme Piron ne l’excluent pas tout à fait. Mais les deux anciens profs belges, connus pour un précédent spectacle sur l’orthographe – la Convivialité – et pour leur engagement en faveur d’un assouplissement des règles de la grammaire française, craignent de s’être laissés influencer par cette idée qui a peut-être été fatale au destin scolaire de Kevin. Et surtout, ils s’interrogent : pourquoi notre système scolaire est-il incapable d’être autre chose qu’une machine à trier les élèves et à décourager les plus faibles ? Année après année, constatent-ils, moins de 10 % des Kevin de terminale obtiennent une mention très bien au bac (on vous laisse deviner le score pour Marie, Sophie ou Arnaud). L’égalité des chances, cette vaste blague. Biais de profs et psychologie des élèves N’ayant rien perdu des réflexes de profs de leur ancienne vie professionnelle, Arnaud Hoedt et Jérôme Piron ont préparé un cours du soir pédago-rigolo intitulé Kevin (eux préfèrent parler de «spectacle documentaire»), qui se joue jusqu’au 11 mai au Théâtre du Rond-Point à Paris. Face à un Powerpoint géant et interactif qui va de l’école du sacré Charlemagne aux sections d’enseignement général et professionnel adapté (Segpa) d’aujourd’hui, ils déroulent les infos glanées auprès d’une flopée de sociologues de l’éducation et passent en revue les principaux points qui fâchent. Il y a bien sûr les biais des profs, et leur incapacité à noter leurs classes autrement qu’en suivant une courbe de Gauss avec quelques faibles, un gros ventre mou et une poignée de forts. Ils ont aussi tendance à oublier que ce qui est censé «aller de soi» dans un programme scolaire n’est pas forcément évident pour tout le monde. Mais il y a en retour la psychologie des élèves : celles et ceux qui bloquent plusieurs fois d’affilée sur un exercice se découragent vite, quand bien même la réponse est à leur portée. Et si vous pensez échapper à la règle, une expérience menée dans le public vous convaincra sans doute du contraire. Démonstration convaincante Mais le plus dur est ailleurs. Hoedt et Piron nous rappellent que la société demande parfois à l’école des choses qui ne relèvent pas de l’enseignement et de l’épanouissement des élèves (les deux profs ont trouvé dans un programme politique l’idée que l’école doit «faire correspondre les formations aux besoins des entreprises»). Surtout, ils reprennent tous les mécanismes socio-spatiaux qui créent des disparités entre des écoles bonnes, moyennes et mauvaises, phénomène renforcé par le développement de l’enseignement privé. «Le principal moteur de l’orientation en France, c’est l’échec», glisse Jérôme Piron. Cette démonstration, convaincante parce qu’elle sent le vécu, ouvre aussi quelques perspectives : et si enseigner en mode collaboratif, avec moins de compétition entre les élèves, était gage d’égalité ? Une autre expérience en direct avec la salle suggère que c’est le cas, à condition que tout le monde joue le jeu (ce qui n’est pas vraiment le cas… les habitudes…) : peut-être y aura-t-il quelques Einstein en moins, mais un niveau général plus homogène, supposent les deux collègues. En tout cas, bizarre d’apprécier un spectacle qui vous fait penser d’un bout à l’autre à Gabriel Attal et sa ministre de l’Education nationale, Nicole Belloubet, au point de se dire qu’ils seraient bien là, assis à se faire expliquer ce qui cloche avec les groupes de niveaux, et tout le reste. Kevin d’Arnaud Hoedt et Jérôme Piron. Au Théâtre du Rond-Point (75008) jusqu’au 11 mai. Légende photo : Année après année, constatent Arnaud Hoedt et Jérôme Piron, moins de 10 % des Kevin de terminale obtiennent une mention très bien au bac (on vous laisse deviner le score pour Marie, Sophie ou Arnaud). (J. Van Belle)
par LIBERATION et AFP le 30 avril 2024 Dans une autobiographie à paraître le 1er mai, Isild Le Besco revient sur sa relation avec le réalisateur alors qu’elle n’avait que 16 ans et lui 52. L’actrice explique qu’elle n’est pas encore prête à porter plainte, bien qu’affirmant que le réalisateur l’a «violée». Elle ne sent pas encore prête. Dans Dire vrai (éditions Denoël), une autobiographie à paraître mercredi 1er mai, Isild Le Besco explique que, pour l’instant, elle ne s’imagine pas porter plainte contre Benoît Jacquot, dont elle estime pourtant qu’il l’a «violée». Dans son livre, elle revient sur sa relation avec le réalisateur, entamée sur le tournage de Sade, alors qu’elle avait 16 ans et lui 52. «Je n’ai pas envie de me confronter encore à ces institutions poussiéreuses, pensées et régies par des hommes […] C’est déjà tellement éprouvant d’écrire. De nommer. De faire face à ses maux», décrit l’actrice de 41 ans, sœur de la réalisatrice Maïwenn. Elle dit ne pas avoir répondu aux enquêteurs de la brigade des mineurs, qui souhaitent pourtant l’entendre. «Ils me sollicitent et me sollicitent encore pour recueillir ma plainte contre Benoît Jacquot et Jacques Doillon.» Se décrivant comme une adolescente «fragile et malléable», Isild Le Besco expliquait en février les effets destructeurs qu’a eue sur elle la relation entretenue entre ses 16 ans et ses 21 ans. Elle dénonçait une relation faite de «violences psychologique» ainsi qu’une emprise que le réalisateur de 52 ans exerçait sur elle. «Être victime, oui, mais de qui ? Et de quoi exactement ? De la sexualisation de mon corps au cinéma ? Des années d’emprise de Benoît Jacquot ? Du manque d’éthique professionnelle de Jacques Doillon ?», s’interroge-t-elle dans son ouvrage. Elle complète : «Dire que Benoît m’a violée, c’est évident […] J’étais une adolescente et je lui ai donné mon entière confiance. Il s’est substitué à mon père, ma mère, à toute figure d’autorité. En cela, son viol est aussi incestueux». Toujours en février, Isild Le Besco avait déclaré qu’il était «probable qu’à un moment» elle porte plainte contre les deux réalisateurs, en réaction aux accusations portées contre eux par l’actrice Judith Godrèche. Sa plainte a déclenché l’ouverture d’une enquête à leur encontre pour «viol sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité», et lancé un débat public sur les violences sexistes et sexuelles faites aux mineurs dans le cinéma. Si les deux réalisateurs nient toute accusation de relations non consenties, Jacques Doillon va plus loin, se disant victime de «mensonges», et en «mort sociale». Légende photo : Isild Le Besco, le 12 juin 2020. (Dominique Charriau/WireImage)
Publié dans Sceneweb le 30 avril 2024 Marie Lenoir et Thomas Quillardet prennent la direction du Festival Paris l’été à compter de septembre 2024. Ils succèdent à Laurence de Magalhaes et Stéphane Ricordel, qui tireront leur révérence lors de l’édition 2024 du festival (du 3 au 16 juillet) après huit années. La nouvelle direction a proposé un projet artistique qui, dans la continuité de l’actuel festival, proposera une diversité de formes esthétiques, tournées essentiellement vers les arts du mouvement et de nombreux spectacles en itinérance. Elle aura à cœur de mettre davantage l’accent sur le nomadisme, l’espace public devenant le principal espace de jeu. Elle entend par ailleurs jumeler le festival avec une ville du monde pour créer la rencontre sur le temps long, permettre les échanges avec les publics et entre les cultures. Le nouveau format du festival, qui doit s’étaler progressivement sur l’été, entre juillet et août, accueillera des artistes émergents et reconnus, signera le grand retour du cabaret et donnera la part belle aux initiatives en matière d’éducation artistique et culturelle tout au long de l’année. Directrice de production et de diffusion de la compagnie « 8 avril », Marie Lenoir est aussi, depuis 2017, responsable de l’accueil des publics et des professionnel·les du festival Paris l’été. Après une Maitrise d’Histoire Culturelle, Marie Lenoir démarre sa vie professionnelle comme attachée de presse jazz au sein du bureau de presse du Nice Jazz Festival de 2003 à 2006. Puis en 2007, elle participe avec Armelle Hédin à la création du bureau de production Avril en Septembre et prend en charge pendant dix années le développement, la communication et la diffusion d’une quinzaine d’artistes (Les Sea Girls, Le Cirque des Mirages, La Française de Comptages, Khalid K etc).
De 2015 à 2018, elle rejoint la Compagnie Veilleur, dirigée par Johanna Silberstein et Matthieu Roy en tant que directrice des productions et des tournées.
Depuis 2018, elle est à la direction de la production et diffusion de la Compagnie 8 avril (soutenue par la Drac Ile-de-France Ministère de la Culture au titre du conventionnement et par la Région Ilede-France au titre de la Permanence artistique et culturelle), aux côtés du metteur en scène Thomas Quillardet. Elle accompagne aussi le développement d’équipes artistiques plus émergentes comme le Collectif NightShot, le Collectif 18.3 et la Compagnie Biceps de Laureline Le Bris Ceps. Artiste, Thomas Quillardet est metteur en scène et directeur artistique de la compagnie « 8 avril ». Après une formation de comédien, Thomas Quillardet se consacre à la mise en scène et crée en 2004 Les Quatre Jumelles de Copi. En 2005, dans le cadre de l’année du Brésil, il organise à Paris le Festival Teatro em Obras. De 2006 à 2014, il rejoint le collectif théâtral Jakart/Mugiscué. En 2007, il monte au Brésil dans le cadre de la Villa Médicis-hors-les murs un diptyque de Copi, Le Frigo et Loretta Strong. En 2008, il met en scène Le Repas de V. Novarina. En 2009, dans le cadre de l’année de la France au Brésil, il crée à Rio de Janeiro L’Atelier Volant de V. Novarina. En 2010, il met en scène avec Jeanne Candel Villégiature d’après Goldoni. En 2012, il monte Les Autonautes de la Cosmoroute d’après J. Cortázar et C. Dunlop à La Colline et Les Trois Petits Cochons au Studio-Théâtre de la Comédie-Française.
En 2015, il fonde la compagnie 8 AVRIL, Où les cœurs s’éprennent, adaptation de Les Nuits de la pleine lune et Le Rayon vert d’Éric Rohmer, puis en 2017, il monte Tristesse et joie dans la vie des girafes de Tiago Rodrigues au Festival d’Avignon. En 2019, pour le Festival d’Automne cette fois, il met en scène Ton père d’après le roman de Christophe Honoré. En 2021, il met en scène L’arbre, le Maire et la Médiathèque, adaptation du scénario d’Eric Rohmer et Une Télévision française. En octobre 2023, dans le cadre du Festival d’Automne à Paris, Thomas Quillardet met en scène et interpréte En Addicto, récit de son expérience à l’issue de six mois de résidence artistique dans un service d’addictologie.
Le Festival Paris l’été est soutenu par la Ville de Paris, la DRAC Ile-de-France et la Région Ile-de-France. Il propose chaque année de nombreux rendez-vous artistiques et culturels, dans tout Paris et sa région. Théâtre, danse, cirque, musique, performances et installations plastiques s’emparent de nombreux lieux connus ou insolites de la capitale et en région, le plus souvent en plein air et en dehors des lieux traditionnels de spectacle. 30 AVRIL 2024 PAR DOSSIER DE PRESSE - publié par Sceneweb
Propos recueillis par Julia Wahl dans cult.news 28.04.2024 Valérie Dassonville : « Ce qui est intéressant dans Vis-à-vis, c’est que c’est vraiment un projet qui fait se rencontrer ensemble un nombre d’acteurs considérable pour la construction d’un objet et d’un espace commun » Valérie Dassonville nous parle de l’édition 2024 de Vis-à-vis, festival des créations en milieu carcéral, qui se déroulera au Paris-Villette du 2 au 5 mai.
- Le festival Vis-à-vis est un festival de type particulier, puisqu’il travaille avec des personnes en situation d’incarcération. J’imagine que cela suppose un travail partenarial particulier. Pouvez-vous m’expliquer comment vous le mettez en place ? Vis-à-vis est un temps fort de la création artistique carcérale. Ce que l’on entend par temps fort de la création artistique carcérale, c’est qu’on est vraiment sur le fait d’accueillir quelques jours des projets de création partagée, c’est-à-dire des équipes artistiques pluridisciplinaires (théâtre, danse, marionnette, mais aussi chanson) qui vont travailler sur des créations avec une partie d’acteurs et de techniciens professionnels et vont convier pendant tout le processus de création des amateurs sous main de justice. On est vraiment dans un travail de création à part entière avec cette spécificité que les artistes vont travailler en détention et accueillir dans leur projet des amateurs sous main de justice. Pour autant, le geste de création est le plus professionnel et le plus professionnalisant possible. Il est donc dans son objectif de se produire, de se répéter et de se diffuser. C’est là que Vis-à-vis se construit : accueillir ses œuvres au plateau, dans un théâtre, équipé (donc dans des conditions professionnelles scénographiques) et devant un public. Après, oui, ça demande des partenariats spécifiques. Mais Vis-à-vis est plutôt un protocole qui va englober un certain nombre d’acteurs de la culture et de la justice, notamment l’administration pénitentiaire, la magistrature, les services pénitentiaires d’insertion et de probation et à travers eux les coordinatrices et coordinateurs culturel∙les. On va travailler avec des personnes sous main de justice qui ont des parcours pénaux différents. On va devoir travailler avec les règles de l’administration pénitentiaire, son fonctionnement et en même temps on va tous devoir trouver du commun là-dedans pour que tout converge vers Vis-à-vis et mettre en commun avec le public tout ce travail-là. À propos des règles de l’administration pénitentiaire, qu’en est-il de ce que l’on peut apporter en prison ? Est-ce que cela complexifie la recherche d’artistes acceptant de s’y soumettre ? On peut apporter ce qu’on veut, à partir du moment où on a une liste qui est validée par l’administration pénitentiaire. Cette liste est contrôlée quand vous entrez en détention. Il y a aussi la possibilité de laisser des choses sur place. Il y a des tournages qui se font aussi en détention, donc vous faites entrer des ordinateurs des caméras… Il y a un projet par exemple au centre pénitentiaire de Meaux qui est un projet chanson avec des instruments de musique et des ordinateurs pour tout ce qui est MAO. À partir du moment où vous suivez le système de la validation, vous pouvez faire entrer tout ce que vous voulez. Je ne peux pas répondre de façon exhaustive [à la dernière question]. Je connais pour ma part beaucoup d’artistes qui travaillent en milieu carcéral, mais ce sera une réponse très partielle. Dans le cadre de Vis-à-vis en tout cas, qui est un tout petit élément d’information, il y a de plus en plus de compagnies qui créent des projets ambitieux en détention. Pour vous donner l’exemple de cette année, on est à quatre jours de festival et comme il y a deux projets plateau par soir, on est à huit propositions d’artistes qui vont travailler en détention dans les conditions les plus professionnelles possibles et on aurait pu en avoir d’autres sans problème. Je demande un projet par établissement pour faire une sélection qui n’est pas une sélection artistique puisque ce sont des projets présentés par les coordinatrices culturelles. Moi je n’exerce pas de direction artistique : à partir du moment où on s’est mis d’accord sur ce qu’est une création partagée et où tout le monde l’a compris, je valide les choix que me font les coordinateurs de travailler avec telle ou telle équipe. Du coup, c’est vraiment un travail de collaboration et de confiance. Après, oui, les contraintes de de la création en milieu carcéral font que tout le monde n’y va pas, que tout le monde ne peut pas y aller, que tout le monde ne veut pas y aller, mais ça c’est vrai de façon générale. C’est-à-dire qu’il y a des compagnies qui adorent la médiation culturelle, d’autres pas. Il y a des compagnies qui adorent créer hors les murs et d’autres pas. L’évolution du protocole culture justice et du lien entre les artistes et l’administration pénitentiaire fait que j’ai le sentiment que cela se développe. Ça se développe, ça se professionnalise. On a beaucoup d’exemples d’artistes reconnus comme Joël Pommerat ou Olivier Py, comme Pascal Rambert, qui ont travaillé ou qui travaillent, qui sont très impliqués dans la création carcérale et il y en a aussi beaucoup beaucoup de moins emblématiques, mais qui font un travail formidable. Et Vis-à-vis, c’est l’occasion de voir ça, parce que le grand public n’a pas conscience de ça. Quand vous parlez de professionnalisation, est-ce que cela concerne également les détenus une fois qu’ils sortent des murs, est-ce qu’il y en a un certain nombre qui en font leur métier ? Oui et non. Je ne peux pas vous répondre de façon exhaustive et ce n’est pas ou tout noir ou tout blanc. Alors, quand je parle de professionnalisation, je ne parle pas de l’après : je parle déjà des projets. Ces créations, elles sont pour les artistes professionnalisant dans la mesure où ils vont chercher de la production et de la diffusion comme ils le feraient pour d’autres créations. C’est pas un pas de côté : c’est pas parce qu’on travaille en prison, qu’on n’est pas en création. Donc c’est déjà faire que les artistes considèrent leur geste de création comme un geste professionnel. C’est professionnalisant pour les personnes y compris sous main de justice dans l’expérience de création partagée, c’est-à-dire qu’il travaille avec des professionnels, aux côtés de professionnels, dont l’ambition d’une création qui va être diffusée devant un public qui va payer sa place. Éventuellement il y aura d’autres dates et dans certains cas, tout le monde est sous contrat et tout le monde est payé. Déjà, cette expérience là, même si ce sont des gens qui ne deviendront pas comédiens, pas danseurs et pas metteurs en scène, l’expérience qu’ils auront eu dans le cadre de leur peine de prison, va être professionnalisante parce qu’elle va être vécue comme un engagement professionnel. Ensuite, est-ce que certains d’entre eux vont avoir envie de continuer ? Non, pas tous bien sûr. Il y en a à qui ça ouvre des imaginaires et des possibilités de découvrir des métiers et des envies tout simplement. Et là, c’est difficile de vous faire un tableau complet, parce qu’il y a autant de cas que de personnalités, mais il y a des artistes et des lieux qui s’engagent dans le suivi auprès de certaines personnes qu’elles auraient rencontrées en détention. Encore une fois, le plus emblématique c’est Joël Pommerat parce qu’il fait quelque chose de très rare : il s’est engagé, et il le fait, à accueillir les amateurs sous main de justice avec lesquels il a travaillé à la maison centrale d’Arles dans sa compagnie Louis Brouillard donc je crois qu’il a trois ou quatre comédiens permanents et qui intègrent les créations de la compagnie. Vous avez d’autres metteurs en scène, comme Olivier Fredj qui a continué avec à travailler avec des amateurs sous main de justice, y compris après leur sortie et sur le long terme ; et il y a des personnes qui vont intégrer des chantiers de formation comme Lucane qui fait de l’insertion professionnelle par les métiers du spectacle, artistiques, techniques et administratifs. Après, ce qui manquerait peut-être, c’est une structure ressource qui centraliserait des informations, des contacts, des mises en réseau. Vous avez dit tout à l’heure : « Ce n’est pas un pas de côté, c’est un geste professionnel ». Du coup, êtes-vous uniquement financé∙es sur des lignes budgétaires de type culture-justice ou action culturelle au sens large, ou êtes-vous aussi financé∙es sur des lignes budgétaires de création ? C’est l’objectif. Quand on parle de pas de côté c’est-à-dire qu’on va soutenir les artistes mais aussi les enfermer par la question justement des lignes budgétaires et les cases budgétaires parce que là aujourd’hui les artistes produisent avec les politiques interministérielles : il y a d’un côté les SPIP qui mettent de l’argent dans la culture en détention et de l’autre côté la DRAC, mais pas la DRAC aide aux projets et les services liés au théâtre, mais la DRAC action territoriale et politique interministérielle. Donc, ce ne sont pas les mêmes montants et ce ne sont pas les mêmes critères d’éligibilité. Après, il y a d’autres partenaires qui viennent se greffer là-dessus avec des collectivités et du mécénat avec des fondations et des partenaires que les compagnies apportent. Par exemple, il y a des compagnies conventionnées qui prennent sur une partie de leur conventionnement pour mener ces projets. Donc là, c’est bien de l’argent de la culture, mais qui transite par les compagnies. On a eu le cas un jour de l’Iliade [création 2017 de Alessandro Baricco avec le Centre pénitentiaire de Meaux], qui est un projet qui s’est créé dans le cadre de Vis-à-vis et qu’on a souhaité développer et en faire vraiment une création pour que le Paris-Villette l’accueil au sein de sa programmation. Et on s’est heurté à beaucoup de murs un peu étanches et d’institution qui nous disaient que c’est un projet avec des détenus amateurs et que ce n’est donc pas éligible par exemple à l’aide au projet de la DRAC. Là on a creusé en disant : « Ah bon mais pourquoi ? Parce qu’il y a des amateurs au plateau. Ah bon, mais dans ce cas, Pommerat quand tu le fais Ça ira c’est pas professionnel alors parce qu’il y a quand même 50 amateurs dans Ça ira. Quand Didier Ruiz travaille avec des amateurs, c’est pas professionnel ; quand Jérôme Bel travaille avec des amateurs, c’est pas professionnel. » Donc, l’argument nous paraissait quand même extrêmement douteux et ils ont dû en trouver un autre. Ils nous ont dit : « Oui, mais vous n’avez pas deux lieux partenaires. » « Mais si on a le Paris-Villette pour une dizaine de dates et on a le centre pénitentiaire. » Donc, je les ai cherchés un peu, je les ai poussés dans leurs retranchements. Finalement, on a trouvé un deuxième lieu, c’est Mains d’œuvre qui s’est porté candidat pour accueillir une diffusion supplémentaire de l’Iliade. Du coup il a été éligible et il y a eu l’aide au projet à l’unanimité. Et puis Arcadi [Action régionale pour la création artistique et la diffusion en Île-de-France, dissous en 2018] est venu dessus et puis la ville de Paris a mis de l’argent : il y a eu finalement un projet de 130.000€ de production. Il y avait quinze comédiens au plateau, tout le monde était sous contrat, tout le monde était payé et le spectacle a tourné pendant deux ans. Et nous, ça a été un des plus gros succès du Paris-Villette en cinq ans. Alors, à partir du moment où on est allé jusque-là, on est entré dans la question de la création (dans laquelle je suis bien consciente que le nombre de dates de diffusion doit entrer en ligne de compte) et c’est bien là que c’est compliqué : beaucoup d’acteurs culturels ne comprennent pas ou alors font semblant de ne pas comprendre que ces projets là peuvent tourner. Une personne qui est en détention, à partir du moment où elle a des autorisations d’aménagement de peine, elle peut, à chaque fois qu’il y a une date, faire une demande de permission de sortie dans le cadre de son travail. Des six détenus longue peine qu’il y avait dans l’Iliade, il y en a un qui était incarcéré jusqu’à la fin. Donc, pendant deux ans, à chaque fois qu’il y a eu des dates, il est sorti. Donc c’était un peu compliqué, je vous l’accorde, mais c’est possible. Cet environnement professionnel, pour qu’il soit recréé il faut que tout le monde joue le jeu. Avez-vous pu reproduire l’exemple de l‘Iliade sur d’autres propositions ? La première chose, c’est que ces fameux programmateurs culturels, ils étaient absents lors de la première édition du projet et, huit ans plus tard, presque chaque projet a un second partenaire culturel. Par exemple, pour la première fois, le théâtre Louis Aragon de Tremblay-en-France est partenaire du projet mené avec l’une de ses artistes en résidence. Il y a eu de l’argent, il y aura Vis-à-vis et il y aura une date au TLA. Ce format là, ça commence à se développer : Claire Jenny, chorégraphe, a une date aux Ateliers de Paris Et elle va jouer aussi au théâtre Jean-Vilar de Vitry-sur-Seine. Cette année, on a quelque chose de très intéressant : c’est le Hall de la chanson, c’est un centre national du répertoire de la chanson française qui se situe derrière la Grande Halle de la Villette, qui est donc conventionné en direct par la DGCA, qui a une école dont ils ont délocalisé un cycle entier de deux mois en détention (avec le centre pénitentiaire de Meaux) et ils ont accueilli dans ce cycle pédagogique un groupe de huit personnes sous-main de justice. Ce projet là, ils l’aboutissent pour Vis-à-vis, mais du coup ça devient une création qui entre au répertoire du centre national de la chanson – un projet sur le répertoire de Charles Aznavour qui était parrain de l’école -. Ce projet est créé à Vis-à-vis mais est repris trois fois après au hall de la chanson dans le cadre de sa création et de sa diffusion et il est disponible en tournée. Alors précisément, le Hall de la chanson est un partenariat tout nouveau : qu’est-ce qui a présidé au choix d’étendre les différentes propositions à la musique et à la chanson ? Déjà, ça reste du spectacle vivant. Mais c’est surtout que, comme je vous le disais, moi je n’exerce aucune direction artistique. En revanche, il peut m’arriver de faire se rencontrer les uns et les autres. C’est-à-dire que j’ai beaucoup d’artistes qui viennent me voir en me disant : « Je suis intéressé.e par les projets créations en milieu carcéral ; est-ce que tu peux m’expliquer comment ça se passe ? » Ça fait partie aussi de mes missions de développement de ce projet et là, le Hall de la chanson, je les connais bien parce qu’ils sont sur le parc de la Villette. Donc, à un moment je leur ai demandé : est-ce que ça vous dirait de réfléchir à un projet de création en milieu carcéral ? Ils m’ont dit oui. À ce moment-là je leur ai demandé de réfléchir à un projet et je leur ai fait rencontrer la coordinatrice culturelle de Meaux. Là, ils se sont rencontrés, ils ont échangé sur un projet possible et à partir de là j’ai laissé faire. Donc c’est pas un choix de la musique en particulier même s’il est vrai que ça m’intéresse beaucoup parce que la chanson au plateau, c’est quelque chose d’assez rare mais c’est aussi un mouvement artistique que j’identifie comme revenant beaucoup sur les scènes en ce moment. Outre la chanson, quelles seraient d’après vous les autres spécificités de cette édition 2024 ? On va accueillir un projet qui s’est monté entre le centre pénitentiaire de Caen et le centre dramatique national de Caen. C’est la première fois qu’on va accueillir un projet de Normandie en revanche, Vis-à-vis a toujours accueilli des projets d’une autre région. Jusqu’à présent c’était la région PACA : on a accueilli Antigone monté par Olivier Py avec le centre pénitentiaire du Pontet, on a accueilli la captation de Joël Pommerat, on a accueilli un projet monté avec le centre pénitentiaire d’Aix… Cette ouverture sur d’autres territoires a permis de conventionner le théâtre Paris-Villette avec le ministère de la justice et le ministère de la culture pour le rayonnement d’un développement national de Vis-à-vis. Maintenant, c’est officiel, je peux aller répliquer le protocole Vis-à-vis sur d’autres régions. On en a fait un pilote en 2023 à la scène nationale de Châteauvallon et ça s’est très bien passé. À partir de ces expérimentations là, ça devient un projet de développement national. Donc il est possible qu’il y ait une deuxième édition en PACA en 25 et on commence à réfléchir à une première édition en 2026 en Normandie. Avez-vous déjà des idées de partenaires en PACA en 2025 ? Oui, parce que la grande intelligence de la scène nationale de Châteauvallon ça a été de dire nous on accueille la première édition mais ce serait bien qu’on tourne. Donc, quand on a travaillé pendant deux ans cette première édition à Châteauvallon, on a invité d’autres partenaires culturels (la friche Belle de mai, le ZEF, la Criée, le théâtre Durance, le festival d’Avignon) et toutes ces équipes ont suivi la construction à Châteauvallon. Du coup, quand on a parlé de la deuxième édition, on avait déjà des lieux et des équipes. Là, on est en train de construire avec Avignon pour 2025. Ce n’est pas du tout sûr : on vérifie le principe de faisabilité, mais le directeur Tiago Rodrigues est tout à fait enthousiaste à l’idée de le faire. Ça ne se passerait pas pendant le festival, mais à la rentrée à la FabricA et avec l’équipe du festival. Et la Criée se propose de faire la troisième édition. Pour la Normandie, je pense qu’on va travailler de la même façon : on a le CDN de Caen qui est très intéressé par l’accueil d’une première édition et on pourra aussi rencontrer d’autres partenaires culturels pour élargir la question. Ce qui est intéressant dans Vis-à-vis, c’est que c’est vraiment un projet qui fait se rencontrer ensemble un nombre d’acteurs, considérable pour la construction d’un objet et d’un espace commun. Alors dans l’édition du Paris-Villette il n’y a pas que du spectacle vivant, puisqu’il y a aussi des installations, des créations sonores et des vidéos : qu’est-ce que cela apporte d’après vous ? On a ouvert dans la mesure du possible à des créations cinéma, podcast ou arts plastiques parce qu’on a des établissements pénitentiaires qui ne peuvent pas jouer le jeu du spectacle vivant parce qu’il y a des établissements où il n’y a pas de permissions de sortie. Donc, je me suis dit : « Si on peut accueillir ces projets là, à condition que ce soit bien de la création partagée, pourquoi pas ? » donc on demande aux coordinateurs et coordinatrices de nous faire remonter des propositions et là c’est vraiment dans un cadre programmatique c’est à dire quelle surface d’exposition on a, combien de projets on peut accueillir ? Et pour ce qui est des capsules vidéo ou son, quand c’est très long, on crée des QR codes et on renvoie le public qui le souhaite à l’écoute, et quand c’est court, on le met en ouverture de soirée. Le film d’animation qui a été fait avec des plasticiens et des personnes sous main de justice de Fleury-Mérogis, il est génial ! Il dure cinq ou six minutes, ça aurait été dommage de pas le montrer. Pouvez-vous nous présenter rapidement la programmation de cette édition ? Toutes les soirées commencent à 19h00 et ça se termine vers 22h30 maximum. Pour les personnes qui souhaiteraient réserver, il faut réserver pour la vie entière. Jeudi, en première partie, vous avez Cette compagnie là, avec Antony Quenet, qui travaille avec le centre pénitentiaire de Melun, Encore la fin du monde. En deuxième partie, vous avez le projet Blossom de la compagnie Kilaï qui travaille avec le théâtre Louis-Aragon et le centre pénitentiaire de Villepinte. Ça, c’est de la danse. Et on aura un tout petit podcast qui sera diffusé en première partie, réalisé avec la centrale de Poissy et l’association AR Extrême. Pour le vendredi il y aura deux podcasts, un clip de rap toujours avec Poissy et le petit film d’animation dont je vous ai parlé. Au plateau, il y a le projet Méduse, dont je vous ai parlé, avec le centre pénitentiaire de Caen et le centre dramatique national de Caen, et comme artistes : Fanny Catel et Raoul Fernandez. C’est un projet qui a déjà été créé et joué au CDN de Caen. En deuxième partie, il y a Je t’épouserai, allégorie du REICKO par la compagnie du Reicko. C’est un projet très beau. C’est de la danse et de la vidéo avec le centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis. Le samedi, il y a Ici et là de la compagnie Virgule, avec Claire Jenny, qui travaille aussi avec le CDCN de l’Atelier de Paris et le centre pénitentiaire Sud-Francilien. La particularité du travail que mène Claire, c’est qu’elle mélange des danseurs professionnels, des amateurs éclairés avec lesquels elle travaille depuis des années et des amateurs sous main de justice, hommes et femmes. Ce sera suivi de la compagnie Nar6, qui va mener un projet de théâtre à partir de la nouvelle de Jack London « Le Ring » et qui travaille avec le centre pénitentiaire de Fresnes. Et on termine dimanche avec le projet Et pourtant… sur le répertoire de Charles Aznavour avec le hall de la chanson, son école et le centre pénitentiaire de Meaux suivi de Sombrero qui va être une création d’artistes plasticiens performateurs, Julien Perez et Thomas Cerisola. Ils montent une création sonore et théâtrale autour de la question du match de foot. J’ai hâte de le voir parce que je n’ai toujours rien compris à ce projet mais il a l’air passionnant. C’est la création d’une bande son d’un match fait en direct. Ça, c’est le centre pénitentiaire de Paris La Santé. On est donc sur huit projets plateau, deux expo. peinture-arts plastiques, il y a trois projets vidéo et un podcast d’une émission de radio. Julia Wahl / cult.news Festival Vis-à-vis, Théâtre Paris Villette, du 2 au 5 mai 2024. Visuel : Valérie Dassonville – ©Ulysse Chaffin
|
Par Joëlle Gayot dans Le Monde - 13 mai 2024 Le texte corrosif du dramaturge néerlandophone, qui met face à face deux couples de comédiens, est mis en scène par Aurore Fattier au Théâtre 14, à Paris.
Lire l'article dans le site du "Monde" :
https://www.lemonde.fr/culture/article/2024/05/13/dans-qui-a-peur-tom-lanoye-passe-le-theatre-belge-a-la-moulinette_6232967_3246.html
Le théâtre belge contemporain va-t-il si mal qu’il en est au point où la seule possibilité qui lui reste est une autoflagellation sans filtre ? Au Théâtre 14, à Paris, Aurore Fattier met en scène, avec énergie mais quelques maladresses, Qui a peur, un texte corrosif, retors, dérangeant et, pour toutes ces raisons, intrigant de Tom Lanoye. Né en 1958, ce solide auteur néerlandophone (qui a adapté Shakespeare et travaillé sur les figures de Médée ou de Méphistophélès) est un explorateur des parts maudites de l’être humain. Le monstrueux ne lui fait pas peur. Il ne prend d’ailleurs pas de gants avec les héros de sa pièce. Sur le plateau protégé par un tulle (où s’inscrivent d’incertaines projections en noir et blanc de leurs visages filmés en gros plan), pas un des protagonistes n’inspire la sympathie. Ce qui n’est pas pour déplaire. Dans Qui a peur, le dramaturge place face à face deux couples de comédiens fictifs. Cultivant le trouble jusqu’à donner à ses personnages le prénom de leurs interprètes, il précipite le quatuor dans un conflit diaboliquement pensé qui entremêle considérations politiques sur le théâtre comme il va (mal) et affrontement de générations d’acteurs que tout sépare, sauf un pressant besoin d’argent. Les joutes verbales s’accomplissent sur fond d’une mise en abyme du théâtre dans le théâtre que l’auteur entretient jusqu’au vertige. Impossible de savoir si ce qui se dit est un leurre ou la vérité, si celui qui parle joue un rôle ou ne le joue pas. Entre la fiction et la réalité, les lignes fluctuent. Entre hystérie et perversité En scène dès le début du spectacle, le duo Claire (Bodson) et Koen (De Sutter). Deux quinquagénaires usés jusqu’à la corde qui n’en peuvent plus de tourner depuis des années dans des salles miteuses le blockbuster d’Edward Albee, Qui a peur de Virginia Woolf ?, qui donne la moitié de son titre à la pièce de Lanoye et en inspire l’état d’esprit de A à Z. L’ambiance flotte entre hystérie et perversité, domination et humiliation. Ce recyclage du drame américain est habile, même s’il laisse songeur quant aux limites esthétiques du décalque effectué depuis l’original datant de 1962. Edward Albee organisait la confrontation dévastatrice entre un couple manipulateur et alcoolique et un universitaire brillant et ambitieux, flanqué de son épouse écervelée. Tom Lanoye, pour sa part, positionne dans l’arène des comédiens n’ayant que le théâtre à la bouche, quand bien même celui-ci leur promet une vie où chaque épiphanie créative va se payer au prix fort. Le cynisme (ou le désespoir) de Claire et Koen est tel que, recrutant deux partenaires pour finaliser leur distribution, ils les choisissent non pour leur talent mais pour leur couleur de peau. Qui dit diversité sur le plateau dit aussi subventions de l’Etat. Tom Lanoye ne louvoie pas avec les vérités, et son constat d’un théâtre subventionné belge en piètre santé fait froid dans le dos. Voici donc Leïla (Chaarani) et Khadim (Fall) qui, venus passer l’audition, se retrouvent précipités dans un jeu de dupes. Ils n’en comprendront que tard les tenants et les aboutissants, après des salves d’échanges acérés opposant leur conception militante, postcolonialiste et utopiste de l’art à celle, désenchantée, paternaliste, voire raciste, de leurs aînés. L’auteur, un orfèvre de la dialectique, prend un malin plaisir à allumer des feux, puis leurs contre-feux en désamorçant constamment les tensions naissantes. L’issue de la représentation ne laisse pas de place au doute : qu’ils soient aguerris ou débutants, les saltimbanques sont prêts à tous les compromis. Ce n’est plus l’art dans sa pureté qui les guide, mais la précarité économique de leur quotidien. Le public, qui, dans l’absolu, ne devrait jamais savoir sur quel pied danser, tant il est soumis au flux et au reflux de postulats qui s’entrechoquent, se heurte malheureusement à des interprètes qui livrent d’emblée les clés de leurs personnages respectifs et oublient la finesse d’incarnation qu’appelle cette dramaturgie. Pas assez de profondeur dans des proférations qui se déclinent sur une seule note. Seuls les jeunes accèdent à une forme de nuance. Mais cela ne suffit pas à extirper la pièce d’une dimension psychologique réductrice (alors qu’elle vaut clairement mieux que ça), ni à gommer ce sentiment diffus que, face à soi, sur la scène, se déploie, en bout de course, un entre-soi de théâtreux infréquentables qui se contemplent en s’autoflagellant. Qui a peur, texte de Tom Lanoye mis en scène par Aurore Fattier. Avec Claire Bodson, Leïla Chaarani, Koen De Sutter, Khadim Fall. Théâtre 14, 20, avenue Marc-Sangnier, Paris 14e. Jusqu’au 25 mai. Mardi, mercredi et vendredi à 20 heures, jeudi à 19 heures, samedi à 16 heures. De 10 € à 25 €. Theatre14.fr Joëlle Gayot / LE MONDE Légende photo : Claire Bodson et Koen De Sutter dans « Qui a peur », de Tom Lanoye, mis en scène par Aurore Fattier, au Théâtre 14, à Paris. PRUNELLE RULENS
Par Rosita Boisseau dans Le Monde 12 mai 2024 A 21 ans, le performeur franco-algérien autodidacte, qui enchaîne les projets depuis ses 14 ans, est à l’affiche de « Plutôt vomir que faillir », de Rébecca Chaillon, et de « Cabaret Khalota », de David Wampach.
Lire l'article sur le site du "Monde" : https://www.lemonde.fr/culture/article/2024/05/12/zakary-bairi-un-comedien-mu-par-le-desir_6232839_3246.html
Zakary Bairi ne compte plus les kilos de purée de pomme de terre qu’il a ingurgités pour les besoins de la cause. La cause ? Celle du spectacle Plutôt vomir que faillir, dont le titre vous projette illico au bord des toilettes régulièrement récurées sur le plateau. Créée en 2022 par la metteuse en scène et performeuse Rébecca Chaillon, cette pièce nerveuse sur l’adolescence, l’identité, le genre et la nourriture compte déjà 114 représentations et des dizaines de sachets de flocons déshydratés. « Plus de quatre cents saladiers de purée pour le moment, car je mange vite, et j’ai parfois le hoquet en parlant en même temps, déclare Zakary Bairi, tout sourire. Une chose est sûre, je ne peux plus voir une assiette de rosbeef-purée au restaurant. Sans compter que j’avale aussi du ketchup, de la moutarde, et que j’ai des boutons sur le torse. » Faire la connaissance de Zakary Bairi autour d’un café en hiver, le rencontrer au printemps entre un jus d’orange et un verre de vin blanc, promet au moins deux choses : passer de très bons moments et repartir en pleine forme après chaque conversation. Entre anecdotes existentielles, commentaires artistiques et tirades inopinées tirées du solo Klein, conçu en 2020 autour d’Yves Klein par la chorégraphe Olivia Grandville, le jeune homme, qui a fêté ses 21 ans le 14 avril, aime se raconter. « Au début, je ne parle pas trop et, une fois lancé, je ne sais plus m’arrêter », reconnaît-il. Il faut dire qu’avec déjà sept ans de travail derrière lui auprès d’artistes de tout poil, ce fan d’ Alain Cuny, de Gérard Philipe et de Jacqueline Maillan ne manque pas de munitions. « Parfois, j’ai l’impression d’avoir 70 ans et je me sens très vieux, poursuit-il . Je suis tiraillé entre ma vie d’adulte et le fait que je me sente encore ado. J’ai beaucoup de chance, le luxe de vivre mon désir. Même si je ne me sens pas légitime, car je ne sors pas d’une école, comme certains. » Syndrome d’illégitimité Un coup d’œil sur son agenda gomme pourtant vite le syndrome d’illégitimité de celui qui « traverse les formes ». Théâtre, danse, performance, vidéo, il enchaîne les projets et rêve de cinéma. Parallèlement à la tournée de Plutôt vomir que faillir, où il irradie auprès de trois comédiens aussi épatants que lui, il va participer à un spectacle de cabaret intitulé Khalota, avec le chorégraphe David Wampach, connu pour ses expériences extrêmes. « Je serai présentateur avec mon amie la chanteuse Dalila Khatir, indique Zakary Bairi. Nous allons travailler à partir de slogans des manifestations algériennes de ces dernières années. » En ligne de mire de l’automne, les répétitions d’Edouard III, de Shakespeare, avec le metteur en scène Cédric Gourmelon. « Ce sera la première fois que j’interpréterai un classique, encore jamais monté en France », se réjouit-il avec gourmandise. Zakary Bairi est né et a grandi à Pessac (Gironde), près de Bordeaux. Père algérien et mère française. Il a une sœur aînée, Anissa, et un petit frère, Ilhan, handicapé, de sept ans plus jeune que lui, dont la naissance et les difficultés ont concentré l’attention maternelle. « Je me suis mis à faire l’intéressant pour attirer les gens, confie-t-il. Je jouais tout le temps, je me déguisais… » Le regard qui sauve est celui de la grand-mère maternelle, Michèle, qui entend le désir brûlant de son petit-fils de faire du théâtre et l’encourage à s’inscrire à l’atelier de son collège. « Elle m’a également abonné au magazine L’Avant-Scène, glisse-t-il. J’étais assez déprimé ado et le théâtre est la seule raison pour laquelle je suis resté vivant. » Il a 14 ans lorsqu’il auditionne pour la pièce Cheptel, conçue en 2017 avec des adolescents par Michel Schweizer. « Je jouais un peu trop comme “Au théâtre ce soir”, que je regardais sur YouTube, mais Michel m’a engagé quand même, raconte-t-il. On a tourné pendant quatre ans. Je voyageais, je gagnais de l’argent, je n’allais pas souvent au lycée. J’ai commencé à me gaver de spectacles et à aller au théâtre régulièrement. » Quant à Michel Schweizer, il se rappelle que « Zakary détonnait parmi les autres par sa maturité intellectuelle et émotionnelle ». Il ajoute : « C’est un phénomène. Ça va très vite pour lui, car c’est vital. Il a un élan relationnel incroyable et ne veut rien rater. Il possède une lucidité sur la vie et le milieu assez rare pour un jeune de son âge. » Talent et persévérance Comment fonctionne donc Zakary Bairi, nourri à YouTube et grand lecteur depuis l’enfance, qui semble déjà connaître toute la planète spectacle de France ? « J’écris des mails aux personnes que je rêve de rencontrer. J’adore écrire, c’est mon truc », dit-il. Il a 16 ans lorsqu’il prend contact avec Marie-Noëlle Genod, avec qui il entretient une correspondance pendant deux ans avant de jouer dans une performance au Carreau du Temple, à Paris. « Vous parlez aussi bien que vous écrivez », le complimente Genod, qui le fait improviser au milieu de cent danseurs. Quelque temps plus tard, il lui propose de lire le Kama-sutra avec l’accent arabe pour Ainsi parlait Kamasutra (2021). A 17 ans, en janvier 2021, Zakary Bairi envoie une lettre ouverte à Jean-Michel Blanquer, alors ministre de l’éducation nationale, publiée dans Mediapart, dont le contenu trouve un écho chez le chorégraphe François Stemmer. « Et on parle, on parle, on parle », se souvient-il. Jusqu’à la création, en 2022, de RIMB, sur Rimbaud. De ces années de jeunesse, Zakary Bairi a conservé des soutiens plus qu’indéfectibles. A 12 ans, il participe au festival Les Toiles filantes, piloté par le cinéma Jean-Eustache, à Pessac. Il fait partie du jury d’enfants et visionne des films pendant une semaine. C’est là qu’il croise Florence Lassalle, conférencière et au conseil d’administration du cinéma. « Il donnait son opinion avec beaucoup de précision et a suivi deux éditions du festival, souligne-t-elle. On est devenus amis et je l’ai emmené au théâtre. Zakary sait se faire aimer, et rencontrer quelqu’un comme lui n’arrive pas souvent dans une vie. » Mais ce réseau ne serait rien sans talent ni persévérance. Celui qui veut « apprendre des choses qu’[il] ne sai[t] pas faire » donne des ateliers autour des thèmes présents dans la pièce de Rébecca Chaillon. Il a écrit une autobiographie, intitulée Testament Adolescent, pendant le Covid-19 et vient de livrer un manifeste : Je fais de l’art pour que les méchants se suicident. « Pourquoi certains continuent-ils de vouer leur existence à l’acte de création quand n’importe quel morceau de musique peut être fabriqué par un ordinateur et un texte pondu par une intelligence artificielle ?, y demande-t-il. Peut-être parce que l’Art n’est pas une option, parce que l’Art n’est pas un “plus” ni un divertissement ni même un passe-temps… Peut-être aussi parce qu’il y a des virtuoses et que cette virtuosité a une fonction dans nos sociétés : nous prouver qu’au-delà de ses petites bassesses biologiques, l’Homme est capable de grandes choses. » Plutôt vomir que faillir, de Rébecca Chaillon. Du 14 au 16 mai au Théâtre Sorano, à Toulouse ; du 24 au 26 mai à La Minoterie, à Dijon ; du 29 mai au 2 juin, au Théâtre Vidy-Lausanne (Suisse). Cabaret Khalota, de David Wampach. Le 16 mai au Cratère, à Alès (Gard) ; le 17 mai à La Berline, à La Grand-Combe (Gard). Rosita Boisseau Légende photo : Zakary Bairi, à Paris, en février 2023. MÉLODIE LAURET
par Mathieu Lindon dans Libération, publié le 10 mai 2024 «Héliogabale» est un «drame en quatre actes» écrit à Fresnes, en 1942 et «Mademoiselle» est le scénario de 1951 du film que réalisa Tony Richardson avec Jeanne Moreau. Voici que surgissent deux textes de Jean Genet dont on connaissait l’existence mais dont on ignorait où ils se trouvaient (et s’il en restait quelque chose). Le célèbre prisonnier né en 1910 et mort en 1986 a écrit Héliogabale, ce «drame en quatre actes», à Fresnes, en 1942, après son premier roman Notre-Dame-des-Fleurs. Le texte a été retrouvé dans une bibliothèque de Harvard. L’histoire romaine a évidemment inspiré Genet, mais également Antonin Artaud dont Héliogabale ou l’Anarchiste couronné, «le fond même de notre littérature sauvage» selon J. M. G. Le Clézio, est paru en 1934 et s’ouvre sur cette phrase : «S’il y a autour du cadavre d’Héliogabale, mort sans tombeau, et égorgé par la police dans les latrines de son palais, une intense circulation de sang et d’excréments, il y a autour de son berceau une intense circulation de sperme.» Rien pour déplaire à Genet qui, dès les didascalies, fait savoir de quelle mise en scène il se chauffe. Il indique comment sont vêtus les personnages et, pour le «cocher favori» et amant du jeune empereur, il est juste écrit : «splendidement». «Les personnages se parleront de très près, s’envoyant les répliques au visage comme s’ils se crachaient à la figure» quoiqu’il n’y ait «pas d’éclats» : «C’est un drame sec.» Les «scélératesses magnifiques» de la grand-mère L’empereur de 18 ans, à qui sa grand-mère souhaitant sa perte trouve un «triste petit vieux visage de gamin vicieux», met toute sa «gloire à n’être pas respecté». «Le mépris, c’est ce que je veux.» Il ressemble à un masochiste mégalomane. «Il ne me suffit pas de m’enlaidir, j’enlaidis la beauté.» Ou : «Il faut que nous franchissions l’abject afin de nous retrouver seuls dans notre désespoir. Nous serons plus forts que le monde puisque nous habiterons l’immonde.» Sa naissance ayant mensongèrement porté sur le trône l’empereur travesti, ça donne : «Je suis le fils de la nuit. Sorti de la nuit enceinte par la verge monstrueuse d’un porcher juif, peut-être.» Il vante les «scélératesses magnifiques» de sa grand-mère : «Elle est grande et terrible, donc doublement ridicule», ou : «La garce veut ma mort. Elle pue ma mort comme si elle m’avait déjà dévoré.» Puis vient le temps de la décadence, Héliogabale détrôné fuit : «Les garçons comme moi ne savent apporter que l’anarchie, et tant qu’ils sont enfants, qu’ils ont le toupet de jouer avec les choses sacrées.» Mais on peut toujours tomber plus bas. «Pourvu que je ne sois pas réduit à devenir intelligent. Ce serait bien le pire des malheurs qui puisse m’arriver.» «Le lecteur familier de l’œuvre de Jean Genet aura reconnu les éléments structurants de son imaginaire avec ses thèmes de prédilection (le secret, le complot, la violence, la lâcheté, la trahison, la dérision, etc.)», écrit François Rouget dans son avant-propos. Mademoiselle est le scénario de 1951 du film que réalisa Tony Richardson en 1966, avec Jeanne Moreau (Louis Malle, Georges Franju et Joseph Losey n’avaient pas mené le projet à terme). En 1950, Genet avait tourné son mythique court-métrage Un chant d’amour en bénéficiant pour les extérieurs de la propriété de Jean Cocteau, «son protecteur originel», comme l’écrit Yves Pagès, l’écrivain et éditeur de Verticales, dans la première préface sur l’«envie de cinéma» de Genet. La seconde est de Patric Chiha et le réalisateur autrichien de la Bête dans la jungle s’interroge sur ces pages qui ne ressemblent pas pour lui à un scénario : «Mais si ce n’est pas un scénario, qu’est-ce que ce texte ? Disons le simplement, Mademoiselle est un film. C’est déjà une suite de gestes, une suite de gestes filmés en gros plans./ Exemple : “Comme ivre, sa bouche baisa l’écorce tendre.”» L’intrigue se déroule dans un village où des immigrés polonais sont si peu appréciés qu’on leur fait porter la responsabilité des divers drames qui s’y produisent (incendies, inondation, empoisonnement). Alors que «Mademoiselle», la jeune institutrice, est au centre de tout, Mademoiselle et son désir, Mademoiselle et sa pénurie d’hommes, Mademoiselle et son quasi silence synonyme de dénonciation calomnieuse. Un des Polonais est un très séduisant homme dont le fils est élève de Mademoiselle. Le texte est la plupart du temps au passé simple ou à l’imparfait, ce qui ne correspond guère à l’image d’un scénario. Genet donne des conseils au réalisateur : «S’il était possible, il faudrait montrer l’odeur de ces chambres.» Il y a «un mouchoir de dentelle» et surtout des pantalons et de quoi les «remplir». Jean Genet Héliogabale. Edition établie et présentée par François Rouget. Gallimard, 108 pp., 15 € (ebook : 10,99 €). Mademoiselle, Gallimard, «l’Imaginaire», 166 pp., 7,50 €. Mathieu Lindon / Libération Légende photo : Photo non datée de Jean Genet à Paris. (UPI. AFP)
ff article de Denis Sanglard dans Un fauteuil pour l'orchestre - 9 mai 2024
Il est parfois dommage de ne s’arrêter qu’au titre d’une œuvre, aussi maladroit soit-il, occultant de fait son contenu qui vaut bien mieux que son annonce. La fête du slip, blason un rien racoleur, est pourtant une création d’une belle acuité, d’une intelligence abrasive jusque dans l’écriture lardée d’humour corrosif, et dont le propos s’avère plus que pertinent à l’heure du retour en force du masculinisme, de ses coups de boutoir, réaction de mâles inquiets, en perte de repère et d’autorité devant les questions aussi bien de genre que de la remise en question du patriarcat, où la parole des femmes depuis #metoo se libère dénonçant désormais les violences sexistes et sexuels, et l’intolérable male gaze qui l’accompagne. Pourtant homosexuel, mais là c’est sans doute une question de génération et de milieu, Mickaël Délis n’échappait pas à cette injonction impérative et culturelle de la performance et du jouir sans entrave, qu’il définit comme un tantinet pathologique. La fête du slip n’exprime rien d’autre que le trouble d’une défaite libératoire, une remise en question salutaire de la toute-puissante verge érectile (et de ses vantards centimètres comme échelle de valeur) qui oblige à la performance jusqu’à la névrose, la compulsion jusqu’à la saturation, la perfection jusqu’au contrôle. Autrement dit, je bande donc je suis . Mickaël Délis fait de son membre suractif, et de la relation privilégiée qu’il entretient avec, le centre du monde, tourne autour comme on regarde son nombril, interrogeant cette quête performative que l’activité sexuelle compulsive et obsessionnelle dénonce pour enfin vouloir s’en affranchir. Pas facile, la route est ardue, aussi raide et parfois douloureuse qu’une bite en érection sous viagra. Sur ce chemin de Damas il y a foule qui de sa mère, de son père, de son frère jumeau, de son agent, de feu son psy, de ses ex, d’un centre d’addiction sexuelle, de l’hôpital public et de ses médecins, et même le metteur en scène Jean-François Sivadier, ce dernier pointant lucidement de son doigt le nœud du problème de Mickaël Délis et provoquant par cette claque sévère une déflagration, sont autant de questionnements, d’obstacles et de réponses dans cette quête d’une masculinité désintoxiquée, décomplexée et débarrassée de ses couilles encombrantes, ce qui ne veut pas dire être émasculé, la question d’en avoir ou pas n’étant plus dés-lors d’actualité. Portraits incisifs, dessinés avec beaucoup d’humour, de tendre vacherie aussi (sa mère castratrice, inénarrable), parfois de tendresse bouleversée (son père, en phase terminale), ou encore d’autorité scientifique pour caution, autant de réactions ou d’objections qui de lui et de son rapport conflictuel avec son pénis dressent un portrait éclaté mais avec une constante et une révélation, n’être que la reproduction et le produit d’un ordre social et familial, d’un milieu (la communauté homosexuelle n’échappant pas à cette injonction mais pour d’autres raisons, le VIH étant passé par là), un désastre en somme, où le genre n’étant plus qu’une construction n’a plus rien à voir avec le sexe biologique vous laisse sur le flanc. L’hubris turgescent résidant symboliquement et inconsciemment dans le chibre en érection de tout mâle normalement constitué n’est que le symptôme d’un système malade, vérolé, où l’appendice masculin conditionné dès l’enfance, conforté à l’adolescence par l’industrie pornographique, autoriserait le pire dans sa rhétorique machiste et guerrière. Mais il suffit d’une contre-performance inattendue, la débandade honteuse et redoutée, et de bras simplement ouverts sans apriori pour prendre conscience que, oui, la simple tendresse peut-être un antidote et qu’un pavillon traitreusement baissé n’empêche nullement d’aimer et d’être aimé. Dans cette mise en scène épurée qui libère le propos, éclairée astucieusement de quelques néons pour scénographie, Mickaël Délis se met à nu et sans jamais quitter son survêtement, joue un peu cabot de l’impudeur et du scabreux (relatif) de ses aveux mais avec le sel et le poivre d’un humour qui n’oblitère jamais le sérieux d’une réflexion pertinente bien plus large que ce soliloque égocentré autour de son pénis et de ses performances. Coup de pied dans les parties du patriarcat, La fête du slip c’est surtout l’histoire d’une gueule de bois et de lendemains qui débandent. Denis Sanglard - Un fauteuil pour l'orchestre La fête du slip, écriture, interprétation et co-mise en scène de Mickaël Délis Co-metteurs en scènes : Papy de Trappes, Vladimir Perrin, David Délis Consultant chorégraphique : Clément Le Disquay Création lumière : Jago Axworthy Collaboration à l’écriture : Romain Compingt Du 8 mai au 14 juin 2024 à 21h Les mercredis et vendredis, le dimanche à 18h Théâtre de la Reine Blanche 2bis passage Ruelle 75018 Paris Réservations : www.reineblanche.com https://www.reineblanche.com/calendrier/theatre/la-fete-du-slip Tournées : 3/21 juillet, festival d’Avignon, Avignon Reine Blanche à 21h45 Dans le cadre d’un diptyque avec Le premier sexe, au même date à 20h15
Article de Lara Clerc dans Libération - 7 mai 2024 La 35e nuit des Molières diffusée ce lundi 6 mai sur France 2 n’a pas échappé à quelques longueurs malgré l’énergie de l’humoriste Caroline Vigneaux. Compte rendu et palmarès. On s’attendait à pas mal de choses, mais pas à ce que cette 35e cérémonie des Molières commence par une reprise en fanfare (des sapeurs pompiers de Paris) d’un medley de chansons pop (Flowers de Miley Cyrus, Don’t Start Now de Dua Lipa…), sur lequel déboule Caroline Vigneaux. «En toute simplicité», comme elle le décrit. Cette année, c’est cette ancienne avocate reconvertie humoriste qui succède à la présentation «start-up nation» d’Alexis Michalik. Si la mission s’avère délicate – la cérémonie est souvent parasitée par des longueurs –, elle avait déjà annoncé la couleur lors de la révélation des nominés : «Les lauréats sont prévenus, ils auront interdiction de remercier leurs parents, leur metteur en scène, leur producteur ou leur cousine Paulette.» D’ailleurs la sentence est rude, car quiconque dépasse la minute réglementaire de remerciement se voit interrompre par Ernesto, chanteur lyrique un brin kitsch. Le mot d’ordre : pas de «merci», mais des anecdotes. Rachida Dati prise à partie Passé le mot dédiant la cérémonie à Bernard Pivot, décédé ce lundi 7 mai, que la fête commence : paillettes, courbettes et différentes révérences, que ce soit en danse ou sur scène lors des remerciements – pardon, des anecdotes. Caroline Vigneaux mène la danse d’un show sans cesse interrompu par de multiples causes ou messages qui se gaussent de passer entre les mailles du filet supposé assurer le rythme de la soirée. Piques ici et là à l’encontre de Rachida Dati (mention spéciale à la référence à sa menace de transformer le chien de Gabriel Attal en kebab), remarques sur le manque de diversité parmi nommés ou rappel des coupes budgétaires spectaculaires annoncées cette année pour la Culture… Sophia Aram, récompensée pour le spectacle le Monde d’après, interpelle l’audience : «Si nous appelons tous ici à un cessez-le-feu, comment être solidaires des milliers de civils morts à Gaza sans être aussi solidaires des victimes israéliennes ? Comment exiger d’Israël le cessez-le-feu sans exiger la libération des otages israéliens ? Comment réclamer le départ de Netanyahou sans réclamer celui du Hamas ?» Un show féministe Malgré la volonté de sa maîtresse de cérémonie, la soirée dégage parfois un petit relent de renfermé, pendant le discours d’Anne Roumanoff sur les dérives des réseaux sociaux. Déconcertante, Caroline Vigneaux martèle à Bruno Solo avant son discours : «Tu es sûr que tu n’as pas d’affaires au cul ? […] c’est rare !» Le sujet #MeToo revient plus tard lors d’un clip montrant un montage de plusieurs photos d’acteurs et actrices avec en seul message «Vous n’êtes pas seul.e.s», immédiatement suivi d’un numéro musical interprété par Mathilde, revendiquant la liberté des femmes à disposer de leur corps. Un brin contradictoire avec la parole d’Elsa Zylberstein, qui revendique être «la pâte à modeler» de son metteur en scène devant Tiago Rodrigues, heureusement reprise sur la question par Caroline Vigneaux. Auréolé de sept nominations, Courgette de Paméla Ravassard et Garlan Le Martelot repart avec un seul trophée, alors que 4 211 km – dont la metteuse en scène Aïla Navidi appelle à la libération de Toomaj Salehi, rappeur iranien condamné à mort pour une chanson –, et le Cercle des poètes disparus finissent tous deux la soirée avec deux statuettes. L’adaptation du mélo culte où brillait Robin Williams qui fait salle comble au Théâtre Antoine était nommée à six reprises. Côté public, le joyeux et carnavalesque 40° sous zéro du Munstrum Théâtre remporte lui aussi deux Molières. Lara Clerc / Libération Palmarès - Molière du Théâtre privé : 4 211 km de et mise en scène par Aïla Navidi
- Molière du Théâtre public : 40° sous zéro de Copi, mise en scène Louis Arene
- Molière de la Comédie : C’est pas facile d’être heureux quand on va mal de Rudy Milstein, mise en scène Rudy Milstein et Nicolas Lumbreras
- Molière de la Création visuelle et sonore : Neige, scénographie Emmanuelle Roy, décors Emmanuelle Roy, costumes Alice Touvet, lumière Jean-Luc Chanonat, (de et mise en scène par Pauline Bureau)
- Molière du Spectacle musical : Spamalot de Éric Idle, mise en scène Pierre-François Martin-Laval
- Molière de l’Humour : Sophia Aram dans le Monde d’après de Sophia Aram et Benoît Cambillard (mise en scène Sophia Aram et Benoît Cambillard)
- Molière du Jeune public : Neige de et mise en scène par Pauline Bureau
- Molière du Seul. e en scène : Va aimer ! avec et de Eva Rami
- Molière de la Mise en scène dans un spectacle de Théâtre public : Louis Arene pour 40° sous zéro de Copi
- Molière de la Mise en scène dans un spectacle de théâtre privé : Olivier Solivérès pour le Cercle des poètes disparus (adaptation de Gérald Sibleyras)
- Molière de l’Auteur. trice francophone vivant.e : Rudy Milstein pour C’est pas facile d’être heureux quand on va mal
- Molière de la Comédienne dans un spectacle de Théâtre public : Vanessa Cailhol dans Courgette de Paméla Ravassard et Garlan Le Martelot (mise en scène Paméla Ravassard)
- Molière du Comédien dans un spectacle de théâtre public : Micha Lescot dans Richard II de William Shakespeare (mise en scène de Christophe Rauck)
- Molière de la Comédienne dans un spectacle de théâtre privé : Cristiana Reali dans Un Tramway nommé Désir de Tennessee Williams (mise en scène Pauline Susini)
- Molière du Comédien dans un spectacle de théâtre privé : Vincent Dedienne dans Un chapeau de paille d’Italie de Eugène Labiche (mise en scène d’Alain Françon)
- Molière de la Comédienne dans un second rôle : Jeanne Arènes dans l’Effet miroir de Léonore Confino (mise en scène Julien Boisselier)
- Molière du Comédien dans un second rôle : Guillaume Bouchède dans Je m’appelle Asher Lev de Aaron Posner (mise en scène Hannah-Jazz Mertens)
- Molière de la Révélation féminine : Olivia Pavlou-Graham dans 4 211 km (de et mise en scène par Aïla Navidi)
- Molière de la Révélation masculine : Ethan Oliel dans le Cercle des poètes disparus (mise en scène Olivier Solivérès)
- Molière d’honneur : Francis Huster
Légende photo : L'acteur Vincent Dedienne recevant son Molière des mains de Jean-Pierre Darroussin, le 6 mai à Paris. (Thomas Samson/AFP)
Par Anne Diatkine dans Libération - 6 mai 2024 L’homme de théâtre prolifique fait l’objet d’une plainte déposée en 2021 par l’un de ses anciens élèves, qui relate à «Libération» des années «d’assujettissement dominé par la peur» et les viols dont il aurait été victime dès l’adolescence. Pierre Notte, qui bénéficie de la présomption d’innocence, parle quant à lui d’une histoire d’amour. C’est l’histoire d’un homme de théâtre, dramaturge prolifique joué dans la France entière, écrivain et metteur en scène réputé, au parcours ascensionnel jalonné d’honneurs et de prix, et d’un jeune homme silencieux qui se percevait comme invisible tant sa présence n’était jamais interrogée. Alban K., 37 ans, a porté plainte le 10 décembre 2021 pour viols et agressions sexuelles sur mineur par un adulte ayant autorité. L’adulte ayant autorité est donc Pierre Notte, 54 ans, écrivain publié chez Gallimard dans la collection Blanche, homme de réseaux et de pouvoir, qui fut entre autres secrétaire général à la Comédie-Française de 2006 à 2009 puis rattaché à la direction du Rond-Point durant les années Ribes jusqu’en 2022. Mis en garde à vue, Pierre Notte a été entendu pour la première fois mercredi 24 avril par un officier de la police judiciaire. Selon nos informations, une confrontation avec le plaignant a eu lieu dans la foulée. A l’issue de celle-ci, Notte, présumé innocent, a été présenté à un juge d’instruction qui l’a mis en examen pour viol sur mineur commis par une personne abusant de l’autorité que lui confère sa fonction. Il est actuellement placé sous contrôle judiciaire. C’est un coup de théâtre, autorisons-nous ce cliché, et en tout cas le signe très net que quelque chose se fissure au royaume de l’impunité, y compris lorsqu’on prend soin de se construire une façade pro #MeToo : le dernier grand succès de Pierre Notte, Je te pardonne (Harvey Weinstein), créé après le confinement en 2021, est un réquisitoire en chansons contre les prédateurs sexuels et Weinstein en particulier qu’incarnait au plateau… l’auteur en personne. Pour Alban K., qui découvre la pièce à sa création, c’est un choc : «Je me souviens d’un effondrement total, d’un trou noir pendant quarante-huit heures, où je me dis ce n’est pas possible, l’impunité n’aura jamais de fin, ça va continuer. Après le déguisement en grand défenseur de la cause #MeToo, quelle sera la prochaine étape ?» C’est la vision de cette pièce qui décide Alban K. à joindre l’avocate Léa Forestier, qui a par ailleurs été le conseil juridique de Vanessa Springora dans l’affaire Matzneff. «Il fallait absolument que j’aille voir quelqu’un qui comprenne de quoi je parle.» Effectivement, l’histoire d’Alban K. telle qu’il la relate permet de comprendre les rouages subtils à l’œuvre sous le gros mot d’emprise. Quand Alban K. rencontre pour la première fois Pierre Notte en 2002, il a 15 ans et est en classe de seconde au lycée privé catholique Saint-Louis Saint-Clément à Viry-Châtillon. Pierre Notte, qui n’a pas encore créé la pièce qui le rendra célèbre et lui vaudra un molière et un prix de la SACD, Moi aussi je suis Catherine Deneuve, est son enseignant à l’option théâtre, coanimée par sa professeure de français, mariée à un grand ami de Notte, Thierry Jopeck. A 15 ans, l’adolescent traverse une période particulièrement éprouvante : il est stigmatisé, harcelé, insulté par ses camarades en raison de son orientation sexuelle tandis que son père, hospitalisé tantôt en clinique, tantôt à la maison, se bat contre un myélome multiple des os dont il décédera en décembre 2013. Dans ce contexte, nous explique Alban K., Pierre Notte va peu à peu gagner sa confiance en apparaissant comme «très protecteur», voire l’unique personne à qui il peut se confier. Comme il le dit dans sa plainte déposée le 10 décembre 2021 que Libération a pu consulter, Pierre Notte, une vingtaine d’années de plus que son élève, lui apparaît alors comme l’homme capable de sermonner devant lui les élèves qui le traitent de «pédale», de «tantouze», «fiotte» et autres insultes. C’est d’autant plus précieux que le milieu éducatif n’est pas encore suffisamment sensibilisé à la question du harcèlement. En première, l’enseignant Notte continue d’apparaître comme un «bouclier» pour l’adolescent. «Il me soulève comme un morceau de bois mort» Vient le jour d’un premier rendez-vous suscité par l’élève au Starbucks de l’Opéra – rappelons qu’il habite à une vingtaine de kilomètres de Paris. Surprise : l’adulte refuse d’entrer dans le café, et conduit le jeune homme de 16 ans, dans ce qui lui apparaît comme un labyrinthe, jusqu’à la rue du Pélican au centre de Paris, où il habite. Alban K. nous raconte alors d’une traite : «Et très vite, dès le portail rouge de l’immeuble, j’arrête de parler. On monte les deux étages, on est chez lui, on s’assoit à une petite table. Je suis assis sur une chaise, il est à genoux devant moi, mais même dans cette position, il est à ma hauteur, et là, il m’embrasse, aucune réaction de ma part. Juste le souvenir de l’horreur de sa barbe et le goût du café dans la bouche. Je ne dis rien, je ne réagis pas. Je suis prostré. Assez vite, il me soulève comme un morceau de bois mort car je ne marche pas moi-même. L’appartement est petit et il baisse mon pantalon et frotte son visage sur mes parties génitales, et tout ça se fait dans un silence total, sans aucun dialogue, sans aucune réaction de ma part, je me souviens que je fixe le plafond.» Comment se refuser à l’autorité d’un enseignant qui se présente comme un sauveur lorsqu’on vit une tragédie familiale et qu’on est victime de harcèlement en classe ? «Se crée alors une forme de dépendance dominée par la peur», peut-on lire dans la plainte. Le deuxième rendez-vous a lieu dans l’appartement de la professeure de français, comme Pierre Notte le relate de manière à peine transposée dans Quitter le rang des assassins, récit autobiographique au titre programmatique emprunté à Kafka, paru en 2018, chez Gallimard. Il est introduit dans la prestigieuse maison par le soutien de Matzneff, Christian Giudicelli, qui devient son éditeur. Une différence de taille tout de même : dans le récit, le personnage dénommé Not, «qui déshabille l’enfant de 17 ans, lentement, et l’embrasse partout», agit sur un corps qu’il dote de consentement. Pour Alban K., l’acte sexuel qu’il qualifie «d’agression» est d’autant plus «traumatisant» que tout se passe dans le lit de sa prof de français «qui ne sait rien de cette histoire, ni même que je suis chez elle». «Je dois me maintenir à disposition» Pierre Notte achète ensuite une chambre de bonne rue Jean-Jacques Rousseau, à Paris, qu’il surnomme de manière éloquente «la boîte». Alban K. se souvient : «Ce sont des rendez-vous qui se répètent et qu’il est impossible de refuser. Je sais que je dois y aller. Et donc je viens avec un sac que je remplis du plus d’affaires possibles car je ne sais jamais quand je vais pouvoir partir. Même quand il sort travailler, il est clair que je ne peux pas sortir, je dois l’attendre, me maintenir à disposition.» Alban K. se décrit comme réifié. En particulier, son mentor lui interdit de se laver. «Si jamais je prends une douche, ce sont des crises sans fin. Il me renifle partout, sous les bras, et s’il sent une odeur de savon, c’est un tribunal pendant au mieux des heures parfois des jours, avec la nuit, des cris – “Si tu te laves, tu le fais pour me contrarier.” Au point qu’au bout de plusieurs semaines, je puais, c’était horrible. Et en repartant chez moi, à chaque fois, je passais des heures à me laver. Il y a la libération par la douche.» Est également passée au crible son alimentation : «Il n’y avait aucune liberté ni dans le choix des aliments ni dans leur quantité toujours restreinte.» Avant de retrouver Notte, Alban K. prend donc l’habitude de manger un sandwich en cachette. Le contrôle semble sans limite : c’est clandestinement qu’Alban K. se souvient d’entrer dans des librairies. Il recouvre ensuite les livres achetés, et les dissimule au fond de son sac à dos. De fait, selon le plaignant, c’est toute activité autonome comme l’est par définition la lecture, qui devient proscrite sous peine de susciter des crises et colères terrifiantes dont Pierre Notte fait d’ailleurs état dans Quitter le rang des assassins. Tandis qu’en milieu scolaire, selon la plainte, Notte paraît souffler le chaud et le froid, alterne les scènes d’humiliation et de glorification d’Alban K., les rendez-vous se poursuivent soit dans la «boîte», ou dans l’appartement principal de l’homme de théâtre qui vit en couple, pacsé, comme Alban K. le découvre accidentellement au bout de quelques années – cette découverte est également racontée dans Quitter le rang des assassins. Ce qui n’est pas sans questionner Alban K. : «Pendant trois ans, j’ai été dans un appartement où il était imperceptible qu’un autre homme que Notte habite. Il n’y avait pas d’affaires, aucune trace, photo, objet. Tout était à lui, à son image.» La première sodomie, sans capote, a lieu à Saint-Brieuc pendant un voyage professionnel alors qu’Alban est en première. Rester sage comme une image Il y a un jour où, celui que Notte nomme «l’enfant» dans plusieurs textes, craque et explose en sanglots pendant un cours d’anglais. L’enseignante demande à l’élève de quitter la classe avant de recueillir ses confidences sur sa relation avec le professeur de l’option théâtre. La prof d’anglais s’en est-elle ouverte à sa collègue, prof de français ? L’après-midi même, Alban K. reçoit un appel du mari de cette dernière qui l’aurait exhorté à «rectifier le tir» auprès de la prof d’anglais afin de se protéger d’un «scandale» dont il aurait été très difficile de se relever. Alban K. n’imagine pas pouvoir mentir de vive voix. Il obéit à l’ordre mais par écrit. Nous n’avons pas réussi à joindre la professeure d’anglais, qui aurait, selon nos informations, corroboré les faits, par ailleurs relatés dans la plainte. Les liens et ce qu’Alban K. nomme «assujettissement» ne s’interrompent pas après l’obtention du baccalauréat. L’étudiant, qui s’est inscrit en études théâtrales à l’université Sorbonne Paris 3 reste très isolé, ce que confirme à Libération son unique amie rencontrée à la fac. «Alban K. a surgi dans le couloir comme apparition : en justaucorps, cheveux longs, androgyne, différent de tous. Il ne s’est pas confié à moi tout de suite. Sa relation avec ce monsieur Notte était cachée.» Alban K. lui apparaît sans cesse pressé : «Il avait peur, il devait faire des courses pour lui. Son empressement mêlé de terreur était frappant. Je n’ai croisé Pierre Notte qu’une seule fois furtivement place Colette à Paris.» De même qu’Alban K. se cache pour se nourrir, de même il voit son amie «dans la clandestinité», souvent au Quicampe, rue Quinquampoix, qui dispose d’une arrière-salle – «pour éviter que les passants puissent nous voir de la rue». Pierre Notte se déplace avec son garçon trophée partout, l’emmène à des premières, à des soirées mondaines, des dîners entre gens aisés et connus, et toujours beaucoup plus âgés que lui. Mais tout se passe comme si sa beauté confondante suffisait à justifier sa présence et, selon Alban K., personne ne songe à s’intéresser à ce qu’il aime, pense ou même à la nature de sa relation avec Notte. Il va de soi qu’il doit rester sage comme une image. De fait, nous relate Alban K., quand lors d’un dîner, il fait mine de rire, ou s’exprimer, un regard de son mentor suffit à l’en dissuader. Une seule fois, une femme lui pose une question personnelle : l’actrice Valérie Lang. C’était tellement inhabituel qu’Alban K. s’en souvient. De même à la Comédie-Française où Notte exerce un haut poste et où, dans son bureau, Alban K. voit défiler tous les comédiens sans qu’ils ne semblent s’apercevoir de sa présence. A l’exception de Muriel Mayette-Holtz, à l’époque administratrice de la maison de Molière, qui décrit «un jeune homme silencieux qui marchait toujours derrière Pierre Notte». Pour autant, l’année universitaire se révèle un pas vers la liberté. Alban K., qui ne peut toujours ni lire ni étudier chez Pierre Notte, va peu à peu fomenter son évasion grâce à un job d’étudiant au théâtre des Variétés. En cachette de Pierre Notte, Thierry Jopeck, qui n’a pas souhaité répondre à nos questions, accepte de se porter caution. Sentiment d’une rupture d’égalité entre le plaignant et le mis en cause Selon la plainte, en 2009, un week-end à Trouville est décisif. Notte, furieux de voir Alban K. lui échapper, menace de se tuer ou de le tuer. Le risque doit être sérieux pour que l’ami Jopeck, qu’Alban K. appelle en détresse, lui conseille de s’enfuir par la fenêtre – pendant qu’il lui prend un billet de train. «Silence, peur, bruit de couteau : la mort n’était vraiment pas loin ce jour-là», se remémore Alban K.. Une «tyrannie» dont Pierre Notte semble avoir conscience selon un courrier que nous avons pu consulter où il évoque ce week-end. Mais c’est un an plus tard, et beaucoup plus loin, au Canada, qu’Alban K. choisira de s’enfuir. Il y vit pendant cinq ans grâce à des bourses et un poste d’auxiliaire de recherche afin de poursuivre des études de lettres. Loin, il écrira une première pièce de théâtre dont il détectera bien après sa parution qu’elle porte sur le viol et l’enfermement. Dans sa préface, Thierry Jopeck atteste avoir connu Alban K. adolescent et fait une corrélation curieuse entre ses souvenirs de l’auteur à cet âge, les désirs qu’il inspirait, et Gabriel Matzneff. Lorsqu’on le rencontre une première fois à la mi-février 2024 dans le bureau de ses conseils Léa Forestier et Alix Aubenas, Alban K. frappe par sa précision et l’étayage de ses formulations en dépit de la terreur perceptible que lui inspire encore Pierre Notte, quatorze ans après la fin de toutes relations. Le processus judiciaire est alors enlisé. Près de trois ans après le dépôt de plainte et malgré la gravité des accusations, l’enquête prend du temps à démarrer, donnant le cruel sentiment à ses conseils et à Alban K. d’une rupture d’égalité entre le plaignant et le mis en cause. Selon Léa Forestier, Pierre Notte «dispose d’une forme d’agora médiatique, avec ses projets qui lui permettent de montrer publiquement un engagement professionnel en faveur du mouvement #MeToo», tandis qu’Alban K. et ses conseils sont tenus au silence par respect de la procédure. Et surtout, selon les avocates et leur client, un risque demeure : Pierre Notte, qui présente des master class au cours Florent où certains étudiants ont moins de 18 ans, peut être susceptible de répéter un comportement prédateur auprès de très jeunes gens. Confrontation libératrice Tout s’accélère cette fin avril. Mieux : une confrontation que redoutait infiniment Alban K. se révèle libératrice et en partie réparatrice. Pendant la confrontation, où le mis en cause est dos au plaignant – ils ne se dévisagent donc pas –, Alban K. s’est senti libre de poser toutes les questions qui le travaillent depuis quinze ans. D’une certaine façon, avant même qu’on sache si un procès aura lieu, la justice permet au plaignant d’avancer. «L’énorme poids sur la poitrine que je porte depuis ma rencontre avec cet homme s’est dissous», nous dit-il, d’une voix pour la première fois joyeuse. De son côté, Pierre Notte, qui n’a pas souhaité nous rencontrer, nous écrit par mail qu’il est «anéanti par la situation». Il dit avoir vécu «avec Alban, du printemps 2004 à l’année 2011, une histoire d’amour qui s’est, les derniers mois, fragilisée et délitée, comme le font souvent les histoires d’amour». Et qu’il «conteste et réfute définitivement, fermement, absolument, toutes les accusations d’agressions sexuelles et de viols portées par Alban». Plus précisément, il qualifie leur relation de «strictement et absolument amoureuse». Et explique : «Nos nombreux échanges (les lettres, les messages audios qu’il me laissait, les photos et les mails qu’il m’adressait, etc.) montrent qu’Alban n’était ni terrorisé, ni impressionné, ni contraint, ni forcé, ni soumis. Notre relation n’était pas cela, elle ne reposait pas, en aucun cas, absolument pas, sur des inégalités. Nous communiquions abondamment, amoureusement et sainement.» Pour le plaignant, ce qu’il nomme le «déni» de Pierre Notte est d’autant plus surprenant que son attitude et ses propos tenus lors de la confrontation (filmée) lui ont semblé d’une tout autre teneur. Légende photo : Le dramaturge Pierre Notte à Paris, le 12 décembre 2022. (Corentin Fohlen/Divergence)
Par Joëlle Gayot dans Le Monde - 5 mai 2024 Onze ans après avoir créé sa pièce à l’Odéon, l’auteur lui redonne vie avec maestria au Théâtre de la Porte Saint-Martin, avec la même troupe.
Lire l'article sur le site du "Monde" :
https://www.lemonde.fr/culture/article/2024/05/05/avec-la-reunification-des-deux-corees-joel-pommerat-reactive-son-kaleidoscope-epineux-de-rapports-amoureux-et-amicaux_6231696_3246.html
Nuit noire dans le théâtre. Des talons claquent sur un plancher de bois quand, doucement, une lumière se faufile dans l’espace et y pourchasse l’obscurité. D’un pas calme, en escarpins et trench ajusté, une femme marche vers nous. La comédienne Saadia Bentaïeb inaugure une comédie des mœurs édifiante dont les autres protagonistes se nomment Agnès Berthon, Yannick Choirat, Philippe Frécon, Ruth Olaizola, Marie Piemontese, Anne Rotger, David Sighicelli, Maxime Tshibangu. Des années qu’on n’avait pas vu cette troupe d’acteurs de très haut vol réunie sur une scène. Pas de doute : Joël Pommerat est de retour. Et avec quelle maestria ! Onze ans après avoir créé à l’Odéon-Théâtre de l’Europe La Réunification des deux Corées, l’auteur metteur en scène redonne vie au Théâtre de la Porte Saint-Martin, à Paris, à ce kaléidoscope épineux de rapports amoureux et amicaux qui, en 2013, avait pu être accueilli avec une certaine perplexité. Une vingtaine de tranches de vies serties au murmure près, certaines plus développées que d’autres, pas toutes égales en intensité, mais qui, dans leur passionnant bout à bout, déroulent une chaîne de relations où banalité et monstruosité dansent un tango infernal en suscitant éclats de rire ou frissons d’inquiétude. Une femme s’oppose au mariage de sa sœur dont le futur mari l’aurait un jour embrassée ; un homme revient, des années plus tard, s’excuser auprès de son ex-compagne (« j’avais oublié de te dire au revoir ») ; un instituteur confesse une passion (coupable ?) pour un petit garçon dont il avait la charge ; un couple s’invente des enfants qu’il n’a pas ; deux amis en viennent aux mains ; une femme quitte son compagnon parce que l’aimer ne suffit pas ; une seconde perd la mémoire et redécouvre chaque jour l’homme avec qui elle est mariée, etc. Vibrations contradictoires Ces variations forment une mélodie dissonante où l’hétérogénéité des situations exposées, loin d’être un écueil, signale les vibrations contradictoires et même incohérentes qui forgent nos intériorités. Pommerat ne restitue pas du sentiment une beauté illusoire et lénifiante. Il en révèle la discontinuité, les paradoxes, le caractère parfois hagard, le fondement souvent dérisoire. Il n’écrit pas sur le sentiment, il le théâtralise. Une entreprise qui suscite le coq à l’âne de vies héroïques ou pathétiques, de paroles cocasses ou dramatiques, d’attitudes exemplaires ou douteuses. Effet salutaire du temps qui passe : son texte se réactive en 2024 avec une pertinence décapante. Impossible de le soustraire à ce qui, en une décennie, a bouleversé la conception des liens (quels qu’ils soient) en introduisant, dans les consciences, les notions d’aliénation, de consentement, de patriarcat ou d’émancipation. Les mots de Pommerat sont les mêmes qu’avant. Pas nous. Raison pour laquelle leur écoute fait l’effet d’une claque intensifiée par leur déploiement dans un dispositif scénique repensé de fond en comble. Pour le meilleur. Hémorragie de sensations Dans sa version originelle, La Réunification des deux Corées reposait sur un agencement bifrontal. La scène qui scindait en deux l’assemblée inscrivait à même le plateau la réalité de la séparation à l’œuvre entre les personnages. Une réalité si indépassable qu’elle affectait la réceptivité du public, témoin distancié de ces amours et ces amitiés malmenées. Mais au Théâtre de la Porte Saint-Martin sculpté par les ombres et lumières du surdoué Eric Soyer, le bifrontal originel a cédé la place à une configuration frontale classique dont débordent les acteurs. Ils traversent les gradins du public, leurs voix sonorisées chuchotent au creux de nos oreilles. La fiction s’évade de l’aire de jeu et répand, dans la salle, une hémorragie de sensations qui contaminent chaque spectateur. Les émotions, dont l’auteur creuse les limites jusqu’à atteindre une forme de Grand-Guignol, se propagent avec l’efficacité d’un venin semant le trouble dans les esprits. Vaudeville ou tragédie ? Il arrive qu’on rie ou qu’on se fige. Si les réactions sont imprévisibles, personne n’échappe au malaise que distille Pommerat, ce maître de l’étrangeté qui dénature le quotidien pour lui faire avouer ses incongruités. Acteurs, chansons, gestes, mots, on se souviendra longtemps du moindre détail d’un spectacle remarquable dont la puissance de feu est désormais une évidence. La Réunification des deux Corées, de Joël Pommerat. Théâtre de la Porte Saint-Martin, Paris 10e. Jusqu’au 14 juillet. Joëlle Gayot / LE MONDE
Publié sur le site d'ARTCENA le 2 mai 2024
Le futur directeur fera de la coopération la pierre angulaire de son projet centré sur l’accompagnement des artistes et la rencontre avec l’ensemble des publics du territoire.
Chargé en 2016 par la municipalité de Toulouse de définir de nouvelles orientations pour le Théâtre de la Digue – où il a établi sa compagnie – Aurélien Bory a acquis auprès des artistes et des publics une expérience qui est venue conforter un désir déjà ancien : prendre la direction d’un équipement. Si le choix du Théâtre Garonne s’est imposé comme une évidence, c’est au regard de l’histoire très forte que cet artiste protéiforme formé au Centre des arts du cirque Le Lido, également comédien, metteur en scène et chorégraphe, a vécue avec le lieu ; d’abord comme spectateur et par la suite en tant que jeune professionnel. « J’y ai effectué des rencontres déterminantes, notamment avec Mladen Materic dont j’ai intégré la troupe, le Théâtre Tattoo, à la fin des années 1990. Et en 2003, j’ai créé sur son plateau Plan B, qui a réellement lancé la Compagnie 111 », se souvient-il. Depuis, tout en lui restant fidèle, Aurélien Bory a collaboré avec d’autres structures de la ville : le Théâtre de la Cité–Centre dramatique national Toulouse Occitanie, devenu son principal partenaire, le Théâtre Daniel Sorano (pour Médéa Mountains, repris à la rentrée) et plus récemment l’Opéra national Le Capitole qui a coproduit Dafné. Aussi bénéficie-t-il d’une parfaite connaissance de l’écosystème toulousain, précieuse pour s’engager dans une aventure qu’il conçoit sous le signe du partage et de la coopération afin que le théâtre rayonne sur son territoire, mais aussi à l’échelle nationale, européenne et internationale. Cette coopération s’exercera d’abord à l’endroit de la production. Le futur directeur (il prendra ses fonctions en septembre) souhaite en effet affermir le soutien apporté aux artistes en augmentant les accueils en résidence, au sein du studio Les Ateliers, bientôt rénové, et du Théâtre de la Digue, dont il aimerait dans les années à venir assurer la gestion ; ceci, dans l’optique de transformer le Théâtre Garonne, avec le concours de l’État et des collectivités (Ville, Métropole et Région), en un Pôle européen de production. Pour satisfaire une telle ambition, qui permettra des compagnonnages artistiques au long cours, favorisera également l’accompagnement de l’émergence et donc la structuration de la filière sur le territoire, Aurélien Bory entend accroître le budget de production du théâtre. « Il nous faudra trouver d’autres partenaires et moyens financiers, via le mécénat et des dispositifs européens, procéder aussi à des arbitrages ou, en tout cas, définir un nouvel équilibre entre activité de production et de diffusion », explique-t-il. Sur le plan de la diffusion, le Théâtre Garonne continuera de promouvoir les nouvelles écritures, françaises et internationales, pluri et transdisciplinaires. « Ayant moi-même œuvré aussi bien sur les champs du théâtre, de la danse, du cirque, que de la musique et des arts visuels, je n’établis aucune hiérarchie ni différence entre eux. Seule compte la proposition artistique, ce qu’elle nous dit de nous et de notre rapport au monde », affirme Aurélien Bory, qui ne perçoit pas, en outre, de contradiction entre création contemporaine et volonté de fédérer des publics. Afin précisément de les élargir et de les diversifier, il s’attachera à développer les séries de représentations, synonymes aussi de permanence artistique sur le territoire et donc de rencontre avec les populations au travers d’actions de médiation. La coopération sera, de plus, motrice pour l’organisation de tournées cohérentes qui concerneront les artistes locaux, régionaux, nationaux et internationaux. Elle autorisera, par ailleurs, une meilleure circulation des spectateurs d’un lieu à un autre, le directeur estimant indispensable que ceux-ci puissent profiter de l’ensemble de l’offre culturelle proposée à Toulouse, dans ses environs et même au-delà. « Je songe, par exemple, aux programmations de lieux plus éloignés comme Pronomade(s) en Haute-Garonne, Derrière Le Hublot à Capdenac ou encore le GMEA-Centre national de création musicale à Albi, que nous pourrions faire découvrir aux publics grâce à des partenariats », précise-t-il. Tout aussi essentiel lui apparaît le fait de « dynamiser la saison » grâce à une succession de temps forts. Précédant « L’histoire à venir » (7e édition cette année) qui se déroule en mai, un festival centré sur les liens entre théâtre et musique aura lieu au mois d’avril. En juin, Aurélien Bory envisage d’organiser « Reprises », consacré à la reprise de spectacles qui ont connu un certain succès au Théâtre Garonne et sont donc susceptibles d’attirer des publics peu familiarisés avec l’art et la culture. Enfin, pour préparer en douceur le retour dans les murs en septembre, seraient présentées, dans les espaces intérieurs et extérieurs, des expositions et performances autour d’un scénographe. Dans la relation aux habitants du territoire, l’inventivité sera de mise ; qu’il s’agisse d’« ateliers expériences » menés par des artistes, de promenades artistiques le long de la Garonne, de visites du musée d’art contemporain Les Abattoirs, de parcours dédiés aux jeunes ou de repas concoctés par les publics pour les compagnies accueillies en résidence. Après la crise traversée par le théâtre lors du départ de Jacky Ohayon, son successeur est en effet conscient de l’importance de retisser les liens avec les spectateurs, comme avec l’équipe, dont il salue « la résilience ». Alors que la situation économique actuelle du secteur promet d’autres turbulences, Aurélien Bory juge impérieux d’affirmer des ambitions et convictions, au premier rang desquelles figure la nécessité de maintenir les lieux de spectacles « vivants et actifs », au service des artistes et des publics. Crédit photo : ©Aglaé Bory
Par Jean-Pierre Thibaudat dans son blog - 4 mai 2024 Comment dit-on colonisation en langue arabe ? Acteur et auteur de « Koulounisation », Salim Djaferi y répond avec des mots, de l’eau, des fils, etc, et d’abord avec finesse et brio.
Formé à l’école de Liège, Salim Djaferi était de la distribution du splendide Des caravelles et des batailles d’Elena Adoration et Benoît Piret (lire ici), il a aussi collaboré avec Adeline Rosenstein (Décris ravage, lire ici) à laquelle il a demandé d’être le regard dramaturgique de son premier spectacle Koulounisation. Crée en 2001 aux Halles Schaerbeek à Bruxelles, le spectacle a suscité un formidable bouche à oreille au dernier Festival Off d’Avignon, il fait aujourd’hui salle comble au Théâtre de la Bastille. Nullement seul en scène, l’acteur dialogue constamment avec un décor aussi malin qu’évolutif où trônent des paquets de plaques en polystyrène dont on se demande à quoi elles vont pouvoir servir. Rejeton d’un famille originaire d’Algérie, Salim Djaferi s’est évidemment penché sur l’histoire du pays où sont nés ses parents et sur la langue qui est la leur : l’ arabe. C’est ainsi qu’il demande un jour à sa mère et à sa tante comment on dit colonisation en arabe et les deux répondent d’un même mot : « koulounisation ». Un mot nullement arabe mais assurément bâtard qui ne le satisfait pas. Commence alors une enquête autour des mots et pas seulement les avatars du mot colonisation mais aussi les aventures légales du prénom de sa mère et d’autres mots encore. Le voici à Alger entrant dans une librairie et cherchant en vain le rayon des livres sur « la guerre d’Algérie » jusqu’à ce que la libraire lui indique que les livres sur ce sujet sont au rayon « Révolution ». Souvenons-nous qu’en France, les médias officiels de l’époque ne parlaient pas de « guerre d’Algérie » mais des « événements » qui s’y passaient, un peu comme le fait Poutine aujourd’hui à propos de l’Ukraine. Poursuivant son enquête linguistique, on propose à Salin Djaferi plusieurs mots arabes traduisant le mot colonisation, l’un indiquant des choses que l’on s’approprie, un autre une chose que l’on vide et que l’on remplit, etc. Les traducteurs arabes de Franz Fanon proposeront un autre mot plus cinglant. Et la linguistique conduira Salim Djaferi à explorer des mots comme torture. Une bouteille pleine d’un liquide rouge, une éponge entreront dans la danse comme les plaques de polystyrène et un fil sur lequel des pinces suspendront des papiers d’identité. Des éléments qui accompagnent Salim Djaferi dans sa recherche in fine identitaire. Un activisme constant commencé quand les spectateurs s’installent : l’acteur tente de démêler une pelote de fils et en tire quelques uns, le spectacle devenant en quelque sorte une métaphore de ce qu’il met en branle. C’est constamment inventif, aussi sérieux que ludique, plein de vivacité. A bas la colonisation et vive Koulounisation. A la fin des saluts l’acteur salue la lutte du peuple palestinien. Comment dit-on colonisation aujourd’hui à Gaza ? Jean-Pierre Thibaudat Théâtre de la Bastille, 19h, les sam et dim 17h, sf les 8 et 9 mai, jusqu’au 13 mai.
Par Lorraine de Foucher et Jérôme Lefilliâtre dans Le Monde - magazine - publié le 1er mai 2024 PORTRAIT Après le témoignage de Judith Godrèche, l’actrice et réalisatrice dévoile à son tour ses blessures intimes et les mécanismes de la prédation dans un récit autobiographique, « Dire vrai », à paraître aujourd’hui. Lire l'article sur le site de M le magazine du Monde : https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2024/05/01/isild-le-besco-rescapee-de-la-violence-prisonniere-de-mes-manques-materiels-et-affectifs-j-etais-le-terrain-parfait-pour-toutes-les-maltraitances_6230849_4500055.html
Tous les matins, quand le réveil déchire le brouillard de son sommeil agité, Isild Le Besco se demande pourquoi elle a décidé de publier un livre. Pourquoi elle s’apprête à déposer sur les tables des librairies du pays son intimité percutée par la violence. Pourquoi s’imposer tout ça, les médias, les inévitables réactions virulentes de ses proches, les controverses pénibles. Le fil de ses pensées l’emmène toujours au même endroit : elle n’a pas le choix, il y va de sa survie. « Chacune des femmes poussées dans l’horrible, qui a réussi à se récupérer, parce que certaines ne se récupèrent pas et en meurent, a le devoir de parler pour les autres. Moi, c’est grâce à mes enfants que je ne me suis pas suicidée. Je ne serai pas tranquille tant que je n’aurai pas restitué ce que j’ai réussi à surpasser », affirme-t-elle, dans une de ces envolées affûtées qu’elle formule parfois. Ce livre, Dire vrai, qui paraît aux éditions Denoël ce 1er mai, n’aurait peut-être jamais existé sans un voyage en train. Celui qui relie la Drôme, où vit, depuis le confinement, l’autrice et réalisatrice de 41 ans, et Paris, qu’elle rejoint pour ses obligations. A bord de ce TGV, en avril 2023, une passagère très agitée agresse les passagers. Isild Le Besco se lève et lui demande de partir. La femme, âgée d’une vingtaine d’années, l’insulte, lui assène des coups de poing, lui plante un doigt dans l’œil. Elle s’en sort avec une cornée abîmée, vingt-quatre jours d’incapacité temporaire de travail et le besoin de répéter en boucle au téléphone à sa petite sœur qu’elle n’est « pas une victime ». Son agression dans le train constitue la scène d’ouverture de son livre. Cet événement est aussi le début d’une prise de conscience : les violences qu’elle a subies ne sont pas des incidents isolés, mais des événements liés qui s’autoengendrent. « Prisonnière de mes manques matériels et affectifs, j’étais le terrain parfait pour toutes les maltraitances », écrit-elle. Isild Le Besco trace une continuité entre son enfance, ses débuts dans le cinéma français, la relation de sa sœur aînée, l’actrice et réalisatrice Maïwenn, avec le metteur en scène et producteur Luc Besson, la prédation exercée sur elle par le cinéaste Benoît Jacquot (au début de leur relation Isild Le Besco a 16 ans, lui 52), l’histoire avec le père de ses enfants et le fait qu’aujourd’hui elle en ressorte broyée mais portée par la nécessité d’écrire pour se reconstruire. Son ouvrage vient s’ajouter à d’autres récits similaires produits ces dernières années par des femmes telles que Flavie Flament, Vanessa Springora, Camille Kouchner, Hélène Devynck ou Judith Chemla. Elle n’était pas encore prête Il y a à peine trois mois, nous avions déjà voulu rencontrer l’actrice, alors que nous enquêtions sur le cinéaste Benoît Jacquot, contre lequel la comédienne Judith Godrèche s’apprêtait à porter plainte pour « viol et violences sur mineure ». Mais Isild Le Besco, qui a joué le rôle principal dans Sade (2000) et Au fond des bois (2010), de Benoît Jacquot, qu’elle finira par quitter à 24 ans, n’était pas encore prête à « dire vrai ». Elle voulait trouver ses mots à l’écrit avant de les prononcer publiquement. Cette mère de deux adolescents de 12 et 14 ans s’était contentée de nous faire parvenir quelques phrases, où elle évoquait entre les lignes les atteintes subies. Cette phrase, notamment : « Comme pour beaucoup [de comédiennes], mon histoire personnelle me prédisposait à être utilisée, objectifiée ». Quelques semaines après la tempête qui s’est abattue sur le cinéma français, devant la gare où nous l’attendons, Isild Le Besco apparaît au volant d’une voiture familiale. Sous le vent froid et le soleil, elle s’enquiert de la qualité de notre voyage, regrette une météo décevante pour la saison. Des échanges de banalités pour commencer, comme s’il fallait recouvrir l’intimité de son livre. La voiture grimpe un chemin escarpé, franchit un portail en fer forgé pour se garer à proximité d’une grande maison des années 1960 aux volets lavande. La piscine n’a pas encore été remplie, l’herbe est haute. Des chiens et des chats s’ébrouent au milieu de jeux d’enfants. Dans la cuisine, les murs sont recouverts de tableaux peints par la propriétaire des lieux et où figurent souvent des personnages sans visage. Les meubles aussi sont peints, bleu roi, pourpre, doré. Isild Le Besco porte une chemise rose fluo, propose un thé vert fluo, qu’elle sert en cherchant une feuille pour écrire. L’entretien n’a pas démarré, mais c’est elle qui s’attache à prendre des notes de la discussion informelle, au revers d’un dessin de son fils. Elle y inscrit des expressions comme « le viol est une annexion mentale » ou « la parole des victimes génère un effet de rupture de sens ». Elle commence à préparer le déjeuner, taille un concombre en biseau, s’interroge : « Faut-il avoir été soi-même victime de violence pour comprendre son fonctionnement ? » La violence vécue attaque la capacité des victimes à se lier. Pour Isild Le Besco comme pour les autres, il y a toujours un saut à faire, un pari à prendre : celui de faire confiance à son interlocuteur et de sauter dans le vide. La cucurbitacée prête, elle décide de tutoyer. « Les blessures physiques au moins, ça se voit, ça donne le droit d’être victime », dit-elle, revenant sur son agression dans le TGV. A la suite de cet événement, elle s’enferme chez elle, délaisse son portable et dort pendant trois semaines. Quand elle se réveille, elle se demande ce qu’elle a fait de mal pour mériter tout ça, puis contacte une amie médecin à l’étranger qui dresse ce diagnostic : « You don’t embrace yourself. » Elle se met à noircir les pages de son ordinateur, pour tenter de « s’aimer » elle-même. Elle réfute toute impudeur. « Les faits que j’ai subis n’ont rien à voir avec mon intimité, revendique-t-elle. Ça n’est pas évident de s’en défaire, mais ce n’est pas ma vie, cela ne me définit pas. » La violence, une langue natale La violence est une langue natale que l’on apprend dans les maltraitances de l’enfance, dans les négligences du quotidien. Avec ses frères et sœurs, Maïwenn, Jowan, Léonor et Kolia, Isild grandit à Belleville, dans la précarité d’une vie parisienne ballottée entre ses parents séparés. Dans le même immeuble vivent alors ses grands-parents maternels au premier et son père, au quatrième. Depuis la séparation, sa mère a déménagé quelques rues plus loin. Le père, Patrick Le Besco, un ethnolinguiste brillant et cultivé, parle une dizaine de langues mais peine à s’adresser à ses enfants, à s’en occuper même, et donne des coups. Ce Franco-Vietnamien, issu d’une famille de militaires affectés en Indochine, n’a pas assez de lits pour accueillir ses petits et, selon sa fille, ne leur sert à manger que du riz au nuoc-mâm et des yaourts nature. « Je n’ai pas le souvenir de m’être endormie dans un lit propre, avec des draps frais », écrit l’actrice, qui ménage malgré tout son géniteur : « Il nous a donné toute l’affection dont il était capable. » Elle garde aussi de la bienveillance pour sa mère, Catherine Belkhodja, fille d’un Berbère combattant du côté du FLN pendant la guerre d’Algérie et d’une infirmière issue d’un milieu ouvrier qui se sont rencontrés dans une cellule du Parti communiste. « Une marginale, une femme libre » et une « beauté puissante », qu’Isild Le Besco trouverait « fascinante » si elle n’avait pas également un rôle de mère à tenir. Car elle aussi est violente, écrit-elle. « Je me souviens de la dernière fois : ma mère m’avait tapée si fort que je m’étais évanouie. Je m’étais dit que c’était fini, que je me défendrais désormais. Elle n’a plus recommencé. » Elle ajoute : « On ne sait pas vraiment comment c’était, la vie de notre mère avant nous. ». Enfant, Catherine Belkhodja subit les coups de son propre père autoritaire, quand sa mère s’enfonce dans la dépression. Sa sœur finit par se suicider au Destop après de nombreuses poussées psychotiques. Dans la case « profession de la mère », sur les fiches à compléter pour l’école, Isild Le Besco n’a pas assez de place pour donner la liste des métiers exercés par la sienne, ex-égérie du cinéaste Chris Marker : « actrice, réalisatrice, journaliste, peintre, architecte, philosophe… ». Une non-éducation sauvage et destructurée Catherine Belkhodja ne remplit pas le frigo de l’appartement, n’offre aucune sécurité affective ou économique à ses enfants, mais elle leur donne accès aux meilleures formations artistiques, dans le but assumé qu’ils deviennent des stars, quel que soit le domaine. « Mes parents étaient autoritaires et violents. (…) Ils m’ont transmis autant leurs schémas toxiques que la force de ne pas m’en contenter », proclame dans son livre l’autrice, qui les remercie néanmoins pour leur transmission d’une « liberté créative et profonde ». Cette non-éducation sauvage et déstructurée, Isild Le Besco l’a racontée dans son premier film, Demi-tarif (2003), tourné avec une seule caméra alors qu’elle avait 17 ans. Un moyen-métrage brut et bouleversant, filmé à hauteur d’enfant, qui dépeint l’existence de trois gamins livrés à eux-mêmes, obligés de survivre dans l’absence obsédante de leur mère. Œuvre saluée à sa sortie par Chris Marker, Jean-Luc Godard et la presse. Catherine Belkhodja a lu le livre d’Isild Le Besco il y a quelques jours seulement. Jugeant certaines anecdotes « parfois légèrement exagérées », elle salue néanmoins le résultat auprès de M Le magazine du Monde : « La démarche d’Isild me semble d’une très grande sincérité. Ce qui compte surtout, c’est sa perception et son vécu sur les choses, qu’elle analyse et décrypte avec beaucoup de lucidité et de courage. (…) Je trouve ce livre merveilleusement écrit. Par ces pages, on peut mieux comprendre le processus de l’emprise. Isild a toujours refusé de se considérer comme victime. C’est un vaillant petit soldat qui affronte tous les obstacles en refusant d’écouter ses faiblesses. » Interrogée sur les maltraitances qui lui sont reprochées, elle reconnaît « une certaine rudesse, pour que [ses filles] soient fortes et autonomes ». Et regrette que, du fait de sa vie « un peu acrobatique », elle n’ait « peut-être (…) pas su leur exprimer tranquillement tout [son] amour et [son] affection. » Le père, Patrick Le Besco, n’a pas eu connaissance du texte avant sa sortie. « Bien que je n’aie pas lu le livre d’Isild, je respecte infiniment son ressenti, ainsi que celui de tous mes enfants. Je soutiens ce travail de réparation qu’elle entame car c’est aussi une forme de réparation pour moi », écrit-il à M. Il tient à évoquer le contexte post-colonial de l’époque : « Je me suis marié en 1975, moi, venant d’une famille de militaires ayant effectué leur carrière aux colonies, avec une femme dont le père avait été militant actif du FLN en région parisienne. Deux mémoires conflictuelles. Le contexte dans lequel nous vivions était à fleur de peau, marqué par la mémoire de nos parents que, sans nous en rendre compte, nous reproduisions. » Les membres de la fratrie ont lu le livre avant sa publication. Le plus jeune demi-frère, Kolia Litscher, 33 ans, salue le travail entrepris : « Isild a pris pleinement conscience de ce qu’elle a vécu. Avant, elle savait que quelque chose n’était pas normal. Elle est en train de ranger ses pensées, elle est sur la bonne voie. » Jowan Le Besco, 42 ans, se montre admiratif : « Je la soutiens complètement. Elle ne fabule pas. C’est très courageux de sa part, se livrer ainsi n’est pas naturel pour elle, c’est difficile. » La cadette d’Isild, sa demi-sœur Léonor Graser, 39 ans, a participé à l’accouchement de ce texte rédigé en quelques mois, en aidant l’autrice de Dire vrai à mettre ses notes en forme. Elle constate avec joie que sa grande sœur n’est plus aussi fragile et hermétique que par le passé. « Le changement est radical, extraordinaire », observe Léonor Graser. Un réflexe de soumission Il n’y a que l’aînée, la plus célèbre de la famille, qui n’a pas lu le texte avant sa parution. Réalisatrice à succès du cinéma français, autrice des films Polisse (2011), Mon roi (2015), Jeanne du Barry (2023), Maïwenn, 48 ans, apparaît pourtant dès la quatrième page du récit d’Isild Le Besco, avec l’évocation d’un souvenir récent. En 2019, les deux sœurs marchent dans la rue avec une amie, à la sortie d’une projection. La plus âgée se décrit soudain en enfant battue, dit vouloir porter plainte contre leurs parents. Elle craque, tape contre un arbre. Isild étreint Maïwenn, la console – « Je t’aime, ne m’en veux pas, ne disparais pas », sanglote l’aînée. S’ensuit une nuit blanche passée ensemble consacrée « à pleurer [leur] drame commun ». C’est aussi la dernière fois, selon Isild Le Besco, que les deux femmes ont réussi à s’accorder. Aujourd’hui, elles ont coupé les ponts, ne se voient plus, ne se parlent plus. « Elle manque à notre radeau de survivants », écrit la plus jeune. « Enfant, Isild était en admiration de Maïwenn, c’était fusionnel, se souvient une amie des deux sœurs, qui ne souhaite pas être nommée. Mais aujourd’hui il y a une incompatibilité entre elles, car Isild n’est plus docile. Et Maïwenn a besoin de gens qui valident sa façon d’être et de faire. » L’héritage traumatique légué par les parents peut provoquer un réflexe de soumission à plus fort que soi pour survivre. C’est ainsi qu’Isild Le Besco relit aujourd’hui la rencontre de sa grande sœur, Maïwenn, 15 ans à l’époque et aspirante comédienne, avec un homme de 31 ans, déjà célèbre, Luc Besson. Pour elle, la différence d’âge et de situation sociale était telle que la relation entre sa sœur et le réalisateur à succès de Subway (1985), du Grand Bleu (1988) et de Léon (1994) n’a cessé d’être déséquilibrée. Isild Le Besco n’a jamais accepté non plus que Luc Besson quitte sa sœur, alors jeune mère. Sollicitée pour cet article, Maïwenn n’a pas répondu. « Nous n’avons rien à voir l’une avec l’autre. Je ne veux pas qu’on m’associe à elle », a déclaré, le 20 avril, Maïwenn à propos de sa sœur dans le journal en ligne britannique The Independent. Maïwenn, la deuxième maman En 1991, Maïwenn, la deuxième maman des « enfants sauvages de Belleville », quitte le désordre et la pauvreté de l’appartement du 19e arrondissement de Paris pour rejoindre son compagnon et le luxe dans lequel il baigne. « Luc incarnait le rêve d’un ailleurs, une porte de sortie qui s’est avérée être une boucherie », éclaire Isild Le Besco au cours de notre conversation. Elle se souvient des appartements aux couloirs immenses, des séjours à Eurodisney et des vacances dans la demeure avec piscine du réalisateur : « Nous passions du confort des somptueuses propriétés de Luc à notre taudis. De ma grande sœur adorée, chaleureuse et joueuse, au vide affectif et à la violence. » Sur les tables de nuit du cinéaste, la jeune Isild tombe sur des grosses coupures. Elle culpabilise en pensant à son père qui, lui, dit ne vivre qu’avec 1 franc par semaine et elle dépose parfois dans son portefeuille un billet subtilisé. Quelques mois plus tard, lors d’un voyage de classe, la maîtresse de l’un des membres de la fratrie découvre, en guise de contenu de sa valise, un tas de vêtements sales. Elle fait un signalement à la DDASS, qui n’aboutit pas en placement car, écrit Isild Le Besco, « Luc s’est présenté avec ma sœur à un rendez-vous pour s’engager à protéger l’équilibre de notre vie. Maïwenn était encore mineure, et lui, il allait devenir notre garant parce qu’il était riche et connu. » Avec vingt-cinq ans de recul, Isild Le Besco se réjouit de ne pas avoir été placée, mais regrette que les services sociaux ne se soient pas interrogés sur l’âge de ce « sauveur ». 1993. Maïwenn, 16 ans, accouche de Shanna, la fille du couple qu’elle forme avec Luc Besson, et part vivre à Los Angeles avec le cinéaste. Le réalisateur travaille alors sur Le Cinquième Elément (1997), qui deviendra à l’époque le plus grand succès commercial d’un film français à l’étranger. Sur le tournage, il rencontre Milla Jovovich, 21 ans à l’époque, l’actrice principale, pour laquelle il quitte Maïwenn. Isild Le Besco ressent encore aujourd’hui dans son propre corps l’humiliation de sa sœur : « Après coup, cela donne l’impression qu’on faisait partie d’un film où Luc se donnait le beau rôle et où nous étions le prolongement de notre sœur aînée. Et puis, il a zappé le film. » Adolescente, celle qui adore garder sa nièce voit sa grande sœur, revenue seule des Etats-Unis, devenir mère célibataire précaire. Isild Le Besco se retrouve à jouer les intermédiaires avec Luc Besson. « Ma sœur voulait que je demande à Luc de faire quelques courses : la pension alimentaire qu’il lui versait était insuffisante », raconte-t-elle. Elle se rend chez lui, lui demande d’acheter du lait de soja pour la fillette. « D’un air de chien battu, il me répondait comme un pauvre homme qu’il ne pouvait pas se permettre ça. Il avait fait un enfant à ma sœur de 16 ans, l’avait trompée, puis abandonnée, et rechignait désormais à dépenser pour que son enfant mange », poursuit-elle. Contacté par l’intermédiaire du porte-parole de sa société, Luc Besson indique « attendre la parution du livre » pour réagir. Emmanuelle Bercot et la sexualisation des jeunes filles Sur la terrasse de sa maison drômoise, Isild Le Besco porte alternativement un chapeau pour se protéger du soleil et un manteau quand les nuages s’amoncellent. Elle hésite de la même façon quand il s’agit d’aborder ses débuts de comédienne dans le cinéma français auprès de réalisatrices : « Elles ont probablement été traitées comme des choses dans leur jeunesse, peut-être pire même, mais c’est l’illustration d’une époque, de comment on traite une petite fille sur un plateau et plus largement dans le monde. » En août 1997, l’été de ses 14 ans, elle tient le premier rôle du film d’une jeune metteuse en scène de même pas 30 ans qui sort tout juste de la Fémis, Emmanuelle Bercot. Le scénario du moyen-métrage La Puce (1998), dans lequel jouent plusieurs membres de la famille d’Isild, dont sa mère, n’a rien à envier à ceux de ses homologues masculins de l’époque, comme Benoît Jacquot ou Jacques Doillon, en termes de sexualisation des jeunes filles. C’est l’histoire d’une adolescente qui se donne à un homme bien plus âgé. La comédienne se rappelle encore le malaise qui l’avait saisie au moment de tourner la scène du dépucelage de son personnage, lorsqu’elle est confrontée à l’érection de son partenaire. Deux ans plus tard, elle tourne pour Emmanuelle Bercot dans Le Choix d’Elodie (1999), un téléfilm qui sera diffusé sur M6. « Elle m’avait fait jouer la première, j’étais prête à tout pour elle », déclare-t-elle. Peut-on filmer la violence sans être violent ? Isild Le Besco en est convaincue. Elle raconte la trentaine de gifles de plus en plus fortes, comme autant de prises nécessaires, pour la scène où la mère d’Élodie lui met une claque. L’adolescente ressent trop d’admiration à l’endroit de la réalisatrice pour oser lui dire stop et qu’elle a mal. « J’étais dans un état de survie émotionnelle, j’étais choisie plus que je ne choisissais ». Emmanuelle Bercot n’a pas souhaité réagir : « Je ne saurais vous être utile », nous a-t-elle répondu. Grâce à ses premiers cachets, Isild Le Besco peut aider sa mère à payer le loyer de l’appartement, où elle vit désormais en autonomie avec ses frères et sœurs. Parfois, un directeur d’école appelle à la maison pour leur demander d’arrêter de sécher les cours ou la police intervient après des vols dans des magasins. Rares souvenirs d’autorité pour l’artiste, qui arrête l’école après avoir raté son brevet. Benoît Jacquot, rencontré à 16 ans L’entretien, suspendu à la tombée du jour, n’a pas permis d’épuiser tous les sujets. Le lendemain, il fait toujours aussi froid et Isild Le Besco n’a plus de voix. Dans les ruelles étroites de la ville où elle vit, elle se demande si c’est le fait d’avoir tant parlé après un aussi long silence qui lui cause cette extinction. Un confortable salon de thé offre le cadre rassurant pour parler d’un autre personnage cardinal de sa vie et de son livre : Benoît Jacquot. Contactés, ni le cinéaste ni son avocate n’ont répondu à M. Isild Le Besco rencontre le réalisateur dans un café. Il a aimé sa prestation dans La Puce et convainc la jeune première de 16 ans de jouer Emilie de Lancris dans son prochain film consacré au marquis de Sade. Il met en place avec elle la même stratégie de conquête qu’avec Judith Godrèche sur le tournage des Mendiants, en 1986 : « Il a demandé à la production de me prendre une chambre dans le même hôtel que lui. Le soir, nous dînions en tête à tête. Il disait qu’il m’aimait beaucoup », développe-t-elle dans son livre. Sa mère l’a prévenue, cet homme-là a été avec toutes ses jeunes actrices : « Ça m’avait gênée qu’elle m’imagine cédant à ce vieux monsieur », écrit-elle. Elle se rappelle : « Benoît Jacquot avait l’obsession qu’on me voit nue, allongée, face caméra. Je ne le voulais pas et l’avais annoncé dès le départ. » Le week-end précédant le tournage de cette scène, en 1999, il lui donne sa carte bancaire et, raconte-t-elle, l’autorise à acheter tout ce qu’elle veut : « Une carte bleue contre mon corps d’adolescente et le dépassement de mes limites. » Isild et sa fratrie dévalisent le supermarché de bonbons, de gâteaux et de boissons. La semaine suivante, l’actrice accepte de jouer la scène érotique tant désirée par le réalisateur. Mais, juste après, il porte plainte pour le vol de sa carte de crédit et elle se retrouve au commissariat, convoquée pour un interrogatoire qui dure des heures. À la demande du cinéaste, assure-t-elle, elle devra dire aux policiers qu’elle lui a emprunté sa carte pour lui faire une blague. Contrôle des vêtements, de la nourriture, du corps Le tournage achevé, Benoît Jacquot continue de solliciter Isild Le Besco. Il insiste pour l’emmener dans sa chambre d’hôtel, raconte la jeune femme, lui proposant de devenir son professeur, de lui apprendre à écrire des scénarios – il l’aidera notamment pour l’écriture de son deuxième film, Charly (2006). Immature, traumatisée par l’abandon de sa sœur par Luc Besson, Isild Le Besco pense se protéger de la blessure amoureuse en veillant à ne pas s’attacher à Benoît Jacquot. Le réalisateur l’emmène à Venise, comme il l’a fait avec Judith Godrèche et le fera plus tard avec Julia Roy, qui ont toutes deux porté contre lui des accusations recueillies par le parquet de Paris dans le cadre d’une enquête préliminaire. « C’est sur l’un de ces si jolis ponts, au-dessus des gondoles, que Benoît m’a giflée pour la première fois », écrit Isild Le Besco. Il lui a promis de ne jamais la toucher mais se montre de plus en plus pressant pour obtenir des rapports sexuels. Ils finissent par avoir lieu, sans tendresse dit-elle, sans baisers ni mots doux. Elle l’a vécu avec souffrance et le sentiment d’être en apnée, dans l’attente que ça passe. Leur relation se poursuit plusieurs années, même s’ils ne vivent pas ensemble et que Benoît Jacquot est marié. Il établit des règles identiques à celles qu’ont vécues d’autres de ses compagnes, sur le contrôle des vêtements, de la nourriture et du corps, le tout s’accompagnant du dénigrement permanent des femmes ayant le malheur d’avoir plus de 25 ans. Lors d’un voyage au Japon, le réceptionniste refuse qu’ils fassent chambre commune : la jeune femme est encore mineure. Ailleurs, en Italie, et à une autre époque, Judith Godrèche a vécu la même scène. « Avec Benoît Jacquot, c’était une relation d’emprise, juge Léonor Graser. Il était devenu la personne de référence. Tout ce qu’il disait, elle le répétait ensuite. Elle était coupée de tout le monde à l’époque, elle ne faisait que travailler. On se voyait, certes, mais il n’y avait pas d’espace pour parler, pour commenter son mode de vie, tout ça était complètement normalisé. » A l’époque, le comédien et réalisateur Jérémie Elkaïm était proche d’Isild Le Besco et « militai[t] pour qu’elle fasse des rencontres » : « Je voyais que cela n’allait pas, il était indéniable que tout n’était pas dans les bons écrous. Mais il était aussi indéniable que cette histoire lui donnait une force spectaculaire. Je la trouvais absolument incroyable. Ce mélange de liberté et de sauvagerie chez elle vous donnait l’impression d’avoir pleinement affaire à une artiste. » Isild Le Besco a d’autant plus de mal à quitter Benoît Jacquot – auquel elle se réjouit de n’avoir jamais dit « je t’aime » – qu’il lui fait du chantage au suicide. Une nuit de 2007, alors que la séparation est enfin enclenchée, il l’appelle, désespéré, dit qu’il ne peut pas vivre sans elle et qu’il va sauter par la fenêtre. Elle traverse tout Paris pour le calmer. Il finit, selon elle, par la pousser dans les escaliers du cinquième étage. Elle rentre brisée et secouée, le poignet et le bras douloureux, comme l’a confirmé une amie témoin de la scène qui a souhaité rester anonyme. « Quand je l’ai quitté pour de bon, Benoît a juré de me nuire, écrit Isild Le Besco : je ne ferais plus de films, ni comme actrice, ni comme réalisatrice. Mon génie, c’est lui qui l’avait créé. » Cette phrase, Julia Roy aussi l’a entendue. Impossible de mesurer les conséquences de ces menaces, mais les deux femmes n’ont presque plus tourné après avoir quitté Benoît Jacquot. Une histoire trop douloureuse pour être racontée Dans les années qui suivent la rupture, Isild Le Besco peint, écrit, poursuit sa carrière de réalisatrice, avec le film Bas-Fonds (2010), qui se distingue par sa noirceur dans la description de l’enfance. Dans son livre, elle reconnaît avoir eu des comportements abusifs en tant que cinéaste, notamment sur son petit frère de 14 ans quand elle le fait tourner. « Qui suis-je pour dénoncer les autres si je n’étudie pas ma propre domination ? » Après Benoît Jacquot, elle se met en couple avec un photographe, le père de ses deux garçons. La violence l’avale de nouveau. Sur cette histoire, trop douloureuse, Isild Le Besco n’est pas encore prête à parler. En 2018, un an après l’explosion du mouvement MeToo, elle voit Natalie Portman, sa copine d’adolescence rencontrée par l’intermédiaire de Luc Besson, dénoncer le mauvais souvenir de l’hypersexualisation subie sur le tournage de Léon. Tous ces instants de prise de conscience s’agrègent peu à peu, jusqu’à la bascule opérée à la suite de l’agression dans le TGV. A l’origine, Isild Le Besco a écrit son texte pour elle, et non pour le publier. Mais Judith Godrèche rend les choses urgentes. Benoît Jacquot a vu Icon of French Cinema, la série de cette dernière pour Arte, et s’inquiète pour sa réputation. Il envisagerait de porter plainte pour diffamation, comme il l’explique en décembre 2023 à Isild Le Besco autour d’un café qu’elle a accepté de prendre avec lui. Tandis qu’il cherche son soutien, elle tente de lui expliquer le mal qu’il lui a fait : « J’aime bien les oppositions civilisées, j’essayais de remettre les choses à leur place, pour ne pas être encombrée par la colère après ce qu’il m’a fait », argumente-t-elle aujourd’hui. Il s’excuse vaguement, lui propose, dit-elle, de réaliser avec elle un film sur une femme de Picasso anéantie par la toxicité du peintre. « Les prédateurs n’intègrent jamais la version de leur proie », relève dans son livre Isild Le Besco. Que faire de ce mot « viol » ? En février 2024, les enfances volées par Benoît Jacquot sont donc devenues une procédure judiciaire. La policière chargée de l’enquête appelle plusieurs fois Isild Le Besco pour l’auditionner – en vain, jusqu’à présent. « Ça m’énerve ce traitement de faveur qu’on accorde aux stars », justifie-t-elle. Elle se pose des questions. La première : contre qui doit-elle porter plainte ? Contre ses parents violents ? Contre Benoît Jacquot ? Contre Luc Besson, coupable à ses yeux d’avoir « condamné Maïwenn à voir [leur] histoire comme une histoire d’amour » parce qu’ils ont eu une fille ensemble ? Contre la sexualisation des jeunes filles par le cinéma français ? « Ou suis-je victime de n’avoir pas habité mon propre corps quand d’autres l’utilisaient ? Suis-je victime de n’avoir pas su me défendre moi-même ? » A l’endroit de Benoît Jacquot, l’autrice et réalisatrice se trouve face à sa deuxième interrogation : la qualification des faits. Que faire de ce mot, « viol », qu’elle écrit en toutes lettres mais considère trop réducteur ? « Dire que Benoît m’a violée, c’est évident », juge-t-elle, mais aussi approximatif, car il a d’abord, selon elle, « violé [son] esprit » pour obtenir son corps. « Comme tout prédateur, Benoît ne fait pas l’amour. Le sexe n’est qu’un outil, comme on ferait des trous avec un marteau-piqueur pour fragiliser les murs d’un édifice. Ce n’est pas le fait de faire des trous qui importe, c’est le résultat. L’acte sexuel permet de s’emparer de l’autre jusque dans les profondeurs de l’être. » Ecrire ces lignes a été violent pour Isild Le Besco. Douleurs au ventre, insomnies : les symptômes classiques du traumatisme réactivé. Le salon de thé s’est vidé. Il ne reste plus que nous, dissertant sur l’existence de traces matérielles de ses affirmations : des fragments, des lettres ou des documents qui renforceraient son récit. Tout est stocké dans des boîtes fermées, qu’elle ouvre sitôt rentrée chez elle. Isild Le Besco nous envoie des photos de cartons ouverts, d’albums jetés par terre. Le lendemain, lors d’un dernier déjeuner, elle arrive le sac à main lourd des images qu’elle veut nous montrer. On la voit, si juvénile, sur ses tournages d’adolescente. Ou en compagnie de ses frères, de Maïwenn et de Luc Besson attablés dans un restaurant aux Etats-Unis, dans une étrange image de recomposition familiale. Isild Le Besco nous raccompagne à la gare où des trains de marchandises passent sans s’arrêter. Le fracas masque le bruit de ses larmes. Bientôt, c’est elle qui montera à Paris, pour porter sa volonté de « dire vrai ». Lorraine de Foucher Jérôme Lefilliâtre pour M le magazine du Monde Légende photo : Isild Le Besco, chez elle, dans la Drôme, le 22 avril 2024. BETTINA PITTALUGA POUR M LE MAGAZINE DU MONDE
Par Gilles Rof (Marseille, correspondant du Monde), publié le 30 avril 2024
Habitantes et artistes s’installent dans des bars du quartier populaire de la Belle-de-Mai, créant des moments de mixité dans ces lieux fréquentés exclusivement par des hommes.
Lire l'article sur le site du "Monde" :
https://www.lemonde.fr/culture/article/2024/04/30/a-marseille-le-festival-les-plus-belles-de-mai-impose-les-femmes-dans-l-espace-public_6230827_3246.html
Elles sont huit, alignées épaule contre épaule, têtes hautes et regards fiers. Les femmes du collectif Mira, toutes habitantes du quartier de la Belle-de-Mai dans le 3e arrondissement de Marseille, scandent, à tour de rôle, « Je suis F », un texte écrit par l’une d’elles. En quelques minutes à peine, ces femmes de tous âges et de toutes origines se passent le micro pour se décharger des mêmes mots, qu’elles lisent sur leur smartphone. En français, en arabe, en kabyle, en russe, en allemand, en espagnol, la litanie se répète. Oscillant entre l’urgence de dire et l’euphorie joyeuse d’avoir le courage de le faire, là sur une place publique. « Je suis Fidélité, je suis Fertilité, je suis Fragilité, je suis Force, je suis Futur (…). Je suis Femme. » Depuis trois semaines, ce rituel puissant secoue chaque samedi, en début de soirée, les habitudes de la Belle-de-Mai, un quartier populaire et cosmopolite situé en bordure du centre-ville, l’un des plus pauvres de Marseille. Un court moment d’expression en forme de coup de poing, qui dit tout de l’intention politique de la première édition du festival Les Plus Belles de Mai. « Contribuer à redonner aux femmes leur place dans un espace public trusté par les hommes et où elles ne se sentent pas légitimes », résume Christine Bouvier, directrice artistique de l’association RedPlexus, spécialisée dans les performances urbaines, et programmatrice de l’événement. Volontairement nomade, le festival s’installe tous les week-ends, du 13 avril au 4 mai, sur la terrasse d’un bar différent, à cheval sur la voie. Quatre étapes où se mêlent propositions gratuites de danse, concerts, projections, expositions mais aussi apéros et repas conviviaux… Et, en fil rouge, cette performance amateur des femmes du collectif Mira. « Etre acceptées ici, sans être jugées » Ce samedi 27 avril, où la tempête souffle, la scène est installée en plein cœur du quartier, place Caffo. Après le bar Marius et le restaurant cap-verdien Les Délices de Praia, c’est le Café du Théâtre, tenu depuis treize ans par Ghalia Ferrat, tonique quinquagénaire d’origine kabyle, qui accueille artistes et spectateurs. « On s’est aperçu que si leur clientèle était presque exclusivement masculine, certains bars étaient tenus par des femmes. On a décidé de les solliciter pour le festival », s’étonne Christine Bouvier. Au fond de la salle, un groupe d’hommes, attablé devant un stock de bières plongées dans des glaçons, observe silencieusement cette invasion de leur territoire. D’autres habitués, tout sourire, abordent les femmes du collectif pour les remercier de leur présence. « Vous ne savez pas le changement que c’est d’être acceptées ici, sans être jugées », exulte, quelques minutes après sa performance dans une moulante robe noire, Dalida Zouachi, 50 ans, dont la moitié passée à la Belle-de-Mai, une des locomotives du collectif Mira. « En faisant cela, on donne le courage à d’autres femmes qui hésitent encore à se montrer », assure son amie Zelikha Eldjou, autrice de Je suis F. « Sans caricaturer ce quartier, on sait qu’ici, culturellement, c’est mal vu pour les femmes d’entrer dans un bar, ne serait-ce que pour boire un café. Le bar, c’est l’alcool, le lieu où les hommes boivent. En proposant de le faire de manière festive et collective, cela devient plus facile », analyse Emilia Sinsoilliez. Première adjointe de la mairie du 2e secteur chargée des solidarités et de la démocratie permanente, membre du Parti pirate, cette enseignante de 46 ans est à l’origine des Plus Belles de Mai. Elle travaille et habite dans le quartier, et en connaît parfaitement les problématiques – précarité, violence, surreprésentation des mères seules, poids du religieux – mais aussi les atouts. Nombreux acteurs et lieux culturels La Belle-de-Mai fourmille d’associations d’habitants dynamiques et concentre de nombreux acteurs et lieux culturels, attirés là par les friches industrielles et les bas loyers. Des énergies qu’elle a su fédérer. « Il fallait absolument que les femmes du quartier soient présentes. Avec elles, cela devient très intergénérationnel, intercommunautaire : les grands-mères sont là, les enfants aussi… », explique l’élue. En distribuant des tracts devant les écoles, des sacs promotionnels pendant l’événement, en offrant du sirop aux mamans et à leurs progénitures et en s’appuyant sur les collectifs féminins comme Mira, le festival, doté d’un budget de 23 000 euros de subventions municipales, s’est rendu plus attractif. Une volonté d’accessibilité qui n’a pas poussé à édulcorer la proposition artistique, axée sur la notion d’être une femme dans l’espace public. « Ce n’est pas parce que c’est la Belle-de-Mai que je vais mettre un filtre », assume Christine Bouvier. Samedi 27 avril, sa programmation proposait ainsi la performance dansée Natura morta, où deux femmes en minijupe et bustier rembourré gobent des bananes à pleine bouche ou écrasent des tomates avec leurs fesses avant de se retourner contre l’homme qui les exploite. Une proposition choc pour une partie de l’assistance. « Mais il flotte autour du festival un contexte de bienveillance », assure la danseuse Barbara Sarreau. La semaine précédente, la chorégraphe s’est frottée au défi de se produire en pleine rue. « Ici, on n’est pas dans la langue de bois d’un discours artistique. On se jette au cœur des choses », constate-t-elle. Festival Les Plus Belles de Mai, à Marseille. Prochaine date : samedi 4 mai. Gilles Rof (Marseille, correspondant du Monde)
Sur la page de l'émission d'Arnaud Laporte, Affaires culturelles, sur France Culture, le 29 avril 2024 Alors que Jean Bellorini lui a commandé une variation sur le thème d’Orphée, qui se joue en ce moment aux Bouffes du Nord sous le titre “Le Jeu des Ombres”, l’auteur, peintre et metteur en scène Valère Novarina vient nous parler des sources de son imaginaire. Ecoute en ligne ou podcast de l'entretien (58 mn) On peut le dire dramaturge, essayiste, metteur en scène et peintre, lui se dit “écrivain”. C’est en effet pour écrire, en écrivant, et parce qu’il écrit que Valère Novarina se déploie par ailleurs. Il met en scène parce que le texte demande la parole – dans son langage, le Verbe demande la Chair – il théorise pour comprendre et peint pour donner une silhouette aux personnages de sa pensée. Depuis sa première pièce, L'Atelier volant, écrite en 1971 et mise en scène en 1974 par Jean-Pierre Sarrazac, Valère Novarina poursuit sans relâche et avec une certaine prolificité son travail autour du langage. Ses pièces, aux allures de parades tragiques et bouffonnes, voient souvent se succéder des milliers de personnages, venus porter sur scène une phrase, sitôt parus, sitôt évanouis. L’auteur du Drame de la vie (POL,1984), du Discours aux animaux (1987), de La Chair de l’homme (1995), se fait progressivement une place au sein du panthéon du théâtre contemporain, jusqu’à obtenir deux consécrations séculaires : son entrée au répertoire de la Comédie Française en 2006, avec L’Espace Furieux et l’ouverture du Festival d’Avignon en 2007, avec L’Acte Inconnu. Alors que Jean Bellorini lui a commandé une variation sur le thème d’Orphée, qui se joue en ce moment aux Bouffes du Nord sous le titre “Le Jeu des Ombres”, l’auteur, peintre et metteur en scène Valère Novarina vient nous parler de la fabrique de son art. L'écriture comme une honte Valère Novarina passe son enfance et son adolescence à Thonon-les-Bains, ville du Chablais savoyard. À huit ou neuf ans, il entre en pension à Morzine, chez Madame Marullaz. C’est là qu’il a commencé à écrire, d’abord des poèmes et des théories scientifiques, qu’il cachait sous des pierres. "L'écriture était une honte. C'était quelque chose que personne ne devait savoir, c'était entre la langue française et moi que ça se passait. À tel point qu'à Thonon, j'avais un petit carnet vert avec des tas de réfutations, à ma façon, des pensées de Pascal, des déclarations. Et mes camarades avaient repéré ce carnet. Un jour, il y a eu une course folle pour me piquer le carnet. J'ai couru comme une antilope tellement il fallait fuir. C'était très violent. La première personne à qui j'ai donné quelque chose à lire, c'était mon professeur Bernard Dort. Je me souviens, je suis allé dans son appartement lui donner le livre, j'étais complètement hébété. Je lui ai dis : « Je suis content que ce soit fini, je suis content que ce soit terminé. » Le rapport était très charnel, très violent et exagéré." Les Nuits de France Culture 2h 30 L'appel de la parole Pour Valère Novarina, le verbe agit, le langage est un événement de la nature. Lecteur des Écritures, le prologue de l’évangile selon Saint Jean, « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu » et les travaux de Saint Augustin d’Hippone, résonnent avec la conception du langage de l'écrivain. "Ce qui est curieux, c'est que les protestants traduisent « au commencement était la parole », les catholiques « au commencement était le verbe », et Hegel « au commencement était la raison ». C'est extraordinaire tout ce qui se joue autour de l'appel, autour de la création par la parole, l'appel de la parole. L'idée que la parole appelle. Elle ne désigne pas, elle ne tue pas, elle n'encercle pas, mais que les choses sont appelées. [...] Et puis, l'idée que la pensée achève le travail de la respiration. Entrer dans le corps, le passage par la mort qu'il y a dans la respiration puisqu'on s'étouffe un instant avant de reprendre, c'est l'idée que la pensée est un événement physique, matériel." Marcher sur une arête Depuis 1971 et sa première pièce, L'Atelier volant, Valère Novarina écrit pour le théâtre, parfois il met en scène ses créations, ou autrement les confie à des metteurs en scène. Cette fois-ci, le processus de création a été différent puisque c'est le metteur en scène Jean Bellorini qui lui a commandé une réécriture du mythe d'Orphée, une pièce nommée Le Jeu des Ombres (POL, 2020). Valère Novarina défend sa vision du métier de comédien : "Je souligne beaucoup que les acteurs doivent reprendre les textes dix ans, quinze ans après, comme les violoncellistes, les pianistes, qui n'iront jamais assez vers la partition primitive. Tout est là. Il faut y revenir tout le temps. Et puis, peu à peu, les langues s'accordent. C'est ce qui se passe dans le spectacle magnifique de Bellorini. Les acteurs se rejoignent. J'ai aussi la sensation que pour un acteur, le travail, c'est comme marcher sur une arête où il ne faut tomber ni à gauche ni à droite. C'est très délicat et que ça tient à des riens. L'émotion tient à des riens du tout." Fictions / Théâtre et Cie Le langage et l'espace Au théâtre, contrairement à la littérature, il faut pour Valère Novarina parvenir à faire coexister deux fondamentaux : le langage et l'espace. Il est donc nécessaire de pouvoir en tant que spectateur situer la trajectoire des voix des comédiens depuis un endroit de la scène à un autre, ce qui est rendu difficile par l'utilisation de micros. "Il faut vraiment le langage et l'espace, les deux protagonistes. S'il n'y a plus d'espace, parce qu'il y a des micros, c'est fini. Je trouve que la beauté, c'est le son non-amplifié, sinon ça tue quelque chose. C'est pour ça que les sermons avec des micros sont bien moins bons qu'il y a 40 ans. C'est un autre rapport à la construction des choses dans l'espace. Une conversation, un échange, c'est une sculpture entre nous. Je ne parle pas de mes idées, je vous les vends, il n'y a rien de frontal. On anime un corps mystérieux, un corps de langage entre nous qui est créé par le fait qu'on s'est adressé la parole." En savoir plus sur les actualités de l'invité : - Le Jeu des Ombres, de Valère Novarina, mis en scène par Jean Bellorini joue du 25 avril au 5 mai au Théâtre des Bouffes du Nord. Avec les comédiens et comédiennes François Deblock, Mathieu Delmonté, Karyll Elgrichi, Anke Engelsmann, Aliénor Feix, Jacques Hadjaje, Clara Mayer, Laurence Mayor, Liza Alegria Ndikita, Marc Plas et Ulrich Verdoni, et les musiciens Anthony Caillet, Guilhem Fabre, Barbara Le Liepvre et Benoit Prisset.
Présentation de la pièce : Jean Bellorini confie à Valère Novarina la réécriture du mythe d’Orphée. Dans un monde en cendres, une communauté d’âmes en peine cherche à réanimer le langage et à réenchanter l’espace… À la consumation du langage, répond l’éclat du verbe qui s’allume. À la descente progressive aux enfers, répond la joie d’être au monde.
En écho lointain au mythe d’Orphée, Le Jeu des Ombres est une plongée joyeuse dans une langue exubérante, en dialogue avec les grands thèmes musicaux de L’Orfeo de Claudio Monteverdi.
A venir : - Une invitation à la maison française de New-York le jeudi 2 mai, rencontre publique organisée par Laure Adler et une discussion avec les étudiants de la New-York University le vendredi 3 mai.
- Une intervention à la Halle saint Pierre à Paris le samedi 18 mai 2024 dans le cadre du séminaire mensuel Art et Thérapie, sous la direction de Jean-Pierre Klein, directeur de l’INECAT et de François Dingremont, Docteur en esthétique et anthropologie de l’art.
- Le Discours aux animaux sera repris par André Marcon à Libourne le 22 juin 2024 dans le festival Littérature et Jardin puis à Banon le 20 juillet dans le festival Beckett.
- Les personnages de la pensée sera repris en 2026.
De Valère Novarina : Le Discours aux animaux, dit par André Marcon, enregistré en 1987 : écoute en ligne (1h12) Le Discours aux animaux - monologue écrit plus de dix ans après celui d'Adramélech - a été créé au Théâtre des Bouffes du Nord le 19 septembre 1986 par André Marcon. Une partie seulement du livre éponyme est jouée et sera publié plus tard indépendamment sous le titre L'Animal du temps , aux éditions P.O.L (en 1993). A la suite de la création, André Marcon a été enregistré deux fois, d'une traite, dans une cave de Saint Emilion, au milieu des fûts. C'est une de ces deux prises, faite hors studio et dans un lieu naturel, qui sera diffusée sur France culture en 1989.
Par Julia Wahl dans cult.news - 28 avril 2024 C’est un texte complexe que ce Poings, de Pauline Peyrade, où la typographie défie toute analyse univoque et, partant, toute facilité scénique. Pourtant, Céleste Germe et le collectif Das Plateau ont relevé le défi haut la main en présentant une proposition intelligente et sensible, qui fait vibrer sur le plateau du Monfort toute la violence du texte. VIOL/ENCES Cela commence sous les spotligts et les rumeurs d’une rave party, où MOI, la récitante, est venue s’amuser. Elle est happée par la danse et les chorégraphies de ses voisin.es. Un homme, toutefois, s’approche d’un peu près. De vraiment très près. De beaucoup trop près. « Crie, repousse-le », lui susurre une voix à laquelle elle n’arrive pas à obéir. C’est cette voix, TOI, qui, désormais, nous accompagnera. L’instance narrative est ainsi dédoublée en deux voix qui signifient la diffraction des victimes de viol et de violences conjugales. L’une nous raconte ce qu’elle vit à la première personne, une autre, plus lointaine, aux deuxième et troisième personnes : c’est toujours la même femme et, pourtant elle voit tout de loin, séparée par une vitre épaisse de son enveloppe corporelle. MOI/TOI Cette dissociation est rendue sur scène par un ingénieux dispositif, fait de miroirs et de projections, qui dédouble la comédienne en autant d’images. Des images, seulement, car MOI nous paraît lointaine, évanescente, comme si elle quittait son corps. Le jeu sur la profondeur du plateau participe de cet éloignement : une grande part de la pièce est jouée en fond de scène, séparée du public par une distance qui semble infranchissable. Si MOI quitte à un ou deux moments cette diffraction vaporeuse, c’est pour nous raconter longuement, face public, au proscenium cette fois, l’acmé des violences conjugales qu’elle vit ensuite. La voir de si près, dans toute sa dimension charnelle, crée un tel contraste avec les images qui précèdent que le nouveau viol – puisque c’est de cela qu’il s’agit – n’en résonne que plus fortement. CORPS/VOIX La langue de Pauline Peyrade est une langue rugueuse, qui accorde une large part aux litanies comme autant d’expressions du retour lancinant du trauma. Elle mêle la précision des notations concrètes aux évocations plus métaphoriques des troubles liés au traumatisme et à l’emprise – mais sont-ce seulement des métaphores ? La mise en scène de Céleste Germe est parfaitement servie par la prestation de Maëlys Ricordeau, qui prête à MOI et à TOI un corps et une voix qui oscillent entre ferme incarnation et présence plus fantomatique. Un spectacle important, à (re)découvrir absolument.
|






 Your new post is loading...
Your new post is loading...