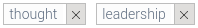Your new post is loading...
 Your new post is loading...
Comment utiliser au mieux la Revue de presse Théâtre
Quelques astuces pour tirer profit de tous les services de la Revue de presse théâtre Les publications les plus récentes se trouvent sur la première page, mais en pages suivantes vous retrouverez d’autres posts qui correspondent aussi à l’actualité artistique ou à vos centres d’intérêt. (Navigation vers les pages suivantes au bas de la page) Les auteurs des articles et les publications avec la date de parution sont systématiquement indiqués. Les articles sont le plus souvent repris intégralement. Chaque « post » est un lien vers le site d’où il est extrait. D’où la possibilité de cliquer sur le titre ou la photo pour lire l’article entier dans son site d’origine . Vous retrouverez la présentation originale de l'article : les titres, les photographies et les vidéos voulues par le site du journal ou l’auteur du blog d’où l’article est cité. Pour suivre régulièrement l’activité de la Revue de presse : vous pouvez vous abonner (bouton bleu turquoise INSCRIPTION GRATUITE ) et, en inscrivant votre adresse e-mail ou votre profil Facebook, recevoir des nouvelles par mail des publications les plus récentes de la Revue de presse Vous pouvez aussi, si vous êtes inscrits sur Facebook, aller sur la page de la revue de presse théâtre à cette adresse : https://www.facebook.com/revuedepressetheatre et vous abonner à cette page pour être tenu à jour des nouvelles publications. sur X (anciennement Twitter), il y a un compte "Revue de presse théâtre" qui propose un lien avec tous ces posts, plus d'autres articles, brèves et nouvelles glanés sur ce réseau social : @PresseTheatre https://twitter.com/PresseTheatre Vous pouvez faire une recherche par mot sur 12 ans de publications de presse et de blogs théâtre, soit en utilisant la liste affichée ci-dessus des mots-clés les plus récurrents , soit en cliquant sur le signe en forme d’étiquette à droite de la barre d’outils - qui est le moteur de recherche de ce blog ("Search in topic") . Cliquer sur le dessin de l'étiquette et ensuite taper un mot lié à votre recherche. Exemples : « intermittents » (plus d’une centaine d’articles de presse comportant ce mot) « Olivier Py» ( plus de cinquante articles ), Jean-Pierre Thibaudat (plus de cent articles), Comédie-Française (plus de cent articles), Nicolas Bouchaud (plus de cinquante articles), etc. Nous ne lisons pas les "Suggestions" (qui sont le plus souvent jusqu'à présent des invitations, des communiqués de presse ou des blogs auto-promotionnels), donc inutile d'en envoyer, merci ! Bonne navigation sur la Revue de presse théâtre ! Au fait, et ce tableau en trompe-l'oeil qui illustre le blog ? Il s'intitule Escapando de la critica, il date de 1874 et c'est l'oeuvre du peintre catalan Pere Borrel del Caso
Par Gilles Rof (Marseille, correspondant du Monde), publié le 30 avril 2024
Habitantes et artistes s’installent dans des bars du quartier populaire de la Belle-de-Mai, créant des moments de mixité dans ces lieux fréquentés exclusivement par des hommes.
Lire l'article sur le site du "Monde" :
https://www.lemonde.fr/culture/article/2024/04/30/a-marseille-le-festival-les-plus-belles-de-mai-impose-les-femmes-dans-l-espace-public_6230827_3246.html
Elles sont huit, alignées épaule contre épaule, têtes hautes et regards fiers. Les femmes du collectif Mira, toutes habitantes du quartier de la Belle-de-Mai dans le 3e arrondissement de Marseille, scandent, à tour de rôle, « Je suis F », un texte écrit par l’une d’elles. En quelques minutes à peine, ces femmes de tous âges et de toutes origines se passent le micro pour se décharger des mêmes mots, qu’elles lisent sur leur smartphone. En français, en arabe, en kabyle, en russe, en allemand, en espagnol, la litanie se répète. Oscillant entre l’urgence de dire et l’euphorie joyeuse d’avoir le courage de le faire, là sur une place publique. « Je suis Fidélité, je suis Fertilité, je suis Fragilité, je suis Force, je suis Futur (…). Je suis Femme. » Depuis trois semaines, ce rituel puissant secoue chaque samedi, en début de soirée, les habitudes de la Belle-de-Mai, un quartier populaire et cosmopolite situé en bordure du centre-ville, l’un des plus pauvres de Marseille. Un court moment d’expression en forme de coup de poing, qui dit tout de l’intention politique de la première édition du festival Les Plus Belles de Mai. « Contribuer à redonner aux femmes leur place dans un espace public trusté par les hommes et où elles ne se sentent pas légitimes », résume Christine Bouvier, directrice artistique de l’association RedPlexus, spécialisée dans les performances urbaines, et programmatrice de l’événement. Volontairement nomade, le festival s’installe tous les week-ends, du 13 avril au 4 mai, sur la terrasse d’un bar différent, à cheval sur la voie. Quatre étapes où se mêlent propositions gratuites de danse, concerts, projections, expositions mais aussi apéros et repas conviviaux… Et, en fil rouge, cette performance amateur des femmes du collectif Mira. « Etre acceptées ici, sans être jugées » Ce samedi 27 avril, où la tempête souffle, la scène est installée en plein cœur du quartier, place Caffo. Après le bar Marius et le restaurant cap-verdien Les Délices de Praia, c’est le Café du Théâtre, tenu depuis treize ans par Ghalia Ferrat, tonique quinquagénaire d’origine kabyle, qui accueille artistes et spectateurs. « On s’est aperçu que si leur clientèle était presque exclusivement masculine, certains bars étaient tenus par des femmes. On a décidé de les solliciter pour le festival », s’étonne Christine Bouvier. Au fond de la salle, un groupe d’hommes, attablé devant un stock de bières plongées dans des glaçons, observe silencieusement cette invasion de leur territoire. D’autres habitués, tout sourire, abordent les femmes du collectif pour les remercier de leur présence. « Vous ne savez pas le changement que c’est d’être acceptées ici, sans être jugées », exulte, quelques minutes après sa performance dans une moulante robe noire, Dalida Zouachi, 50 ans, dont la moitié passée à la Belle-de-Mai, une des locomotives du collectif Mira. « En faisant cela, on donne le courage à d’autres femmes qui hésitent encore à se montrer », assure son amie Zelikha Eldjou, autrice de Je suis F. « Sans caricaturer ce quartier, on sait qu’ici, culturellement, c’est mal vu pour les femmes d’entrer dans un bar, ne serait-ce que pour boire un café. Le bar, c’est l’alcool, le lieu où les hommes boivent. En proposant de le faire de manière festive et collective, cela devient plus facile », analyse Emilia Sinsoilliez. Première adjointe de la mairie du 2e secteur chargée des solidarités et de la démocratie permanente, membre du Parti pirate, cette enseignante de 46 ans est à l’origine des Plus Belles de Mai. Elle travaille et habite dans le quartier, et en connaît parfaitement les problématiques – précarité, violence, surreprésentation des mères seules, poids du religieux – mais aussi les atouts. Nombreux acteurs et lieux culturels La Belle-de-Mai fourmille d’associations d’habitants dynamiques et concentre de nombreux acteurs et lieux culturels, attirés là par les friches industrielles et les bas loyers. Des énergies qu’elle a su fédérer. « Il fallait absolument que les femmes du quartier soient présentes. Avec elles, cela devient très intergénérationnel, intercommunautaire : les grands-mères sont là, les enfants aussi… », explique l’élue. En distribuant des tracts devant les écoles, des sacs promotionnels pendant l’événement, en offrant du sirop aux mamans et à leurs progénitures et en s’appuyant sur les collectifs féminins comme Mira, le festival, doté d’un budget de 23 000 euros de subventions municipales, s’est rendu plus attractif. Une volonté d’accessibilité qui n’a pas poussé à édulcorer la proposition artistique, axée sur la notion d’être une femme dans l’espace public. « Ce n’est pas parce que c’est la Belle-de-Mai que je vais mettre un filtre », assume Christine Bouvier. Samedi 27 avril, sa programmation proposait ainsi la performance dansée Natura morta, où deux femmes en minijupe et bustier rembourré gobent des bananes à pleine bouche ou écrasent des tomates avec leurs fesses avant de se retourner contre l’homme qui les exploite. Une proposition choc pour une partie de l’assistance. « Mais il flotte autour du festival un contexte de bienveillance », assure la danseuse Barbara Sarreau. La semaine précédente, la chorégraphe s’est frottée au défi de se produire en pleine rue. « Ici, on n’est pas dans la langue de bois d’un discours artistique. On se jette au cœur des choses », constate-t-elle. Festival Les Plus Belles de Mai, à Marseille. Prochaine date : samedi 4 mai. Gilles Rof (Marseille, correspondant du Monde)
Sur la page de l'émission d'Arnaud Laporte, Affaires culturelles, sur France Culture, le 29 avril 2024 Alors que Jean Bellorini lui a commandé une variation sur le thème d’Orphée, qui se joue en ce moment aux Bouffes du Nord sous le titre “Le Jeu des Ombres”, l’auteur, peintre et metteur en scène Valère Novarina vient nous parler des sources de son imaginaire. Ecoute en ligne ou podcast de l'entretien (58 mn) On peut le dire dramaturge, essayiste, metteur en scène et peintre, lui se dit “écrivain”. C’est en effet pour écrire, en écrivant, et parce qu’il écrit que Valère Novarina se déploie par ailleurs. Il met en scène parce que le texte demande la parole – dans son langage, le Verbe demande la Chair – il théorise pour comprendre et peint pour donner une silhouette aux personnages de sa pensée. Depuis sa première pièce, L'Atelier volant, écrite en 1971 et mise en scène en 1974 par Jean-Pierre Sarrazac, Valère Novarina poursuit sans relâche et avec une certaine prolificité son travail autour du langage. Ses pièces, aux allures de parades tragiques et bouffonnes, voient souvent se succéder des milliers de personnages, venus porter sur scène une phrase, sitôt parus, sitôt évanouis. L’auteur du Drame de la vie (POL,1984), du Discours aux animaux (1987), de La Chair de l’homme (1995), se fait progressivement une place au sein du panthéon du théâtre contemporain, jusqu’à obtenir deux consécrations séculaires : son entrée au répertoire de la Comédie Française en 2006, avec L’Espace Furieux et l’ouverture du Festival d’Avignon en 2007, avec L’Acte Inconnu. Alors que Jean Bellorini lui a commandé une variation sur le thème d’Orphée, qui se joue en ce moment aux Bouffes du Nord sous le titre “Le Jeu des Ombres”, l’auteur, peintre et metteur en scène Valère Novarina vient nous parler de la fabrique de son art. L'écriture comme une honte Valère Novarina passe son enfance et son adolescence à Thonon-les-Bains, ville du Chablais savoyard. À huit ou neuf ans, il entre en pension à Morzine, chez Madame Marullaz. C’est là qu’il a commencé à écrire, d’abord des poèmes et des théories scientifiques, qu’il cachait sous des pierres. "L'écriture était une honte. C'était quelque chose que personne ne devait savoir, c'était entre la langue française et moi que ça se passait. À tel point qu'à Thonon, j'avais un petit carnet vert avec des tas de réfutations, à ma façon, des pensées de Pascal, des déclarations. Et mes camarades avaient repéré ce carnet. Un jour, il y a eu une course folle pour me piquer le carnet. J'ai couru comme une antilope tellement il fallait fuir. C'était très violent. La première personne à qui j'ai donné quelque chose à lire, c'était mon professeur Bernard Dort. Je me souviens, je suis allé dans son appartement lui donner le livre, j'étais complètement hébété. Je lui ai dis : « Je suis content que ce soit fini, je suis content que ce soit terminé. » Le rapport était très charnel, très violent et exagéré." Les Nuits de France Culture 2h 30 L'appel de la parole Pour Valère Novarina, le verbe agit, le langage est un événement de la nature. Lecteur des Écritures, le prologue de l’évangile selon Saint Jean, « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu » et les travaux de Saint Augustin d’Hippone, résonnent avec la conception du langage de l'écrivain. "Ce qui est curieux, c'est que les protestants traduisent « au commencement était la parole », les catholiques « au commencement était le verbe », et Hegel « au commencement était la raison ». C'est extraordinaire tout ce qui se joue autour de l'appel, autour de la création par la parole, l'appel de la parole. L'idée que la parole appelle. Elle ne désigne pas, elle ne tue pas, elle n'encercle pas, mais que les choses sont appelées. [...] Et puis, l'idée que la pensée achève le travail de la respiration. Entrer dans le corps, le passage par la mort qu'il y a dans la respiration puisqu'on s'étouffe un instant avant de reprendre, c'est l'idée que la pensée est un événement physique, matériel." Marcher sur une arête Depuis 1971 et sa première pièce, L'Atelier volant, Valère Novarina écrit pour le théâtre, parfois il met en scène ses créations, ou autrement les confie à des metteurs en scène. Cette fois-ci, le processus de création a été différent puisque c'est le metteur en scène Jean Bellorini qui lui a commandé une réécriture du mythe d'Orphée, une pièce nommée Le Jeu des Ombres (POL, 2020). Valère Novarina défend sa vision du métier de comédien : "Je souligne beaucoup que les acteurs doivent reprendre les textes dix ans, quinze ans après, comme les violoncellistes, les pianistes, qui n'iront jamais assez vers la partition primitive. Tout est là. Il faut y revenir tout le temps. Et puis, peu à peu, les langues s'accordent. C'est ce qui se passe dans le spectacle magnifique de Bellorini. Les acteurs se rejoignent. J'ai aussi la sensation que pour un acteur, le travail, c'est comme marcher sur une arête où il ne faut tomber ni à gauche ni à droite. C'est très délicat et que ça tient à des riens. L'émotion tient à des riens du tout." Fictions / Théâtre et Cie Le langage et l'espace Au théâtre, contrairement à la littérature, il faut pour Valère Novarina parvenir à faire coexister deux fondamentaux : le langage et l'espace. Il est donc nécessaire de pouvoir en tant que spectateur situer la trajectoire des voix des comédiens depuis un endroit de la scène à un autre, ce qui est rendu difficile par l'utilisation de micros. "Il faut vraiment le langage et l'espace, les deux protagonistes. S'il n'y a plus d'espace, parce qu'il y a des micros, c'est fini. Je trouve que la beauté, c'est le son non-amplifié, sinon ça tue quelque chose. C'est pour ça que les sermons avec des micros sont bien moins bons qu'il y a 40 ans. C'est un autre rapport à la construction des choses dans l'espace. Une conversation, un échange, c'est une sculpture entre nous. Je ne parle pas de mes idées, je vous les vends, il n'y a rien de frontal. On anime un corps mystérieux, un corps de langage entre nous qui est créé par le fait qu'on s'est adressé la parole." En savoir plus sur les actualités de l'invité : - Le Jeu des Ombres, de Valère Novarina, mis en scène par Jean Bellorini joue du 25 avril au 5 mai au Théâtre des Bouffes du Nord. Avec les comédiens et comédiennes François Deblock, Mathieu Delmonté, Karyll Elgrichi, Anke Engelsmann, Aliénor Feix, Jacques Hadjaje, Clara Mayer, Laurence Mayor, Liza Alegria Ndikita, Marc Plas et Ulrich Verdoni, et les musiciens Anthony Caillet, Guilhem Fabre, Barbara Le Liepvre et Benoit Prisset.
Présentation de la pièce : Jean Bellorini confie à Valère Novarina la réécriture du mythe d’Orphée. Dans un monde en cendres, une communauté d’âmes en peine cherche à réanimer le langage et à réenchanter l’espace… À la consumation du langage, répond l’éclat du verbe qui s’allume. À la descente progressive aux enfers, répond la joie d’être au monde.
En écho lointain au mythe d’Orphée, Le Jeu des Ombres est une plongée joyeuse dans une langue exubérante, en dialogue avec les grands thèmes musicaux de L’Orfeo de Claudio Monteverdi.
A venir : - Une invitation à la maison française de New-York le jeudi 2 mai, rencontre publique organisée par Laure Adler et une discussion avec les étudiants de la New-York University le vendredi 3 mai.
- Une intervention à la Halle saint Pierre à Paris le samedi 18 mai 2024 dans le cadre du séminaire mensuel Art et Thérapie, sous la direction de Jean-Pierre Klein, directeur de l’INECAT et de François Dingremont, Docteur en esthétique et anthropologie de l’art.
- Le Discours aux animaux sera repris par André Marcon à Libourne le 22 juin 2024 dans le festival Littérature et Jardin puis à Banon le 20 juillet dans le festival Beckett.
- Les personnages de la pensée sera repris en 2026.
De Valère Novarina : Le Discours aux animaux, dit par André Marcon, enregistré en 1987 : écoute en ligne (1h12) Le Discours aux animaux - monologue écrit plus de dix ans après celui d'Adramélech - a été créé au Théâtre des Bouffes du Nord le 19 septembre 1986 par André Marcon. Une partie seulement du livre éponyme est jouée et sera publié plus tard indépendamment sous le titre L'Animal du temps , aux éditions P.O.L (en 1993). A la suite de la création, André Marcon a été enregistré deux fois, d'une traite, dans une cave de Saint Emilion, au milieu des fûts. C'est une de ces deux prises, faite hors studio et dans un lieu naturel, qui sera diffusée sur France culture en 1989.
Par Julia Wahl dans cult.news - 28 avril 2024 C’est un texte complexe que ce Poings, de Pauline Peyrade, où la typographie défie toute analyse univoque et, partant, toute facilité scénique. Pourtant, Céleste Germe et le collectif Das Plateau ont relevé le défi haut la main en présentant une proposition intelligente et sensible, qui fait vibrer sur le plateau du Monfort toute la violence du texte. VIOL/ENCES Cela commence sous les spotligts et les rumeurs d’une rave party, où MOI, la récitante, est venue s’amuser. Elle est happée par la danse et les chorégraphies de ses voisin.es. Un homme, toutefois, s’approche d’un peu près. De vraiment très près. De beaucoup trop près. « Crie, repousse-le », lui susurre une voix à laquelle elle n’arrive pas à obéir. C’est cette voix, TOI, qui, désormais, nous accompagnera. L’instance narrative est ainsi dédoublée en deux voix qui signifient la diffraction des victimes de viol et de violences conjugales. L’une nous raconte ce qu’elle vit à la première personne, une autre, plus lointaine, aux deuxième et troisième personnes : c’est toujours la même femme et, pourtant elle voit tout de loin, séparée par une vitre épaisse de son enveloppe corporelle. MOI/TOI Cette dissociation est rendue sur scène par un ingénieux dispositif, fait de miroirs et de projections, qui dédouble la comédienne en autant d’images. Des images, seulement, car MOI nous paraît lointaine, évanescente, comme si elle quittait son corps. Le jeu sur la profondeur du plateau participe de cet éloignement : une grande part de la pièce est jouée en fond de scène, séparée du public par une distance qui semble infranchissable. Si MOI quitte à un ou deux moments cette diffraction vaporeuse, c’est pour nous raconter longuement, face public, au proscenium cette fois, l’acmé des violences conjugales qu’elle vit ensuite. La voir de si près, dans toute sa dimension charnelle, crée un tel contraste avec les images qui précèdent que le nouveau viol – puisque c’est de cela qu’il s’agit – n’en résonne que plus fortement. CORPS/VOIX La langue de Pauline Peyrade est une langue rugueuse, qui accorde une large part aux litanies comme autant d’expressions du retour lancinant du trauma. Elle mêle la précision des notations concrètes aux évocations plus métaphoriques des troubles liés au traumatisme et à l’emprise – mais sont-ce seulement des métaphores ? La mise en scène de Céleste Germe est parfaitement servie par la prestation de Maëlys Ricordeau, qui prête à MOI et à TOI un corps et une voix qui oscillent entre ferme incarnation et présence plus fantomatique. Un spectacle important, à (re)découvrir absolument.
Par Jean-Pierre Thibaudat dans son blog - 24 avril 2024 C’était en 2010 le premier spectacle de Nicolas Bouchaud, seul en scène. Une merveille. « La loi du marcheur » revient, quatorze ans après, à la demande générale du public. Après ceux de Daney, d’autres textes devaient suivre signés John Berger, Thomas Bernhard, Paul Celan. Toujours avec Eric Didry et Véronique Timsit. On ne change pas une équipe qui gagne. Reprise de l’article écrit alors.
Que voit-on dans le spectacle La Loi du marcheur ? Un homme qui parle. Un acteur qui met son corps au service de cette parole. L’homme, c’est Serge Daney à travers les entretiens -sorte de biographie errante et réflexive- qu’il enregistra, face à Régis Debray, quelques mois avant de mourir du sida en 1992. L’acteur, c’est Nicolas Bouchaud, que l’on a souvent vu ces dernières années dans les spectacles mis en scène par son pote Jean-François Sivadier. L’acteur, seul en scène, a travaillé sous l’œil complice du metteur en scène Eric Didry et de Véronique Timsit. Il ne s’agissait pas pour eux de donner à entendre un résumé de l’œuvre critique de Serge Daney aux Cahiers du cinéma puis à Libération, et enfin à la revue Trafic (fondée sous son impulsion). Ni de faire un florilège de ses textes. Ni encore de raconter sa vie, même si Daney parle de son enfance où tout se noua les soirs où sa mère, délaissant la vaisselle, entraînait son fils unique dans un cinéma du XIe arrondissement de Paris. Non le pari, magnifiquement tenu, c’est de donner à voir et entendre une pensée en acte, prenant littéralement parole, dans le mouvement de son émergence, avec ses hésitations, ses redites, ses phrases laissées en l’air, ses égarements, ses percées soudaines, ses trouvailles , ses formules ramassées en un beau paradoxe. Une pensée au travail, à travers et à partir des confidences d’un homme qu’il sait qu’il va mourir -bien que cette dimension n’entre pas ouvertement dans le champ de sa parole. Daney ne se laisse pas aller au jeu testamentaire du « film-qui-sera-diffusé-après-ma-mort ». C’est le présent qui l’intéresse, comment le passé fait retour dans le présent. Comment aussi le parcours devient, pour nous, avec le temps, un cheminement historique marqué par l’après-guerre, la guerre -Daney est né en 1944-, un enfance pauvre -mais heureuse- passée dans un monde où la télévision n’existait pas encore. Bouchaud, dans le décalage même de sa voix qui n’imite en rien la voix de Daney -voilée de voyages et de nuits-, de son corps plus tonique et massif que celui de Serge, ancre cette distance. Ce qu’a vécu Daney, ce qu’il a observé, c’est un monde disparu. Ce décalage du comédien de théâtre produit un autre effet réjouissant, celui de mettre au premier plan l’ironie féroce des propos de Daney parlant de Fernandel, de PPDA ou de Guillaume Durand, ou évoquant l’homérique voyage qu’il fit à 20 ans avec un ami, au saint des saints, Hollywood. Daney aimait dire que ce sont les films qui nous regardent. Doublement spectateur donc. Et le théâtre redouble la donne à son tour : le « spectateur-Daney-Bouchaud » s’adresse à nous, spectateurs, et l’acteur Bouchaud fait l’acteur/le pitre. Et partant, met sur la sellette notre regard de spectateur. A dire vrai, ce spectacle me rappelle les séances des ciné-clubs d’autrefois quand, dans un cinéma de banlieue ou de province, un type (jamais une femme) des Cahiers du cinéma ou de Premier Plan -voir de Positif- venait présenter le film de la « soirée art et essai » et en discutait après avec le public. Sauf que là, tout se mélange : le film, le type des Cahiers, le « spectateur-débatteur » ne font qu’un. Bouchaud, avec force, joue tous les rôles. Y compris celui du « spectateur-Bouchaud », car il y a fort à penser qu’il partage pour l’essentiel la pensée et le mode de pensée de Serge Daney. « La Loi du marcheur » , spectacle créé au Théâtre du Rond-point dans le cadre du festival d’automne en 2010 revient comme un inoubliable refrain à la MC93 du 24 au 28 avril puis au Théâtre de la Bastille du 3 au 29 mai. Jean-Pierre Thibaudat
Tribune publiée par Libération - 27 avril 2024 Par Un collectif des professionnel-les du secteur culturel et artistique La saison 2024/2025 de l’institution perpétue l’absence des femmes dans les répertoires. Mais la parité peut-elle être laissée au bon vouloir de quelques directeurs décisionnaires ? Près de 260 professionnels du secteur culturel et artistique appellent le gouvernement à sanctionner tout manquement à l’objectif d’égalité. En mars 2024, l’Opéra national de Paris a rendu publique sa saison 2024/2025. Cette nouvelle saison ne comporte aucune metteuse en scène, aucune compositrice, ni aucune librettiste. A l’affiche de la saison 2024/2025, sur 19 productions d’opéra et 15 ballets incluant créations et reprises : 17 metteurs en scène, 0 metteuse en scène, 17 chefs d’orchestre/4 cheffes d’orchestre, 19 compositeurs/0 compositrice, 26 librettistes hommes/0 librettiste femme, 14 ballets chorégraphiés par des hommes/un seul par une femme. La somme de ces chiffres est sans appel : seules 5 femmes figurent parmi les 98 noms relatifs à ces 34 spectacles. Comme le souligne l’association H/F Ile-de-France, cette décision de l’Opéra de Paris perpétue l’absence des femmes dans les répertoires : elle constitue un obstacle à la pérennisation de leurs œuvres et au développement d’un véritable matrimoine opératique. Un tel geste revêt un sens politique désastreux. Faut-il soupçonner l’Opéra de Paris de ne pas être au fait des questions d’égalité ? Non. Le silence des médias Lors du lancement de la saison 2022/2023, son directeur, Alexander Neef, avait choisi de faire de la présence à l’affiche de metteuses en scène et de cheffes d’orchestre l’un des axes majeurs de sa communication, déclarant notamment à l’Agence France-Presse : «C’est un enjeu essentiel pour l’Opéra de Paris. […] Il est important de promouvoir et faire rayonner les talents, dont les femmes. Leur regard, leur exigence nous promettent des spectacles exceptionnels.» Deux ans plus tard, que s’est-il passé ? Où sont ces «talents», ces «regards», cette «exigence» ? En tant qu’institution publique, l’Opéra national de Paris bénéficie de l’une des plus importantes subventions du secteur culturel. Au sortir du confinement, il a reçu du ministère de la Culture une aide exceptionnelle de 81 millions d’euros qui représentait à elle seule 40 % de l’enveloppe dévolue à l’ensemble du spectacle subventionné. Il doit s’acquitter en retour d’une mission d’intérêt général en présentant une programmation représentative de la société dans sa diversité. Dans le même temps, l’Opéra de Lyon – pour ne citer que lui – présentait une saison paritaire : comment expliquer que l’Opéra de Paris fasse moins d’efforts en comparaison d’autres théâtres bien moins dotés ? Cet effacement des femmes est rendu plus violent encore par le silence des médias : lors de la publication de cette nouvelle saison de l’Opéra de Paris, la majeure partie de la presse généraliste et spécialisée a repris le communiqué de l’institution pour vanter sa progression financière mais aucun – à l’exception de Sceneweb et de BFM TV – n’a relevé l’effacement des femmes dans la programmation. Un tel silence laisse l’institution écrire l’histoire à son avantage sans lui porter la moindre contradiction. Une telle volte-face est un cas d’école Le mouvement #MeToo – sous l’impulsion de témoignages comme celui de Judith Godrèche – est entré dans une nouvelle séquence qui met à jour des formes de domination autrefois étouffées. Il est éloquent que l’exclusion des femmes d’une programmation ne soit pas perçue comme un autre type de violence. Le milieu culturel a entrepris un long travail de fond sur ces questions, mais ce travail ne peut qu’être mis en échec s’il se heurte à des directions qui continuent d’effacer les créatrices. Au-delà du cas particulier de l’Opéra de Paris, qu’une institution soit capable d’une telle volte-face – promouvoir puis effacer les créatrices à deux ans d’écart – est un cas d’école qui tend à prouver qu’en matière de parité, l’autorégulation ne fonctionne pas. La parité est trop importante pour être laissée à la bonne volonté ou au bon vouloir de quelques directeurs décisionnaires. L’égalité est un projet de société, non une variable d’ajustement dans la communication d’une institution. S’il s’agit de la grande cause du quinquennat, comme l’a affirmé à plusieurs reprises le président de la République, elle ne peut reposer sur des vœux pieux. Comme le rappelait Reine Prat, haute fonctionnaire et autrice de deux rapports ministériels sur l’égalité femmes/hommes dans la culture, elle doit impliquer des obligations d’objectifs, de moyens et de résultats, mais aussi en faire l’inspection, la vérification, et – le cas échéant – d’appliquer des sanctions. Cette cause nécessite, de la part de la puissance publique, une véritable volonté politique et du courage pour la mettre en œuvre. C’est à cette volonté et à ce courage que nous en appelons aujourd’hui. Signataires : 258 professionnel·les et associations du secteur culturel et artistique parmi lesquel·les notamment : Pauline Bureau autrice, metteuse en scène, Clément Cogitore artiste, metteur en scène, Bintou Dembélé chorégraphe, Claire Dupont directrice du Théâtre de la Bastille, Aurore Evain autrice et metteuse en scène, Tatiana Julien chorégraphe, Marc Lainé directeur de la Comédie de Valence, centre dramatique national Drôme-Ardèche, Aliette de Laleu journaliste, autrice, Maud Le Pladec directrice du Centre chorégraphique national d’Orléans, Katie Mitchell metteuse en scène, Isabelle Moindrot professeure à l’Université Paris-8, membre de l’Institut universitaire de France, Lucile Peytavin historienne, essayiste, experte en égalité F/H, Reine Prat autrice de deux rapports ministériels pour l’égalité dans les arts du spectacle et de l’ouvrage Exploser le plafond, Hyacinthe Ravet professeure de sociomusicologie, Sorbonne Université, Vanasay Khamphommala dramaturge, autrice, performeuse, Mouvement HF… et l’Association des centres dramatiques nationaux, l’Association des centres chorégraphiques nationaux, l’Association des scènes nationales, l’association Futurs composés. L’intégralité des signataires est ici.
Par Marie-Aude Roux dans Le Monde - Publié le 29 avril 2024 Dans l’adaptation française de la pièce de Carlo Goldoni mise en scène par Laurent Pelly, Natalie Dessay vogue sur l’émotion. Lire l'article sur le site du "Monde" :
https://www.lemonde.fr/culture/article/2024/04/29/avec-l-impresario-de-smyrne-trois-cantatrices-rivales-revent-de-turquie_6230534_3246.html
Un plateau blanc tel un pont de navire incliné, un immense cadre doré de guingois ; au fond, l’envers blafard d’une peinture de scène arrimée telle une voile : l’Athénée-Théâtre Louis-Jouvet, à Paris, a pris des allures maritimes pour L’Impresario de Smyrne (1759), de Carlo Goldoni, traduit et adapté en français par Agathe Mélinand et mis en scène par Laurent Pelly. Port de tête et port de voix, voire porte-voix, c’est l’apanage nécessaire aux trois cantatrices rivales : Madame Tognina, une Vénitienne entre deux eaux, Lucrezia, la jeune et rouée Florentine, et l’accorte Annina, une Bolognaise qui n’en fait qu’à sa sauce. Toutes trois rêvent de s’embarquer pour la capitale turque, où un riche marchand, pour complaire à ses amis, a décidé de produire une nouveauté : l’opéra. Qui sera la prima donna ? La question est cruciale, dont dépend le statut, qui décide du salaire. Expédition en terre lyrique Laurent Pelly a gardé de la commedia dell’arte, dont Carlo Goldoni (1707-1793) fut l’« inventeur », les visages poudrés de blanc. Mais ce sont des personnages en habits noirs de cour du XVIIIe siècle que le metteur en scène marionnettiste manipule, à l’instar d’un théâtre d’ombres. Sous les traits de la caricature, des cœurs battent, et l’âpre combat des ego n’est autre que celui d’une survie paniquée. Les dames sont la proie des hommes, aussi vains et fats que ridiculement séducteurs. Du comte Lasca aux allures de Casanova, agent improvisé bien décidé à mettre la plus jolie dans son lit, au Turc Ali, costume et panama blancs, amateur de cigares et de femmes un rien brutal. Autour d’eux, le cauteleux librettiste Maccario, le fringant Pasqualino, ténor et amant universel, et, surtout, l’arrogant castrat Carluccio (Thomas Condemine), dont les glapissements et gambades semblent mimer une sorte de danse baroque à la mode hip-hop. Rejeté par le Turc, peu friand de cette exception culturelle italienne, celui-ci brocardera le « pays inconnu où il n’y a que turbans et moustaches » qui ne voient en lui qu’un eunuque gardien de sérail. Semi-dissimulé à jardin, un trio issu de l’Ensemble Masques – le violoniste Ugo Gianotti, la violoncelliste Mélisande Corriveau, emmenés par le claveciniste Olivier Fortin – dialogue avec une bande-son remplie d’eau de mer, de mouettes et d’abois. Dans la voilure de cette expédition en terre lyrique, les musiques de Galuppi, de Westhoff, de Vivaldi, de Corelli, de Durante, plus ou moins sensuelles, entraînantes ou mélancoliques. Tous les comédiens sans exception sont formidables (Jeanne Piponnier, Antoine Minne, Cyril Collet). Mais le public attend que ceux qui chantent donnent corps à l’opéra. Pour le ton bouffe, la piquante Julie Mossay campera avec humour la très sûre d’elle Serpina de La Servante maîtresse, de Pergolèse (Stizzoso, mio stizzoso), Damien Bigourdan poussant non sans quelque rudesse l’ardente romance amoureuse tirée de Pâris et Hélène, de Gluck (O del mio dolce ardore). Mais le moment suspendu appartient à la Tognina, alias Natalie Dessay, désormais comédienne accomplie, ressuscitant, avec le poignant Sposa son disprezzata de Bajazet, de Vivaldi, l’immense cantatrice qu’elle fut. Joie du souffle tenu, de l’arrondi des ornements, de l’élégance d’une ligne voguant sur l’émotion. Bien sûr, personne n’embarquera pour Smyrne. Le Turc s’évanouira comme il est apparu, laissant aux artistes une bourse en dédommagement, et au public ce « burlesque hommage » à un « bûcher des vanités transcendé par la musique », imaginé par Laurent Pelly et Agathe Mélinand. A quai jusqu’au 5 mai, à Paris, L’Impresario de Smyrne poursuivra sa route à Caen. Marie-Aude Roux / LE MONDE L’Impresario de Smyrne, de Carlo Goldoni, mise en scène de Laurent Pelly. Avec Natalie Dessay, Julie Mossay, Jeanne Piponnier, Eddy Letexier, Thomas Condemine, Damien Bigourdan, Antoine Minne, Cyril Collet. Ensemble Masques, Olivier Fortin (clavecin). Athénée-Théâtre Louis-Jouvet, Paris 9e. Jusqu’au 5 mai. Athenee-theatre.com Reprise au Théâtre de Caen, du 22 au 24 mai. Theatre-caen.fr Légende photo : « L’Impresario de Smyrne », mis en scène par Laurent Pelly. DOMINIQUE BREDA
Par Joëlle Gayot dans Le Monde - 26 avril 2024 Les deux établissements doivent reporter des spectacles, voire fermer, pour faire face aux amputations.
Lire l'article sur le site du "Monde" https://www.lemonde.fr/culture/article/2024/04/26/baisses-brutales-des-subventions-departementales-pour-le-theatre-de-la-cite-a-toulouse-et-la-maison-des-arts-de-creteil_6230137_3246.html
Grande ou petite, nationale ou régionale, pas une institution culturelle n’est à l’abri des baisses de subventions. Après les établissements nationaux parisiens, soumis, début avril, aux amputations imposées par les ministères de la culture et des finances, c’est au tour de scènes territoriales labellisées d’encaisser une diminution imprévue de leurs subsides, décidée cette fois par les collectivités locales. Le centre dramatique national de Toulouse et la scène nationale de Créteil viennent d’apprendre le désengagement financier de leurs départements respectifs. L’avenir dira s’ils ne sont que les premiers d’une longue liste. En Haute-Garonne, le Théâtre de la Cité, codirigé par le metteur Galin Stoev – dont Rachida Dati vient de renouveler le contrat jusqu’en 2027 – va devoir faire avec 190 000 euros de moins. Une décision actée le 19 avril par le conseil départemental, qui diminue, sans concertation préalable, sa subvention de 80 %. Et semble même remettre en question son accompagnement à partir de 2025. Une perspective qui, si elle devenait effective, impliquerait une perte cumulée de 1 million d’euros d’ici à la fin du mandat de Galin Stoev. Interloqué par l’« absence de dialogue » et placé devant « le fait accompli », le directeur dit s’être heurté à un « discours purement comptable ». Sonné par la « brutalité » du procédé, qui augure, selon lui, une « nouvelle page dans les rapports entre l’institution et sa tutelle », Galin Stoev n’abandonnera pas le bateau, même si l’idée l’a traversé : « Nous allons absorber cette nouvelle contrainte économique. Mais jusqu’à quand devrons-nous rester les bons élèves à qui on demande de trouver des solutions, quels que soient les cas de figure ? » Limiter les dégâts Le Théâtre de la Cité est soutenu par les financements croisés de l’Etat (2,4 millions d’euros), de la métropole (2 millions), de la région Occitanie (377 000 euros) et du département (240 000 euros avant la coupe). Tout retrait d’un partenaire est un coup de canif porté à un équilibre fragilisé par un contexte économique tendu. Les répercussions peuvent se révéler désastreuses. « On nous a dit qu’il n’y aurait aucune clause de revoyure, et pas de compensation par les autres tutelles », explique le codirecteur Stéphane Gil. Ce dernier cherche à limiter les dégâts, pour protéger une saison 2024-2025 dont il s’apprêtait à communiquer au public le contenu finalisé : « Nous tentons de décaler des spectacles plutôt que de les annuler, puisque nous sommes, en tant que centre dramatique national, coproducteurs de la majorité des compagnies présentes dans nos murs. Nous allons puiser dans les réserves du théâtre et augmenter symboliquement les tarifs de la billetterie. Nous ne voulons pas toucher à l’emploi permanent. En revanche, celui des intermittents sera affecté : moins de projets, cela veut dire moins d’heures pour les ouvreurs ou les techniciens. » Ces solutions improvisées dans l’urgence permettront au Théâtre de la Cité de faire bonne figure à la rentrée 2024. Mais pour combien de temps ? « Ce qui m’inquiète, ajoute Galin Stoev, c’est l’effet boule de neige que peut susciter sur les autres tutelles le retrait du département. » De son côté, José Montalvo, directeur de la Maison des arts de Créteil, a pris de plein fouet la perte sèche de 150 000 euros infligée par le conseil départemental du Val-de-Marne. « Je l’ai appris le 2 avril, alors que nous venions de boucler la programmation 2024-2025. Il a fallu tout chambouler. C’est un manque total de professionnalisme », déplore-t-il. Subventionnée par l’Etat (1,893 million d’euros), par Grand Paris Sud-Est Avenir (1,125 million d’euros) et par le département (883 000 euros jusqu’en 2023), la scène nationale n’ouvrira ses portes, à la rentrée prochaine, qu’au mois de novembre. « L’amputation a des effets concrets : elle veut dire que le théâtre ferme pendant un mois et demi. » La méthode, radicale, a le mérite de rendre visibles les conséquences de la coupe. José Montalvo s’est résolu à annuler une dizaine de spectacles, parmi lesquels ceux de Jean Bellorini ou d’Olivier Martin-Salvan et Pierre Guillois. « On aurait pu nous prévenir avant. Ce mépris des créateurs et des techniciens n’est pas normal. Je suis bouleversé de ne pouvoir tenir les promesses que j’ai faites aux artistes. » Dans un communiqué distribué au public de Créteil, le directeur dénonce la « saignée infligée à [la] maison ». A Toulouse, Galin Stoev alerte sur le « sabotage » de son théâtre. Des mots qui en disent long sur l’état des troupes. Joëlle Gayot / LE MONDE Légende photo : La Maison des arts de Créteil, sur le parvis de l’hotel de ville. JEAN-MICHEL MOGLIA
Douze spectacles à réserver pour mai : « La Réunification des deux Corées », « Lacrima », « la loi du marcheur »…
A Paris et en région, les critiques du « Monde » ont sélectionné les représentations à ne pas manquer. Lire l'article sur le site du "Monde" : https://www.lemonde.fr/culture/article/2024/04/26/douze-spectacles-a-reserver-pour-mai-guerc-ur-lacrima-requiem-s_6229966_3246.html
« La Réunification des deux Corées » : une comédie humaine intemporelle Créée voici dix ans par Joël Pommerat, La Réunification des deux Corées se déployait alors dans un espace bi-frontal où le public habitait deux rives opposées entre lesquelles s’étalait la plaie ouverte de la scène. Pour sa reprise à la Porte Saint-Martin à Paris, le spectacle se métamorphose pour adopter une configuration classique. Elle place, face à face, les comédiens et le public. Cette mue ne devrait rien enlever à la puissance d’une représentation qui parle de l’amour au travers d’une galerie de situations filant de l’ombre à la lumière. Les acteurs rejouent des séquences de vie prélevées dans un quotidien partagé. S’aimer, se marier, construire son couple ou sa famille, divorcer, rompre, se haïr, cette comédie humaine est intemporelle. Amis, amants, parents, enfants : c’est bien nous que nous regardons vivre au théâtre. J. Ga. Théâtre de la Porte Saint-Martin, Paris. Jusqu’au 14 juillet ----------------------------------------------------- « Helsingor, Château d’Hamlet » : immersion shakespearienne Saisissante mise en scène de Léonard Matton. L’artiste propose un spectacle immersif dans les étages du château de Vincennes. Inspirée d’Hamlet de Shakespeare, la représentation Helsingor, Château d’Hamlet resserre la focale autour des grandes figures et de leurs actions phares. Ophélie, Hamlet ou Claudius : le public choisit quel héros il va suivre au cours d’une déambulation qui le mène du lit au trône, en passant par le cimetière où les fossoyeurs extirpent un crâne de la terre. Si les nuances shakespeariennes sont ici sacrifiées, on ne perd rien du tragique de ce drame. De manigances en messes basses, l’acharnement d’Hamlet à venger la mort de son père épouse un tempo haletant. Ce théâtre qui investit les couloirs, les salles et les moindres recoins du château donne au public la sensation étrange mais exaltante d’avoir été un personnage à part entière de l’intrigue. J. Ga. Château de Vincennes. Jusqu’au 25 mai. --------------------------------------------------------- « Lacrima » : un récit cousu main Au Théâtre national de Strasbourg, qu’elle dirige depuis septembre 2023, la metteuse en scène Caroline Guiela Nguyen présente, en avant-première avant le Festival d’Avignon, sa nouvelle création, Lacrima. Un récit choral comme elle les aime, qui prend pour point de départ la commande reçue par une grande maison de couture parisienne. Pour mieux détricoter les fils – humains, économiques, sociaux – qui tissent ces vêtements extraordinaires, de Paris à Mumbai en passant par Alençon, et la vie de ces ouvrières et ouvriers de l’ombre, très éloignés de l’univers du luxe qu’ils contribuent à créer. F. Da. Théâtre national de Strasbourg. Du 14 au 18 mai. ------------------------------ « La Loi du marcheur » : l’amour existentiel du cinéma Créée en 2010 par le comédien Nicolas Bouchaud et son complice Eric Didry, La Loi du marcheur n’a cessé de tourner depuis, et se réinstalle au Théâtre de la Bastille, à Paris, tout le mois de mai. Une chance pour ceux qui n’ont pas encore vu cet excellent spectacle, et pour ceux qui voudraient le revoir. D’un matériau a priori peu théâtral – l’interview, en 1992, par Régis Debray, du grand critique de cinéma Serge Daney –, Nicolas Bouchaud fait un formidable moment de théâtre, vivant et ludique, qui plonge dans ce que l’amour du cinéma peut avoir de plus existentiel, pour examiner ce que « les films font à nos vies », comme le disait Serge Daney. Quant à la réflexion du critique sur les images, sur la différence fondamentale entre télévision et cinéma, non seulement elle n’a pas vieilli, mais elle a encore gagné, à l’heure du Big Brother généralisé, en force percutante. F. Da. Théâtre de la Bastille, Paris. Du 3 au 11 mai et du 14 au 29 mai ---------------------------------- « Illusions perdues » : un désir de conquête féminin Une tribu d’acteurs qui avancent prestement sur le plateau, des comédiens qui changent de rôle à la volée. Six personnages pressés d’aller au bout de leurs rêves sur une scène cernée par quatre gradins de spectateurs. Le théâtre se fait sportif sous la houlette de Pauline Bayle, qui adapte et met en scène Les Illusions Perdues de Balzac. Ce récit écrit au XIXe siècle colle pourtant aux temps contemporains. Il a pour tête de proue Lucien Chardon, jeune poète ambitieux bien résolu à se faire, à Paris, sa place au soleil et qui se fraie un chemin dans le monde blasé des arts, de la culture et de la presse. Son ascension est fulgurante, sa chute tout aussi radicale. C’est une actrice flamboyante (Manon Chircen) qui interprète Lucien. Preuve que le désir de conquête n’est pas l’apanage des hommes. J. Ga. Théâtre public de Montreuil. Du 21 mai au 2 juin
Par Louis Juzot dans le blog Hottello - 23/04/2024 Noir et humide de Jon Fosse, traduction Terje Sinding, éditions de l’Arche, par l’Amin Théâtre, mise en scène Christophe Laluque, lumières, scénographie Mehdi Izza Trafikandars, musique, son Nicolas Guadagno, costumes Lou Bonnaudet, avec Cléa Laize, Chantal Lavallée, Robin Francier. Noir et Humide, soit toutes les caractéristiques d’une cave, lieu secret, difficilement accessible, lieu de l’interdit autant que des peurs et de l’imaginaire enfantin. Jon Fosse a écrit avec minutie comme une chronique documentée, sensation par sensation, minute par minute, le cheminement de Lene, une petite fille de sept ou huit ans pour atteindre ce lieu noir et humide. Comme le dit Christophe Laluque : « Jon Fosse possède un rythme, un style qui va à l’encontre de tout ce que l’on propose aux jeunes en ce moment … » Et le metteur en scène fait marcher Lene avec précaution sur un plateau noir où sont matérialisés au sol les plans d’une maison, quelques chambranles marquant les passages entre les pièces, rappelant à la fois les dessins d’une marelle sur une cour de récréation et les exercices esthétisants autant qu’angoissants du Dogville de Lars von Trier. Le dispositif met d’emblée en jeu la capacité imaginative et raisonnante de l’enfant. Lene est incarnée par Cléa Laize. Elle avance précautionneusement en proférant calmement le texte qui décrit chaque sensation ressentie, chaque stratégie qu’elle échafaude face aux dangers, pour surmonter l’obstacle. Belle incarnation, car Cléa Laize ne singe pas l’enfant, elle intériorise son sérieux et ses questionnements avec retenue et justesse. L’objet qu’elle va voler sur une étagère dans la chambre de son frère n’apparait pas dans ses mains, ni le lit où elle se cache mais le monde physique se réalise par le pouvoir évocateur des mots, comme la moustache noire et humide de l’homme ou de la bête qu’elle croit voir dans le noir. Robin Francier, qui joue Asle, le frère, est silencieux, c’est Lene qui décrit ses déplacements dans la maison, son désarroi quand il s’aperçoit que sa belle lampe torche jaune a disparu, ses pleurs que craint sa soeur par dessus tout. Chantal Lavallée est la mère douce et attentionnée qui rabiboche ses enfants et soutient Lene après l’épreuve. La force du spectacle est de ne pas tomber dans les poncifs enfantins et de donner toute sa puissance à ce rite initiatique de l’enfance pour transgresser l’interdit. L’ambiance flirte avec celle d’un thriller et les enfants présents dans la salle sont subjugués par la parole et la gestuelle de Lene sur ce plateau presque nu. Quelques signes sont signifiants: flocons de neige et porte blanche de la fameuse cave, un piano qui égraine ses notes, des lumières distillées pour faire apparaître les ombres des personnages, le noir pour les jeux avec la torche … Une économie d’effets qui fait écho à la parole de Lene. Une création exigeante, à l’esthétique minimaliste mais très habitée qui rend magistralement le texte de Jon Fosse. Une réussite plébiscitée par une jeune salle très attentive et qui mériterait une large diffusion et sans distinction d’âges ! Louis Juzot Mercredi 24 avril à 15h, samedi 27 avril à 17h, représentations scolaires en journée, jusqu’au 30 avril, au Théâtre Dunois, 7 rue Louise Weiss, 75013 Paris wwwtheatredunois.org Crédit photo : Ernesto Timor
Par Véronique Hotte dans son blog Hottello - 23 avril 2024
Corps premiers, Une histoire du sport, du corps, et de tous ces instants où il tient le premier rôle, de Cédric Orain. Texte (esse que Editions) et mise en scène Cédric Orain, avec Claude Degliame, Aurora Dini circassienne, et Maxime Guyon. Scénographie vidéo Pierre Nouvel, lumière Bertrand Couderc, création son Lucas Lelièvre, Camille Vitté, costumes Karin Serres, regard chorégraphique Bastien Lefèvre, regard dramaturgique Guillaume Clayssen. Le sport moderne n’a pas l’innocence d’un jeu, c’est une activité de professionnels dans des épreuves aux gros enjeux financiers. Or, les éléments de jeu – règles à ne pas transgresser – subsistent. Chronométrage manuel puis électrique, électronique, pour l’évaluation des performances – technique de course, départ dans des starting-blocks, mesure du vent pour établir des records, préparation physique, technique psychologique des athlètes: le sport de haut niveau n’est pas un jeu, plutôt un métier, exigeant, contraignant, et gratifiant dans la victoire ou le record. Le spectacle de Cédric Orain explore l’espace mental d’un corps en mouvement affinant sa technique et ses capacités, soit l’athlète tentant la manière dont le corps pourrait « se dépasser ». Dans la confrontation avec la performance, le corps échappe à son détenteur, et les mouvements naturels de l’activité corporelle – marcher, bondir, courir, sauter -, sont évalués d’après des critères quantitatifs rigides, avec mesure de vitesse pour la course, de hauteur, de longueur pour les sauts. « (…) Style ou pas, ça y est, Emile est une vedette mondiale. Somme toute, il aura suffi de peu: Oslo, Berlin, un cross interallié à Hanovre et les records successifs qu’il aligne dans son pays… Il est devenu ce qu’on appelle un grand champion. Il est inévitable. On n’indique plus sa participation à une épreuve, on indique simplement, bien avant qu’elle ait lieu, qu’il va la remporter… » (Jean Echenoz, Courir, Les Editions de Minuit, 2008). Belle mise en majesté du sport et des possibilités d’un corps inventif, Corps premiers révèle des moments de grâce lumineux. Un sportif est un champion s’il pousse son corps à l’inaccessible ou s’il invente librement : Dick Fosbury, sauteur américain invente en 1968 aux Jeux Olympiques de Mexico un nouveau saut, enroulant son dos juste au-dessus de la barre de saut, d’où le regard médusé des juges inaptes à savoir ce qui est réglementaire ou non : il vient de sauter les 2m24. « Le public en redemande, le stade entier n’a d’yeux que pour lui, et l’arrivée du marathon passe totalement inaperçue, Fosbury vient de marquer l’histoire des jeux, il vient d’inventer un saut qui porte encore aujourd’hui son nom. Le sport oblige à l’invention, il faut inventer pour gagner, créer des coups, concevoir des tactiques », écrit Cédric Orain. De son côté encore, « Emile aura couru trois fois le tour de la Terre. Faire marcher la machine, l’améliorer sans cesse et lui extorquer des résultats, il n’y a que ça qui compte… » (ibid. Courir). Le vélo, sport individuel de course sur route, provoque des événements populaires, le Tour de France.… Laurent Fignon, Bernard Hinault, Jacques Anquetil, Raymond Poulidor sont évoqués. Des interviews composent le spectacle et font le récit de ces aventures, Fosbury, Colette Besson ou Kathrin Switzer – première femme à courir un marathon -, Valery Brumel, athlète soviétique du saut en hauteur qui méprisait Fosbury n’oeuvrant pas, d’après lui, selon les règles de l’art. Quelques images vidéo et photos d’archives en noir et blanc: plaisir et mystère pour le spectateur à voir tant de passion, de frénésie, de foi en l’élan – éclairs d’une vie ardente en éblouissements. Sur scène, trois interprètes à la belle présence, dont la circassienne Aurora Dini – contorsion et cerceau aérien – qui explique son histoire – ses débuts, l’abandon de la compétition, suite à des accidents extérieurs, puis son retour au sport par la voie du cirque: récit sobre et paisiblement vrai. Maxime Guyon lance la danse en se demandant tout haut pourquoi son voisin, lampe frontale sur le front, se lève tous les matins pour aller courir: dans le but de s’entretenir ou de s’accomplir ? L’acteur apporte de la distance et du recul face au sport, silhouette populaire et parler comiques. Personnage intervieweur, sportif créateur ou enfant, comme ses deux partenaires, il se souvient de ses lectures enfantines et du journal sportif où tous les étés, il vivait à l’allure des héros du Tour de France. Il rappelle l’occasion inespérée d’avoir pu voir, à douze ans, avec son père, un match, où contre toute attente, la France perd contre la Bulgarie en 1993 : catastrophe, peine inconsolable. Quant à la majestueuse Claude Degliame, elle raconte de sa voix grave et profonde les pensées, entre autres, de Dick Fosbury qui réfute le titre de champion, honnête avec lui-même, comme avec les autres. Tous s’écoutent, sur le plateau de scène comme sur le sol d’un gymnase – théâtre dans le théâtre – , attentifs à l’instant poétique, à la pensée articulée entre émotion et retour méditatif. Véronique Hotte Du 22 au 26 avril 2024 à 20h30, sauf le samedi à 18h, jeudi à 14h30 et à 20h30 à L’Echangeur à Bagnolet,59 avenue Général du Gaulle. Tél : 01 43 62 71 20 | reservation@lechangeur.org Le spectacle Corps Premiers, labellisé par Paris 2024 dans le cadre de l’Olympiade Culturelle. Crédit Photo : Christophe Raynaud de Lage.
Par Philippe Chevilley dans Les Echos - 16 avril 2024 Sillonnant les Hauts-de-France, Cédric Orain présente sa dernière création à la Comédie de Reims. Labellisée Paris 2024 dans le Cadre de l'Olympiade culturelle, elle donne la parole à des athlètes qui ont révolutionné leur discipline et interroge le sport comme passion de l'impossible. Après quoi courent les sportifs ? Assis sur un banc éclairé au néon, un homme interroge une femme qui incarne les grands noms du siècle dernier : Dick Fosbury, génie du saut en hauteur, Colette Besson, championne du 400 mètres, ou encore Kathrine Switzer, pionnière du marathon féminin. Si ces athlètes ont révolutionné les codes de leur discipline au défi du corps physique et social, ce sont moins leurs performances que leurs trajectoires qui font ici l'histoire. Témoignant de leurs parcours accidentés, semés d'imprévus et des hasards, toutes et tous ont battu des records en osant le hors-piste. Corps en puissance Dans une scénographie épurée et un dispositif audiovisuel minimal mais efficace, la mise en scène fait du corps le coeur de la pièce. Accompagnés de brèves images d'archives diffusées sur petite lucarne et de quelques pulsations sur les transitions, Claude Degliame et Maxime Guyon trouvent un espace de jeu à la mesure de leur brio. Du jargon des commentateurs extatiques au parler maladroit des sportifs en interview et à l'émotion à vif des supporters dans les gradins, le duo explore avec justesse et esprit ces endroits où les mots ne peuvent atteindre les sens. Mais c'est la parole performée d'Aurora Dini qui donne corps de la façon la plus frappante à ce paradoxe. Naviguant entre sport et art, l'artiste italienne enchaîne les figures de GRS au sol et de voltige au cerceau aérien. En même temps, elle se livre sur son enfance de gymnaste et sa reconversion, contrainte mais heureuse, en circassienne. Alors que chaque fibre de ses muscles se tend pour maintenir l'équilibre fragile de sa silhouette élancée, elle réussit par un tour de force à effacer l'effort derrière un mouvement gracieux et un récit intime. Entre la violence de l'excellence, le cloisonnement des genres et le culte des champions, le monde du sport est aujourd'hui mis à l'épreuve de ses impensés. Ainsi le texte de Cédric Orain, s'il donne parfois l'impression de se disperser, s'aventure sur un terrain riche de pistes à explorer. Guidée par une sensibilité et des intuitions fines, « Corps premiers » peut gagner en profondeur, mais avance déjà en tête de course. Callysta Croizer / LES ECHOS
par Jean-Pierre Thibaudat dans son blog - 22 avril 2024 Du TSE à Copi, de Fassbinder à Shakespeare, de Paris à Buenos Aires, Sandrine Dumas signe un portrait filmé aussi sensible que complice de la plus française des actrices nées en Argentine, Marilú Marini. Sandrine Dumas et Marilú Marini se sont rencontrées il y a longtemps sur un plateau, leurs rôles étaient ceux d’une fille et d’une mère. Tout est parti de là. D’une jeune actrice et d’une actrice plus âgée qui aurait pu être la mère de la première. Depuis, Sandrine Dumas est passée de l’autre côté, Marilú Marini a poursuivi sa carrière d’actrice. « Un jour, raconte Sandrine, elle m’a annoncé qu’elle partait avec le metteur en scène Pierre Maillet à Buenos-Aires pour y jouer un spectacle sur Copi qu’il avait créé en France. Et tout à coup, il m’a paru évident qu’il fallait que je filme ça. (...) C’était un élan plus qu’un projet, je devinais qu’elle serait très émue de jouer ce texte en Argentine... » Née en 1940 en Argentine d’un père italien et d’une une mère prussienne, Marilú Marini devient danseuse dans un pays où règne alors la dictature. Elle s’oppose au régime comme beaucoup d’autres jeunes épris de liberté et de justice, à Buenos-Aires elle montre ainsi à Sandrine l’endroit où elle a été enfermée 25 jours à l’isolement dans une cellule. Ses jeunes amis du groupe Tse emmenés par Alfredo Arias sont partis pour la France, elle les rejoint à Paris en 1975, intègre la troupe, devient pleinement comédienne et fait partie de la distribution de Peines de cœur d’une chatte anglaise au TGP, énorme succès en 1977. D’autres spectacles enchanteurs suivront comme Mortadela en 1992. Marilú parle joliment à Sandrine de sa « complicité très grande » avec Alfredo Arias. « J’étais admirative et complètement fascinée par lui. A Paris j’étais seule, ma famille c’était eux ». Plus tard, elle coupera le cordon ombilical (« Alfredo me manque mais je suis contente de cette distance, c’était bien pour nous deux »). Quand Alfredo Arias met en scène La tempête de Shakespeare dans la cour d’honneur du Palais des papes au Festival d’Avignon, Pierres Dux tient le rôle de Prospero et Arias confie à Marilú le rôle du diable malfaisant, Caliban, elle est affublée d’un impressionnant maquillage. Des années plus tard, dans son ultime spectacle Tempest project, Peter Brook confie à Marilú le rôle opposé, celui de l’ange Ariel. Le portrait de l’actrice avance ainsi par touches sensibles, entre présent et passé, répétitions et représentations, archives et conversations avec Sandrine Dumas. La femme assise de Copi en 1984 vaudra à Marilú Marini le prix hautement mérité de la meilleure comédienne. Le film nous offre une bel extrait de ce spectacle incroyable. « Je suis argentine mais dans mon corps il y a les tatouages de la culture française » dira-t-elle et ajoutera : « je déteste la nostalgie poignante des exilés ». Autre éclairage : « En Argentine on est toujours au bord du gouffre » souligne-t-elle alors qu’elle joue à Buenos Aires Los dias Felices (Oh les beaux jours) de Beckett dans une mise en scène d’Arthur Nauzyciel. Sandrine la suit à Marn el Plata où Marilú vivait autrefois avec sa mère, sa tante et son frère (le père s’était réfugié en Patagonie). Un sourire dans les yeux, elle se souvient du goût délicieux des king crabs…Et puis , soudain, comme une évidence résumant sa vie toujours sur la brèche à 84 ans : « L’endroit où je me sens le plus libre au monde, c’est sur un plateau. Tout est millimétré, mais je me sens libre ». Ce que filme aussi Sandrine Dumas avec beaucoup de tact, c’est le vieillissement du corps de l’actrice. « Avec l’âge, le corps de ma mère est très présent » dit Marilú, une mère dont elle ne sait « si elle m’a aimée ou non ». Elle se lève, quitte la loge qu’elle occupe avec une jeune actrice débutante, se dirige vers la scène, avant d’y entrer, elle se signe et crache par terre. Les dieux du théâtre veillent sur elle. « Tu peux filmer jusqu’à ce que je meurs » lance-t-elle à Sandrine. C‘est un « pacte » entre elles. Et de rire. Alors tous les acteurs et actrices du spectacle font la queue pour serrer entre leurs bras, Marilú Marini, l’unique. Jean-Pierre Thibaudat / Balagan Le film "Marilú Marini, rencontre avec une femme remarquable" sort ce mercredi, le 24 avril
|
par LIBERATION et AFP le 30 avril 2024 Dans une autobiographie à paraître le 1er mai, Isild Le Besco revient sur sa relation avec le réalisateur alors qu’elle n’avait que 16 ans et lui 52. L’actrice explique qu’elle n’est pas encore prête à porter plainte, bien qu’affirmant que le réalisateur l’a «violée». Elle ne sent pas encore prête. Dans Dire vrai (éditions Denoël), une autobiographie à paraître mercredi 1er mai, Isild Le Besco explique que, pour l’instant, elle ne s’imagine pas porter plainte contre Benoît Jacquot, dont elle estime pourtant qu’il l’a «violée». Dans son livre, elle revient sur sa relation avec le réalisateur, entamée sur le tournage de Sade, alors qu’elle avait 16 ans et lui 52. «Je n’ai pas envie de me confronter encore à ces institutions poussiéreuses, pensées et régies par des hommes […] C’est déjà tellement éprouvant d’écrire. De nommer. De faire face à ses maux», décrit l’actrice de 41 ans, sœur de la réalisatrice Maïwenn. Elle dit ne pas avoir répondu aux enquêteurs de la brigade des mineurs, qui souhaitent pourtant l’entendre. «Ils me sollicitent et me sollicitent encore pour recueillir ma plainte contre Benoît Jacquot et Jacques Doillon.» Se décrivant comme une adolescente «fragile et malléable», Isild Le Besco expliquait en février les effets destructeurs qu’a eue sur elle la relation entretenue entre ses 16 ans et ses 21 ans. Elle dénonçait une relation faite de «violences psychologique» ainsi qu’une emprise que le réalisateur de 52 ans exerçait sur elle. «Être victime, oui, mais de qui ? Et de quoi exactement ? De la sexualisation de mon corps au cinéma ? Des années d’emprise de Benoît Jacquot ? Du manque d’éthique professionnelle de Jacques Doillon ?», s’interroge-t-elle dans son ouvrage. Elle complète : «Dire que Benoît m’a violée, c’est évident […] J’étais une adolescente et je lui ai donné mon entière confiance. Il s’est substitué à mon père, ma mère, à toute figure d’autorité. En cela, son viol est aussi incestueux». Toujours en février, Isild Le Besco avait déclaré qu’il était «probable qu’à un moment» elle porte plainte contre les deux réalisateurs, en réaction aux accusations portées contre eux par l’actrice Judith Godrèche. Sa plainte a déclenché l’ouverture d’une enquête à leur encontre pour «viol sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité», et lancé un débat public sur les violences sexistes et sexuelles faites aux mineurs dans le cinéma. Si les deux réalisateurs nient toute accusation de relations non consenties, Jacques Doillon va plus loin, se disant victime de «mensonges», et en «mort sociale». Légende photo : Isild Le Besco, le 12 juin 2020. (Dominique Charriau/WireImage)
Publié dans Sceneweb le 30 avril 2024 Marie Lenoir et Thomas Quillardet prennent la direction du Festival Paris l’été à compter de septembre 2024. Ils succèdent à Laurence de Magalhaes et Stéphane Ricordel, qui tireront leur révérence lors de l’édition 2024 du festival (du 3 au 16 juillet) après huit années. La nouvelle direction a proposé un projet artistique qui, dans la continuité de l’actuel festival, proposera une diversité de formes esthétiques, tournées essentiellement vers les arts du mouvement et de nombreux spectacles en itinérance. Elle aura à cœur de mettre davantage l’accent sur le nomadisme, l’espace public devenant le principal espace de jeu. Elle entend par ailleurs jumeler le festival avec une ville du monde pour créer la rencontre sur le temps long, permettre les échanges avec les publics et entre les cultures. Le nouveau format du festival, qui doit s’étaler progressivement sur l’été, entre juillet et août, accueillera des artistes émergents et reconnus, signera le grand retour du cabaret et donnera la part belle aux initiatives en matière d’éducation artistique et culturelle tout au long de l’année. Directrice de production et de diffusion de la compagnie « 8 avril », Marie Lenoir est aussi, depuis 2017, responsable de l’accueil des publics et des professionnel·les du festival Paris l’été. Après une Maitrise d’Histoire Culturelle, Marie Lenoir démarre sa vie professionnelle comme attachée de presse jazz au sein du bureau de presse du Nice Jazz Festival de 2003 à 2006. Puis en 2007, elle participe avec Armelle Hédin à la création du bureau de production Avril en Septembre et prend en charge pendant dix années le développement, la communication et la diffusion d’une quinzaine d’artistes (Les Sea Girls, Le Cirque des Mirages, La Française de Comptages, Khalid K etc).
De 2015 à 2018, elle rejoint la Compagnie Veilleur, dirigée par Johanna Silberstein et Matthieu Roy en tant que directrice des productions et des tournées.
Depuis 2018, elle est à la direction de la production et diffusion de la Compagnie 8 avril (soutenue par la Drac Ile-de-France Ministère de la Culture au titre du conventionnement et par la Région Ilede-France au titre de la Permanence artistique et culturelle), aux côtés du metteur en scène Thomas Quillardet. Elle accompagne aussi le développement d’équipes artistiques plus émergentes comme le Collectif NightShot, le Collectif 18.3 et la Compagnie Biceps de Laureline Le Bris Ceps. Artiste, Thomas Quillardet est metteur en scène et directeur artistique de la compagnie « 8 avril ». Après une formation de comédien, Thomas Quillardet se consacre à la mise en scène et crée en 2004 Les Quatre Jumelles de Copi. En 2005, dans le cadre de l’année du Brésil, il organise à Paris le Festival Teatro em Obras. De 2006 à 2014, il rejoint le collectif théâtral Jakart/Mugiscué. En 2007, il monte au Brésil dans le cadre de la Villa Médicis-hors-les murs un diptyque de Copi, Le Frigo et Loretta Strong. En 2008, il met en scène Le Repas de V. Novarina. En 2009, dans le cadre de l’année de la France au Brésil, il crée à Rio de Janeiro L’Atelier Volant de V. Novarina. En 2010, il met en scène avec Jeanne Candel Villégiature d’après Goldoni. En 2012, il monte Les Autonautes de la Cosmoroute d’après J. Cortázar et C. Dunlop à La Colline et Les Trois Petits Cochons au Studio-Théâtre de la Comédie-Française.
En 2015, il fonde la compagnie 8 AVRIL, Où les cœurs s’éprennent, adaptation de Les Nuits de la pleine lune et Le Rayon vert d’Éric Rohmer, puis en 2017, il monte Tristesse et joie dans la vie des girafes de Tiago Rodrigues au Festival d’Avignon. En 2019, pour le Festival d’Automne cette fois, il met en scène Ton père d’après le roman de Christophe Honoré. En 2021, il met en scène L’arbre, le Maire et la Médiathèque, adaptation du scénario d’Eric Rohmer et Une Télévision française. En octobre 2023, dans le cadre du Festival d’Automne à Paris, Thomas Quillardet met en scène et interpréte En Addicto, récit de son expérience à l’issue de six mois de résidence artistique dans un service d’addictologie.
Le Festival Paris l’été est soutenu par la Ville de Paris, la DRAC Ile-de-France et la Région Ile-de-France. Il propose chaque année de nombreux rendez-vous artistiques et culturels, dans tout Paris et sa région. Théâtre, danse, cirque, musique, performances et installations plastiques s’emparent de nombreux lieux connus ou insolites de la capitale et en région, le plus souvent en plein air et en dehors des lieux traditionnels de spectacle. 30 AVRIL 2024 PAR DOSSIER DE PRESSE - publié par Sceneweb
Propos recueillis par Julia Wahl dans cult.news 28.04.2024 Valérie Dassonville : « Ce qui est intéressant dans Vis-à-vis, c’est que c’est vraiment un projet qui fait se rencontrer ensemble un nombre d’acteurs considérable pour la construction d’un objet et d’un espace commun » Valérie Dassonville nous parle de l’édition 2024 de Vis-à-vis, festival des créations en milieu carcéral, qui se déroulera au Paris-Villette du 2 au 5 mai.
- Le festival Vis-à-vis est un festival de type particulier, puisqu’il travaille avec des personnes en situation d’incarcération. J’imagine que cela suppose un travail partenarial particulier. Pouvez-vous m’expliquer comment vous le mettez en place ? Vis-à-vis est un temps fort de la création artistique carcérale. Ce que l’on entend par temps fort de la création artistique carcérale, c’est qu’on est vraiment sur le fait d’accueillir quelques jours des projets de création partagée, c’est-à-dire des équipes artistiques pluridisciplinaires (théâtre, danse, marionnette, mais aussi chanson) qui vont travailler sur des créations avec une partie d’acteurs et de techniciens professionnels et vont convier pendant tout le processus de création des amateurs sous main de justice. On est vraiment dans un travail de création à part entière avec cette spécificité que les artistes vont travailler en détention et accueillir dans leur projet des amateurs sous main de justice. Pour autant, le geste de création est le plus professionnel et le plus professionnalisant possible. Il est donc dans son objectif de se produire, de se répéter et de se diffuser. C’est là que Vis-à-vis se construit : accueillir ses œuvres au plateau, dans un théâtre, équipé (donc dans des conditions professionnelles scénographiques) et devant un public. Après, oui, ça demande des partenariats spécifiques. Mais Vis-à-vis est plutôt un protocole qui va englober un certain nombre d’acteurs de la culture et de la justice, notamment l’administration pénitentiaire, la magistrature, les services pénitentiaires d’insertion et de probation et à travers eux les coordinatrices et coordinateurs culturel∙les. On va travailler avec des personnes sous main de justice qui ont des parcours pénaux différents. On va devoir travailler avec les règles de l’administration pénitentiaire, son fonctionnement et en même temps on va tous devoir trouver du commun là-dedans pour que tout converge vers Vis-à-vis et mettre en commun avec le public tout ce travail-là. À propos des règles de l’administration pénitentiaire, qu’en est-il de ce que l’on peut apporter en prison ? Est-ce que cela complexifie la recherche d’artistes acceptant de s’y soumettre ? On peut apporter ce qu’on veut, à partir du moment où on a une liste qui est validée par l’administration pénitentiaire. Cette liste est contrôlée quand vous entrez en détention. Il y a aussi la possibilité de laisser des choses sur place. Il y a des tournages qui se font aussi en détention, donc vous faites entrer des ordinateurs des caméras… Il y a un projet par exemple au centre pénitentiaire de Meaux qui est un projet chanson avec des instruments de musique et des ordinateurs pour tout ce qui est MAO. À partir du moment où vous suivez le système de la validation, vous pouvez faire entrer tout ce que vous voulez. Je ne peux pas répondre de façon exhaustive [à la dernière question]. Je connais pour ma part beaucoup d’artistes qui travaillent en milieu carcéral, mais ce sera une réponse très partielle. Dans le cadre de Vis-à-vis en tout cas, qui est un tout petit élément d’information, il y a de plus en plus de compagnies qui créent des projets ambitieux en détention. Pour vous donner l’exemple de cette année, on est à quatre jours de festival et comme il y a deux projets plateau par soir, on est à huit propositions d’artistes qui vont travailler en détention dans les conditions les plus professionnelles possibles et on aurait pu en avoir d’autres sans problème. Je demande un projet par établissement pour faire une sélection qui n’est pas une sélection artistique puisque ce sont des projets présentés par les coordinatrices culturelles. Moi je n’exerce pas de direction artistique : à partir du moment où on s’est mis d’accord sur ce qu’est une création partagée et où tout le monde l’a compris, je valide les choix que me font les coordinateurs de travailler avec telle ou telle équipe. Du coup, c’est vraiment un travail de collaboration et de confiance. Après, oui, les contraintes de de la création en milieu carcéral font que tout le monde n’y va pas, que tout le monde ne peut pas y aller, que tout le monde ne veut pas y aller, mais ça c’est vrai de façon générale. C’est-à-dire qu’il y a des compagnies qui adorent la médiation culturelle, d’autres pas. Il y a des compagnies qui adorent créer hors les murs et d’autres pas. L’évolution du protocole culture justice et du lien entre les artistes et l’administration pénitentiaire fait que j’ai le sentiment que cela se développe. Ça se développe, ça se professionnalise. On a beaucoup d’exemples d’artistes reconnus comme Joël Pommerat ou Olivier Py, comme Pascal Rambert, qui ont travaillé ou qui travaillent, qui sont très impliqués dans la création carcérale et il y en a aussi beaucoup beaucoup de moins emblématiques, mais qui font un travail formidable. Et Vis-à-vis, c’est l’occasion de voir ça, parce que le grand public n’a pas conscience de ça. Quand vous parlez de professionnalisation, est-ce que cela concerne également les détenus une fois qu’ils sortent des murs, est-ce qu’il y en a un certain nombre qui en font leur métier ? Oui et non. Je ne peux pas vous répondre de façon exhaustive et ce n’est pas ou tout noir ou tout blanc. Alors, quand je parle de professionnalisation, je ne parle pas de l’après : je parle déjà des projets. Ces créations, elles sont pour les artistes professionnalisant dans la mesure où ils vont chercher de la production et de la diffusion comme ils le feraient pour d’autres créations. C’est pas un pas de côté : c’est pas parce qu’on travaille en prison, qu’on n’est pas en création. Donc c’est déjà faire que les artistes considèrent leur geste de création comme un geste professionnel. C’est professionnalisant pour les personnes y compris sous main de justice dans l’expérience de création partagée, c’est-à-dire qu’il travaille avec des professionnels, aux côtés de professionnels, dont l’ambition d’une création qui va être diffusée devant un public qui va payer sa place. Éventuellement il y aura d’autres dates et dans certains cas, tout le monde est sous contrat et tout le monde est payé. Déjà, cette expérience là, même si ce sont des gens qui ne deviendront pas comédiens, pas danseurs et pas metteurs en scène, l’expérience qu’ils auront eu dans le cadre de leur peine de prison, va être professionnalisante parce qu’elle va être vécue comme un engagement professionnel. Ensuite, est-ce que certains d’entre eux vont avoir envie de continuer ? Non, pas tous bien sûr. Il y en a à qui ça ouvre des imaginaires et des possibilités de découvrir des métiers et des envies tout simplement. Et là, c’est difficile de vous faire un tableau complet, parce qu’il y a autant de cas que de personnalités, mais il y a des artistes et des lieux qui s’engagent dans le suivi auprès de certaines personnes qu’elles auraient rencontrées en détention. Encore une fois, le plus emblématique c’est Joël Pommerat parce qu’il fait quelque chose de très rare : il s’est engagé, et il le fait, à accueillir les amateurs sous main de justice avec lesquels il a travaillé à la maison centrale d’Arles dans sa compagnie Louis Brouillard donc je crois qu’il a trois ou quatre comédiens permanents et qui intègrent les créations de la compagnie. Vous avez d’autres metteurs en scène, comme Olivier Fredj qui a continué avec à travailler avec des amateurs sous main de justice, y compris après leur sortie et sur le long terme ; et il y a des personnes qui vont intégrer des chantiers de formation comme Lucane qui fait de l’insertion professionnelle par les métiers du spectacle, artistiques, techniques et administratifs. Après, ce qui manquerait peut-être, c’est une structure ressource qui centraliserait des informations, des contacts, des mises en réseau. Vous avez dit tout à l’heure : « Ce n’est pas un pas de côté, c’est un geste professionnel ». Du coup, êtes-vous uniquement financé∙es sur des lignes budgétaires de type culture-justice ou action culturelle au sens large, ou êtes-vous aussi financé∙es sur des lignes budgétaires de création ? C’est l’objectif. Quand on parle de pas de côté c’est-à-dire qu’on va soutenir les artistes mais aussi les enfermer par la question justement des lignes budgétaires et les cases budgétaires parce que là aujourd’hui les artistes produisent avec les politiques interministérielles : il y a d’un côté les SPIP qui mettent de l’argent dans la culture en détention et de l’autre côté la DRAC, mais pas la DRAC aide aux projets et les services liés au théâtre, mais la DRAC action territoriale et politique interministérielle. Donc, ce ne sont pas les mêmes montants et ce ne sont pas les mêmes critères d’éligibilité. Après, il y a d’autres partenaires qui viennent se greffer là-dessus avec des collectivités et du mécénat avec des fondations et des partenaires que les compagnies apportent. Par exemple, il y a des compagnies conventionnées qui prennent sur une partie de leur conventionnement pour mener ces projets. Donc là, c’est bien de l’argent de la culture, mais qui transite par les compagnies. On a eu le cas un jour de l’Iliade [création 2017 de Alessandro Baricco avec le Centre pénitentiaire de Meaux], qui est un projet qui s’est créé dans le cadre de Vis-à-vis et qu’on a souhaité développer et en faire vraiment une création pour que le Paris-Villette l’accueil au sein de sa programmation. Et on s’est heurté à beaucoup de murs un peu étanches et d’institution qui nous disaient que c’est un projet avec des détenus amateurs et que ce n’est donc pas éligible par exemple à l’aide au projet de la DRAC. Là on a creusé en disant : « Ah bon mais pourquoi ? Parce qu’il y a des amateurs au plateau. Ah bon, mais dans ce cas, Pommerat quand tu le fais Ça ira c’est pas professionnel alors parce qu’il y a quand même 50 amateurs dans Ça ira. Quand Didier Ruiz travaille avec des amateurs, c’est pas professionnel ; quand Jérôme Bel travaille avec des amateurs, c’est pas professionnel. » Donc, l’argument nous paraissait quand même extrêmement douteux et ils ont dû en trouver un autre. Ils nous ont dit : « Oui, mais vous n’avez pas deux lieux partenaires. » « Mais si on a le Paris-Villette pour une dizaine de dates et on a le centre pénitentiaire. » Donc, je les ai cherchés un peu, je les ai poussés dans leurs retranchements. Finalement, on a trouvé un deuxième lieu, c’est Mains d’œuvre qui s’est porté candidat pour accueillir une diffusion supplémentaire de l’Iliade. Du coup il a été éligible et il y a eu l’aide au projet à l’unanimité. Et puis Arcadi [Action régionale pour la création artistique et la diffusion en Île-de-France, dissous en 2018] est venu dessus et puis la ville de Paris a mis de l’argent : il y a eu finalement un projet de 130.000€ de production. Il y avait quinze comédiens au plateau, tout le monde était sous contrat, tout le monde était payé et le spectacle a tourné pendant deux ans. Et nous, ça a été un des plus gros succès du Paris-Villette en cinq ans. Alors, à partir du moment où on est allé jusque-là, on est entré dans la question de la création (dans laquelle je suis bien consciente que le nombre de dates de diffusion doit entrer en ligne de compte) et c’est bien là que c’est compliqué : beaucoup d’acteurs culturels ne comprennent pas ou alors font semblant de ne pas comprendre que ces projets là peuvent tourner. Une personne qui est en détention, à partir du moment où elle a des autorisations d’aménagement de peine, elle peut, à chaque fois qu’il y a une date, faire une demande de permission de sortie dans le cadre de son travail. Des six détenus longue peine qu’il y avait dans l’Iliade, il y en a un qui était incarcéré jusqu’à la fin. Donc, pendant deux ans, à chaque fois qu’il y a eu des dates, il est sorti. Donc c’était un peu compliqué, je vous l’accorde, mais c’est possible. Cet environnement professionnel, pour qu’il soit recréé il faut que tout le monde joue le jeu. Avez-vous pu reproduire l’exemple de l‘Iliade sur d’autres propositions ? La première chose, c’est que ces fameux programmateurs culturels, ils étaient absents lors de la première édition du projet et, huit ans plus tard, presque chaque projet a un second partenaire culturel. Par exemple, pour la première fois, le théâtre Louis Aragon de Tremblay-en-France est partenaire du projet mené avec l’une de ses artistes en résidence. Il y a eu de l’argent, il y aura Vis-à-vis et il y aura une date au TLA. Ce format là, ça commence à se développer : Claire Jenny, chorégraphe, a une date aux Ateliers de Paris Et elle va jouer aussi au théâtre Jean-Vilar de Vitry-sur-Seine. Cette année, on a quelque chose de très intéressant : c’est le Hall de la chanson, c’est un centre national du répertoire de la chanson française qui se situe derrière la Grande Halle de la Villette, qui est donc conventionné en direct par la DGCA, qui a une école dont ils ont délocalisé un cycle entier de deux mois en détention (avec le centre pénitentiaire de Meaux) et ils ont accueilli dans ce cycle pédagogique un groupe de huit personnes sous-main de justice. Ce projet là, ils l’aboutissent pour Vis-à-vis, mais du coup ça devient une création qui entre au répertoire du centre national de la chanson – un projet sur le répertoire de Charles Aznavour qui était parrain de l’école -. Ce projet est créé à Vis-à-vis mais est repris trois fois après au hall de la chanson dans le cadre de sa création et de sa diffusion et il est disponible en tournée. Alors précisément, le Hall de la chanson est un partenariat tout nouveau : qu’est-ce qui a présidé au choix d’étendre les différentes propositions à la musique et à la chanson ? Déjà, ça reste du spectacle vivant. Mais c’est surtout que, comme je vous le disais, moi je n’exerce aucune direction artistique. En revanche, il peut m’arriver de faire se rencontrer les uns et les autres. C’est-à-dire que j’ai beaucoup d’artistes qui viennent me voir en me disant : « Je suis intéressé.e par les projets créations en milieu carcéral ; est-ce que tu peux m’expliquer comment ça se passe ? » Ça fait partie aussi de mes missions de développement de ce projet et là, le Hall de la chanson, je les connais bien parce qu’ils sont sur le parc de la Villette. Donc, à un moment je leur ai demandé : est-ce que ça vous dirait de réfléchir à un projet de création en milieu carcéral ? Ils m’ont dit oui. À ce moment-là je leur ai demandé de réfléchir à un projet et je leur ai fait rencontrer la coordinatrice culturelle de Meaux. Là, ils se sont rencontrés, ils ont échangé sur un projet possible et à partir de là j’ai laissé faire. Donc c’est pas un choix de la musique en particulier même s’il est vrai que ça m’intéresse beaucoup parce que la chanson au plateau, c’est quelque chose d’assez rare mais c’est aussi un mouvement artistique que j’identifie comme revenant beaucoup sur les scènes en ce moment. Outre la chanson, quelles seraient d’après vous les autres spécificités de cette édition 2024 ? On va accueillir un projet qui s’est monté entre le centre pénitentiaire de Caen et le centre dramatique national de Caen. C’est la première fois qu’on va accueillir un projet de Normandie en revanche, Vis-à-vis a toujours accueilli des projets d’une autre région. Jusqu’à présent c’était la région PACA : on a accueilli Antigone monté par Olivier Py avec le centre pénitentiaire du Pontet, on a accueilli la captation de Joël Pommerat, on a accueilli un projet monté avec le centre pénitentiaire d’Aix… Cette ouverture sur d’autres territoires a permis de conventionner le théâtre Paris-Villette avec le ministère de la justice et le ministère de la culture pour le rayonnement d’un développement national de Vis-à-vis. Maintenant, c’est officiel, je peux aller répliquer le protocole Vis-à-vis sur d’autres régions. On en a fait un pilote en 2023 à la scène nationale de Châteauvallon et ça s’est très bien passé. À partir de ces expérimentations là, ça devient un projet de développement national. Donc il est possible qu’il y ait une deuxième édition en PACA en 25 et on commence à réfléchir à une première édition en 2026 en Normandie. Avez-vous déjà des idées de partenaires en PACA en 2025 ? Oui, parce que la grande intelligence de la scène nationale de Châteauvallon ça a été de dire nous on accueille la première édition mais ce serait bien qu’on tourne. Donc, quand on a travaillé pendant deux ans cette première édition à Châteauvallon, on a invité d’autres partenaires culturels (la friche Belle de mai, le ZEF, la Criée, le théâtre Durance, le festival d’Avignon) et toutes ces équipes ont suivi la construction à Châteauvallon. Du coup, quand on a parlé de la deuxième édition, on avait déjà des lieux et des équipes. Là, on est en train de construire avec Avignon pour 2025. Ce n’est pas du tout sûr : on vérifie le principe de faisabilité, mais le directeur Tiago Rodrigues est tout à fait enthousiaste à l’idée de le faire. Ça ne se passerait pas pendant le festival, mais à la rentrée à la FabricA et avec l’équipe du festival. Et la Criée se propose de faire la troisième édition. Pour la Normandie, je pense qu’on va travailler de la même façon : on a le CDN de Caen qui est très intéressé par l’accueil d’une première édition et on pourra aussi rencontrer d’autres partenaires culturels pour élargir la question. Ce qui est intéressant dans Vis-à-vis, c’est que c’est vraiment un projet qui fait se rencontrer ensemble un nombre d’acteurs, considérable pour la construction d’un objet et d’un espace commun. Alors dans l’édition du Paris-Villette il n’y a pas que du spectacle vivant, puisqu’il y a aussi des installations, des créations sonores et des vidéos : qu’est-ce que cela apporte d’après vous ? On a ouvert dans la mesure du possible à des créations cinéma, podcast ou arts plastiques parce qu’on a des établissements pénitentiaires qui ne peuvent pas jouer le jeu du spectacle vivant parce qu’il y a des établissements où il n’y a pas de permissions de sortie. Donc, je me suis dit : « Si on peut accueillir ces projets là, à condition que ce soit bien de la création partagée, pourquoi pas ? » donc on demande aux coordinateurs et coordinatrices de nous faire remonter des propositions et là c’est vraiment dans un cadre programmatique c’est à dire quelle surface d’exposition on a, combien de projets on peut accueillir ? Et pour ce qui est des capsules vidéo ou son, quand c’est très long, on crée des QR codes et on renvoie le public qui le souhaite à l’écoute, et quand c’est court, on le met en ouverture de soirée. Le film d’animation qui a été fait avec des plasticiens et des personnes sous main de justice de Fleury-Mérogis, il est génial ! Il dure cinq ou six minutes, ça aurait été dommage de pas le montrer. Pouvez-vous nous présenter rapidement la programmation de cette édition ? Toutes les soirées commencent à 19h00 et ça se termine vers 22h30 maximum. Pour les personnes qui souhaiteraient réserver, il faut réserver pour la vie entière. Jeudi, en première partie, vous avez Cette compagnie là, avec Antony Quenet, qui travaille avec le centre pénitentiaire de Melun, Encore la fin du monde. En deuxième partie, vous avez le projet Blossom de la compagnie Kilaï qui travaille avec le théâtre Louis-Aragon et le centre pénitentiaire de Villepinte. Ça, c’est de la danse. Et on aura un tout petit podcast qui sera diffusé en première partie, réalisé avec la centrale de Poissy et l’association AR Extrême. Pour le vendredi il y aura deux podcasts, un clip de rap toujours avec Poissy et le petit film d’animation dont je vous ai parlé. Au plateau, il y a le projet Méduse, dont je vous ai parlé, avec le centre pénitentiaire de Caen et le centre dramatique national de Caen, et comme artistes : Fanny Catel et Raoul Fernandez. C’est un projet qui a déjà été créé et joué au CDN de Caen. En deuxième partie, il y a Je t’épouserai, allégorie du REICKO par la compagnie du Reicko. C’est un projet très beau. C’est de la danse et de la vidéo avec le centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis. Le samedi, il y a Ici et là de la compagnie Virgule, avec Claire Jenny, qui travaille aussi avec le CDCN de l’Atelier de Paris et le centre pénitentiaire Sud-Francilien. La particularité du travail que mène Claire, c’est qu’elle mélange des danseurs professionnels, des amateurs éclairés avec lesquels elle travaille depuis des années et des amateurs sous main de justice, hommes et femmes. Ce sera suivi de la compagnie Nar6, qui va mener un projet de théâtre à partir de la nouvelle de Jack London « Le Ring » et qui travaille avec le centre pénitentiaire de Fresnes. Et on termine dimanche avec le projet Et pourtant… sur le répertoire de Charles Aznavour avec le hall de la chanson, son école et le centre pénitentiaire de Meaux suivi de Sombrero qui va être une création d’artistes plasticiens performateurs, Julien Perez et Thomas Cerisola. Ils montent une création sonore et théâtrale autour de la question du match de foot. J’ai hâte de le voir parce que je n’ai toujours rien compris à ce projet mais il a l’air passionnant. C’est la création d’une bande son d’un match fait en direct. Ça, c’est le centre pénitentiaire de Paris La Santé. On est donc sur huit projets plateau, deux expo. peinture-arts plastiques, il y a trois projets vidéo et un podcast d’une émission de radio. Julia Wahl / cult.news Festival Vis-à-vis, Théâtre Paris Villette, du 2 au 5 mai 2024. Visuel : Valérie Dassonville – ©Ulysse Chaffin
Par Christine Friedel dans Théâtre du blog - 29 avril 2024 Qui a eu la chance de la rencontrer sur scène donc chez elle, ne l’oublie pas… La Dame assise de Copi, elle était la seule capable de jouer aussi bien qu’un dessin qui se serait animé tout seul. Mais alors, animé ! Même sur sa chaise pathétique, Marilù Marini est en caoutchouc, peut tout faire avec son corps de danseuse et sa voix qui n’a plus forcément envie de chanter, mais qui se travaille : on la voit dans le film, perfectionner sa diction, au-delà du simple exercice, avec déjà un engagement total dans le jeu, en un français teinté de ses origines argentines, c’est à dire mondiales. Complice active d’Alfredo Arias (directeur du Théâtre de la Commune-Centre Dramatique National d’Aubervilliers de 85 à 91) et du groupe TSE qu’il avait fondé ), elle partage avec lui, avec eux, un théâtre qui ne craint aucune transgression et qui tient le pari de la perfection formelle. Un exemple, qu’on voit furtivement dans le film: parfois à la fin du spectacle, le groupe se paye et offre au public, le luxe de saluer en jouant une suite de courts tableaux vivants si précis, si forts et si drôles qu’on aurait pu rester des heures encore à les applaudir. Mais ils avaient le sens de la juste durée. Saluts, entrées en scène avec toutes les superstitions possibles, assumées ou tournées en dérision -enfin, ça peut servir, on ne sait jamais-, comme le fameux : «merde» à prononcer avant le lever du rideau*… Marilù nous emmène dans l’envers du théâtre et, en une seconde, à son endroit exact, vers l’actrice. Le film est un exercice d’admiration d’une réalisatrice et comédienne à une autre, avec qui elle a travaillé, jouant le rôle de sa fille. Cela ne s’oublie pas.
Sandrine Dumas ne nous raconte pas l’histoire du théâtre : ceux qui ont eu la chance de voir Marilù Marini sur scène ou au cinéma, se referont leur propre histoire. Mais aux autres, le film ouvre des portes un instant, sur une période éblouissante, celle du théâtre des Argentins comme Alfredo Arias, Jorge Lavelli, Victor Garcia, Copi… qui avaient fui en France, la dictature de leur pays.
Ni regrets ni nostalgie mais des piqûres de rappel : cette audace et cette vivacité d’écriture ont existé. Ce travail très précis, cet humour froid,et ces remarquables costumes (hommage à Françoise Tournafond (1940-2011), la grande costumière entre autres au Théâtre du Soleil et au Théâtre du Campagnol) : toutes ces miettes de souvenirs sont autant d’incitations à l’exigence et à la liberté. Au centre, dans le désordre, la vraie Marilù, en personne. Clown et tragédienne, faisant volte-face en une seconde, vraie boule à facettes, choisie par Alfredo Arias pour jouer Caliban,et par Peter Brook pour Ariel, dans dans La Tempête de Shakespeare A la l’esclave souillé de terre et de haine, et le favori ailé, aérien, tout aussi esclave.
Sandrine Dumas a emmené Marilù Marini sur le théâtre -c’est le cas de la dire- de quelques-uns de ses exploits, aujourd’hui, joyeuse, lanceuse de défis et jambe en l’air. Elles s’accordent toutes les deux, elle et la cinéaste, le droit de la montrer fatiguée, inquiète et hop! de nouveau à vif. Un film sur le théâtre, sans doute et surtout sur cette femme remarquable, saisie, accompagnée dans son mouvement, le passé s’invitant dans le présent, et réciproquement, toujours changeante, pétillante. « Tu peux me filmer jusqu’à ma mort », « d’accord ». Pacte conclu entre elles. Et cela fait la qualité de ce film, dans le désordre de la vie…
Bande-annonce du film Christine Friedel *allusion à la présence autrefois de crottin de cheval en masse devant un théâtre, donc, signe de succès.
Par Lara Clerc avec AFP, publié par Libération le 29 avril 2024 Au moment où les conséquences des coupes budgétaires commencent à se faire sentir dans le secteur, le ministère de la Culture et les collectivités viennent d’annoncer un soutien financier visant à favoriser les mutualisations et les coopérations. Un rétropédalage ? Alors que les théâtres déplorent une baisse de subventions et des conséquences très concrètes sur leur fonctionnement, la ministre de la Culture Rachida Dati a annoncé vendredi, lors d’une visite à Bourges, un renforcement budgétaire du plan «Mieux produire, mieux diffuser» à hauteur de 8,6 millions d’euros. Cette mesure intervient dans le cadre d’un partenariat avec les collectivités territoriales, qui, elles, investissent 13,5 millions d’euros, pour un montant global de 22,2 millions d’euros. Cet apport est destiné à favoriser les mutualisations et les coopérations dans la création de spectacles vivants et des arts visuels, a complété le Ministère dans un communiqué. La sélection des projets concernés par cette aide serait déjà finalisée, et concerne «254 structures labellisées et conventionnées ou réseaux de coopération, engagés à mettre en œuvre des initiatives répondant aux enjeux de ce plan, [qui] vont bénéficier de ces moyens sur l’ensemble du territoire hexagonal et ultramarin, dont un tiers au bénéfice des territoires ruraux», a précisé le ministère. Il complète : «Les projets retenus concernent l’ensemble de la création artistique : musique (22 %), danse (13 %), arts visuels (12 %), théâtre (12 %), arts de la rue (5 %), cirque (4 %), marionnette (1 %). 31 % des projets sont pluridisciplinaires». Cette annonce a été prononcée le jour où deux structures publiques déploraient une baisse de moyens drastique : à Toulouse, le conseil départemental de la Haute-Garonne a diminué de 80 % sa subvention au ThéâtredelaCité – CDN Toulouse Occitanie pour 2024, soit 190 000 euros, tandis qu’à Créteil, la Maison des Arts et de la Culture a annoncé la suppression de huit spectacles prévus pour la saison prochaine, à l’issue de la baisse de subvention du conseil départemental du Val-de-Marne qui s’élève à 150 000 euros. Un signal alarmant et un coup de dur de plus pour le secteur, qui doit déjà faire face aux conséquences de l’amputation du budget du ministère de la Culture de 204,3 millions d’euros, dont près de 96 millions pour le programme de la création artistique. Secteur en crise Le ministère de la Culture explique tenter de pallier cette suppression en conditionnant son plan «à un principe de partenariat avec les collectivités territoriales», et qu’elle renforce «la coopération de l’ensemble des pouvoirs publics en faveur de la création sous toutes ses formes». Les syndicats déplorent une baisse de diffusion considérable, alors qu’un rapport publié en 2022 par la Cour des comptes estimait que le nombre moyen de représentations pour un spectacle était de 3,7 dans un Centre dramatique national et 2,3 dans une scène nationale, et que l‘Association des Professionnels de l’Administration du Spectacle (LAPAS) estimait début avril une baisse de 56 % du nombre de représentations programmées pour la saison 2024/25.
Par Sonya Faure dans Libération, le 26 avril 2024 Stéphane Braunschweig retrouve la langue du dramaturge norvégien et fait jaillir le trouble et l’humour de cette réflexion sur le dédoublement et le bonheur. Avant même la pièce, il y a la liste de ses personnages : «une mère», «une autre mère», «une sœur», «une autre sœur». «Un moi». Et, déjà, on retrouve la curieuse écriture d’Arne Lygre, faite de dissociations, de jeux de rôles qui s’échangent, de récits qui s’enchâssent. Sur un immense tapis de feuilles d’automne qui recouvre toute la scène des Ateliers Berthier, il n’y a rien qu’un banc, un très, très long banc. Comment peut-on être proche quand on est deux sur un banc pareil ? A moins qu’il ne faille être plus nombreux, toujours plus nombreux, pour s’y rencontrer vraiment ? Une mère et sa fille s’y retrouvent, elles ne se sont pas vues depuis longtemps, la fille travaille à l’étranger. Elles sont si heureuses d’être ensemble, quoiqu’un peu fébriles. C’est vraiment «un jour de joie». Bon sang, mais que fait Aksle, le fils, le frère, il devrait déjà être là… Ils s’étaient donné rendez-vous ici pour être seuls. Tout comme ce couple séparé qui arrive, tout comme cette famille en deuil que voilà. Tous voulaient être seuls, ils se retrouvent à coudoyer et mettre leur grain de sel dans l’affaire du voisin – très belle image que ces beaux acteurs tout serrés sur le long banc. Identités multiples Jours de joie (créée pour la première fois à Oslo en 2021) est la cinquième pièce d’Arne Lygre que Stéphane Braunschweig met en scène. Les précédentes étaient sombres et angoissantes. L’auteur norvégien s’attaque cette fois à la joie, au bonheur, à ce qui les menace sans toutefois pouvoir en venir à bout. L’humour, que Stéphane Braunschweig assurait percevoir déjà dans ses pièces beaucoup plus oppressantes, est ici évident, porté notamment par «une mère», personnage formidable, actrice formidable, Virginie Colemyn, qui emporte tout de sa voix qui sort de ses rails, comme les récits de Lygre. Qu’est-ce qui rend heureux ? Comment faire venir la joie ? Faut-il s’y contraindre, comme le laisse penser le sourire immense d’«une mère» qui ouvre la pièce, sourire trop immense pour être celui d’une réelle félicité ? Chez Lygre, le champ lexical est resserré, les mots sont simples et ils posent simplement des questions comme : Que reste-t-il quand on change ? Quelle est «cette part qui résiste» ? Qu’entend-on derrière les mots ? Que sont ces «légères hésitations de temps à autre» ? N’est-ce pas la plus grande joie d’une mère de dire au soir de sa vie à son enfant : «Je t’aime bien comme adulte !» N’est-ce pas la plus grande réussite que de déclarer à son ex-mari : «Nous allons mieux ensemble divorcés !» Chaque fois la question du dédoublement, des identités multiples. Bribes de vies Chez Lygre, du texte s’imbrique toujours dans le texte. Le dramaturge joue de différents registres d’énonciation et, sur scène, les personnages disent parfois ce qu’ils pensent, parfois ce qu’ils disent, et disent qu’ils le disent. Ainsi Virginie Colemyn quand elle entre sur scène : «Une mère dit : je suis heureuse d’avoir trouvé cet endroit. Une mère dit : ça me rend heureuse de venir ici.» Puis Cécile Coustillac : «Une sœur pense : voilà ce que maman voulait me montrer ? Une sœur pense : c’est tout ?» C’est une langue qui crée toujours un léger trouble, une légère distance entre le personnage et lui-même, un détachement. Les thèmes qui irriguent l’œuvre de Lygre sont bien là : la filiation, le couple et sa fin, mais surtout la disparition (de précédentes pièces de Lygre se nomment Je disparais ou Rien de moi). Un beau jour, un jour de joie, l’un des personnages décide de disparaître. Un personnage disparaît mais pas son incarnation, puisque le comédien qui lui donnait corps (Pierric Plathier) va alors jouer son amant abandonné, son double, celui qui reste et imagine les vies qu’il ne partage plus. Des hypothèses, des bribes de vies qui peut-être existent, qui en tout cas le pourraient, des vies non advenues. Vertige. Les Jours de joie de Braunschweig en procurent, de la jouissance. Et si on perd un peu, en troquant l’angoisse contre la joie, la bouleversante étrangeté que portaient les précédents textes de Lygre (la seconde partie du diptyque, surtout, s’amollit un peu dans le confort d’un canapé), la belle lumière du spectacle finirait presque par nous convaincre que nous pouvons encore en vivre, de beaux jours. Jours de joie d’Arne Lygre, mise en scène et scénographie Stéphane Braunschweig à l’Odéon-Ateliers Berthier, Paris (75017), jusqu’au 5 mai. Légende photo : Un immense tapis de feuilles d’automne recouvre toute la scène des Ateliers Berthier dans «Jours de joie». (Simon Gosselin)
Propos recueillis par Anne Diatkine dans Libération - 26 avril 2024 Dans un entretien exclusif, l’actrice revient sur ses débuts au cinéma à la lumière de la révolution #MeToo. Evoquant les nombreuses scènes de nu, les rôles systématiquement sexualisés ou encore les agressions sur les tournages. C’est une parole qui va vite, aussi rapidement que la jeune actrice au milieu des années 80 qui veut exercer son art – au théâtre d’où elle vient car ses deux parents sont comédiens, et au cinéma, peuplade étrangère dont elle ignore alors totalement les codes, les coutumes et le vocabulaire. «Casting» fait partie des mots inconnus. C’est l’histoire d’une jeune fille animée par une nécessité intérieure que rien ne peut décourager. Elle découvre un monde, certes brillant et désirable, mais constamment susceptible de malmener son intégrité ou la mettre en danger. Où mettre les limites ? Comment les appréhender quand on a 18, 20 ans, avec pour seul guide son intuition ? C’est la parole d’une actrice devenue star, à la filmographie internationale, époustouflante en raison de la diversité des grands cinéastes qui jalonnent sa route – Leos Carax, Krzysztof Kieślowski, Michael Haneke, Abbas Kiarostami, Claire Denis, Olivier Assayas, André Téchiné pour n’en citer que quelques-uns, et récompensée par les prix les plus prestigieux (oscar, coupe Volpi à la Mostra de Venise, césar, prix d’interprétation à Cannes). Juliette Binoche a une particularité : même quand elle était très jeune, elle n’a jamais fait du silence sa loi. Ne pas s’encombrer, mais revisiter sans anachronisme ses débuts à la lumière de la révolution #MeToo : tel est le pari de cette rencontre avec Libération. En France, aucune actrice de renommée internationale n’avait jusqu’à présent pris la parole. L’entretien s’est fait en plusieurs temps, et Juliette Binoche, qui l’a relu et peaufiné pour préciser certaines formulations ou détails, s’est investie largement dans son écriture. «Mes tout débuts se résument à deux questions : Comment survivre ? Comment faire de ce désir de jouer une réalité ? Encore au lycée, j’ai eu la possibilité de prendre un café avec Dominique Besnehard qui m’a proposé de passer à son bureau pour apporter une photo de moi nue, précision qui m’avait embarrassée, dans l’éventualité d’être prise dans Mortelle Randonnée de Claude Miller au début des années 80. Je n’ai pas accédé à ce (petit) rôle, mais Besnehard m’a fait un cadeau inespéré : les coordonnées d’un agent. A partir de là, bac en poche, je me suis mise à courir les castings à droite à gauche tout en étant caissière au BHV et en poursuivant mes cours de théâtre le soir chez Véra Gregh, ma boussole. Les réponses étaient souvent négatives. Je passais parfois plusieurs tours, mais dans cette grande foire aux enchères des actrices, je ne parvenais jamais à la dernière étape. Le tout premier casting (je ne connaissais pas encore ce mot) c’était pour les Meurtrières, un film que Maurice Pialat n’a finalement pas tourné. Au mur, était placardée une affiche de Diva de Jean-Jacques Beineix avec le profil d’un comédien que je venais de croiser, Dominique Pinon. Pialat a suivi mon regard : “Vous aimez ce film ?” J’ai répondu «oui !» : «Eh bien, prenez la porte.» J’ai pris la porte sans l’emporter, la tête brouillée. Puis on m’a rappelée peu de temps après… pour me poser des questions sur mon rapport à la mort. «Jean-Luc Godard a vu une photo de toi, il aimerait te voir» «Quelques mois plus tard, j’ai tourné deux jours dans Liberty belle. Le réalisateur Pascal Kané m’invite à dîner à l’hôtel Nikko dans les hauteurs d’une tour pour me parler, m’avait-il assuré, d’un autre projet. Alors qu’il me désigne la vue sur le front de Seine, il se jette sur moi pour m’embrasser. Je l’ai repoussé vigoureusement : “Mais j’ai un amoureux !” Je n’en revenais pas. J’avais quelques repères de méfiance, une première fois pour avoir été touchée par un maître d’école à 7 ans qui m’apprenait à lire en caressant mon sexe derrière son bureau devant la classe. Le choc était de m’apercevoir que ce réalisateur se servait lui aussi d’un stratagème et de ma bonne foi pour arriver à ses fins. Quelques années plus tard, j’ai relaté l’agression de Kané dans une revue de cinéma, et il a exigé que je demande un rectif, pour dire que la journaliste m’avait mal comprise. Refus de ma part. En plus il faudrait se taire ? «Vient le jour où mon agent me dit : “Jean-Luc Godard a vu une photo de toi, il aimerait te voir.” A l’époque, il fallait avoir ses propres photos qu’on déposait dans diverses officines, ça coûtait une blinde. J’avais transformé ma salle de bains en labo et développais moi-même les images que prenait mon amoureux. J’avais réussi mon premier rendez-vous, je devais passer mon deuxième examen. J’étais obnubilée par une infection oculaire attrapée trois jours avant au BHV et la crainte de n’être pas choisie à cause de cet œil déformé. J’arrive, Jean-Luc me donne les instructions. Me déshabiller, tourner autour d’une table toute nue en lisant un poème tout en me peignant les cheveux pendant qu’il filme. S’il avait exigé que je décroche la Lune, j’aurais sans doute trouvé le moyen d’y parvenir. Je n’ai pas eu le rôle. Quelques jours plus tard, un message m’apprend que Godard avait créé un rôle «rien que pour toi», précise le répondeur, «tu seras la copine de Marie». C’était pour Je vous salue Marie. On est restée plusieurs mois à attendre dans un hôtel en Suisse, sans scénario, avec en prime, pour moi, des cours de basket. J’étais impressionnée par la présence de Jean-Luc, il baillait à l’intérieur des phrases, son regard paraissait inatteignable derrière ses lunettes fumées, mais il avait la main généreuse quand il signait nos chèques. On pouvait survivre. Pendant le tournage, j’ai couru ramasser une balle de basket qui était partie hors champ à la fin d’une prise. Réaction cinglante du cinéaste : «Fais pas semblant d’aider.» J’avais justement appris à aider ou être aidée dans les cours de théâtre, mais là, plus de prévenance, ni de bienveillance, il s’agissait de ne pas s’approcher, saisir la bonne distance, sans père ni maître, seule. Dès lors, j’ai compris qu’il n’y avait rien à attendre d’un metteur en scène, je devais être grande à 20 ans. La violence d’un Pialat ou d’un Godard me disait : tu es sur ton chemin, fais de cette solitude un art. «Juste après l’épisode Kané, j’ai obtenu un petit rôle l’été 84 dans la Vie de famille de Jacques Doillon, avec Sami Frey. Doillon, c’était une référence pour les actrices de ma génération. Sur place, tout de suite je devais retirer ma robe tee-shirt dès la première scène en hurlant. J’étais cap, c’est ce qui comptait. Pas consciente du méli-mélo de répliques perverses, trop émue d’avoir été choisie face à Juliet Berto, ma mère dans le film. Rétrospectivement, certaines répliques que m’adresse Sami Frey, qui joue mon beau-père, font froid dans le dos : “Ta mère veut que je t’aime. Elle rêve que nous fassions l’amour ensemble. Alors je vais t’aimer.” Pas sûre d’avoir compris ces répliques à l’époque. J’ai pourtant gardé un bon souvenir de ce tournage. Sami Frey était très respectueux avec moi. Et d’ailleurs, quand il a vu Rendez-Vous, le film d’André Téchiné qui m’a fait connaître, il m’a drôlement engueulée : “N’accepte jamais de te laisser filmer comme ça, il ne faut pas te laisser faire.” L’avait particulièrement choqué un gros plan de mon pubis avec la tête de Lambert Wilson à côté dans l’autre sens. C’est filmé de haut, bien cadré. J’étais surprise par son indignation. Je ne voulais pas de conflit avec le réalisateur. Ma mère aussi a poussé un cri que j’ai pris pour de l’admiration, quand elle a découvert Rendez-vous à Cannes : «Comment t’as fait ?» Elle était horrifiée, je ne l’ai compris qu’après. Moi, j’étais au-delà de la joie. Le film était grandement accueilli à Cannes. «Pendant ces deux ans interminables où je me suis débattue pour survivre dans ma quête d’être actrice, il était souvent demandé de se déshabiller pour passer un casting. Je m’exécutais. Mais il y a eu une fois de trop : sous le regard de Sébastien Japrisot, auréolé du succès de l’Eté meurtrier qu’il avait écrit, nous devions jouer les mêmes scènes encore et encore en sous-vêtements et jarretelles. Je suis sortie en plein milieu de ce casting en rage, j’avais compris que le dessein poursuivi n’était pas celui du film. «Pour Rendez-vous, je n’ai pas passé d’essai. André Téchiné m’a choisie contre la volonté du producteur Alain Terzian, trois jours avant le début du tournage. André m’a demandé d’aller le voir à son bureau. J’avais investi dans une robe et un manteau Alaïa, que je portais dans les moments importants. Je me revois remonter l’avenue Messine en pleurant à l’idée de me présenter, afin, j’en avais conscience, de me vendre. Il m’a bien détaillé des pieds à la tête en insistant sur les parties qui l’intéressaient. On a parlé quelques minutes à peine et il m’a congédiée. «Il ne m’échappait pas complètement que ce besoin effréné de corps nus au cinéma dans les années 80-90 ne concernait que les jeunes femmes, rarement les hommes, sauf avec Chéreau et par la suite Téchiné. Ça ne me révoltait pas, je prenais cette exigence en patience. Il n’y avait pas un scénario sans une scène nue. A chaque fois c’était difficile. J’ai appris à sauter dedans, comme on plonge en mer froide, tête la première. Je voyais la date des scènes nues arriver avec effroi sur le plan de travail : plus qu’une semaine, plus que deux jours… L’angoisse montait comme le courage. Sur Rendez-vous, pendant l’hiver glacial 84, j’avais assimilé les exigences du tournage : froid, nudité, humilité. Et parfois humiliation. J’acceptais tout avec fougue. A chaque fois qu’on tournait une scène de sexe, le producteur Terzian s’installait devant sur le plateau avec son gros cigare à la bouche. Mais sa présence ne pouvait entamer ma ferveur, j’étais trop occupée à tourner les scènes difficiles qui m’attendaient : me faire cracher dessus, mimer une pipe et prétendre faire l’amour sur des escaliers. Il y a une scène où Nina, le personnage que j’interprète, dit à Jean-Louis Trintignant : “C’est ma chance et je ne la laisserai pas passer.” C’était tellement extraordinaire d’avoir été choisie qu’il fallait que je donne tout ce que je pouvais. Si je ne m’étais pas engagée physiquement autant, peut-être que ce rôle n’aurait pas été investi complètement. «La marchandisation de mon corps s’est reproduite» «Ces épreuves m’ont rendu plus forte : je plaquais au sol ma vulnérabilité. Mais je savais qu’il y avait des interdits : on ne touche pas aux parties intimes. Ce qui m’avait attristée à l’époque de la sortie du film de Doillon est que même avec un tout petit rôle, j’apparaissais seins nus sur l’affiche. Cette exposition me mettait très mal à l’aise. La marchandisation de mon corps s’est reproduite ensuite avec l’affiche de Rendez-vous d’André Téchiné où je suis de dos cabrée totalement dénudée. C’était la machination consensuelle d’Alain Terzian, de Bettina Rheims la photographe et du graphiste Benjamin Baltimore. Il fallait vendre, que ça marche, que ça marque. Cette séance photo avec la présence du producteur où j’étais déshabillée face à Lambert Wilson habillé me laissait démunie, désespérée au fond, sans voix. Scandale : des gens l’arrachaient sur les colonnes Morris. Et dans ma famille paternelle, cette exposition associée au nom de Binoche fâchait. André Téchiné, lui, était contre tout ce marketing, il ne voulait pas de cette affiche. «La focale, le cadre, les mouvements de caméra : tous ces mots m’étaient inconnus. Je remarquais à peine la caméra. On tournait bien sûr en pellicule, il n’y avait pas de retour vidéo à montrer aux acteurs. Ma bouée de secours, c’était la confiance. Elle le reste ! C’est elle qui permet de se donner corps et âme, de rester solidaire avec le film quoi qu’il advienne. Cette confiance a été trahie quelques années plus tard, sur le deuxième film qu’on a fait ensemble, André et moi, pour Alice et Martin. L’idée d’un plan dénudée ne me plaisait pas. André a juré qu’il l’enlèverait si je le lui demandais une fois le film monté. Il n’a pas tenu parole. Il a fallu l’intervention du producteur. Cette trahison m’a vraiment déçue, peut-être plus encore que le plan lui-même. Une première fois déjà, sur Rendez-vous, il y a eu un geste que je préférerais oublier. Une main, tandis qu’on tournait, est venue me toucher subitement le sexe. On ne m’avait pas prévenue, et encore moins demandé mon accord. J’étais stupéfiée. Mais je n’ai pas été capable de le dire. Je n’ai jamais su si cette main provenait d’une demande du metteur en scène, ou si c’était l’acteur qui avait pris cette liberté et je n’ai pas trop envie de le savoir. Focaliser ma colère sur une personne précise ? Pourquoi ? «Il m’a fallu beaucoup de temps pour comprendre que je pouvais exiger quand les scènes l’imposent, un plateau fermé. Ou remettre en question dans un scénario une scène nue que je ne trouvais pas nécessaire. J’ai pu le faire sur Bleu de Krzysztof Kieślowski. J’ai été tellement rassurée sur l’Insoutenable légèreté de l’être, quand j’ai réalisé que le producteur Saul Zaentz était absent quand on tournait les scènes nues alors qu’il était sur le plateau tous les autres jours. L’Insoutenable légèreté de l’être était mon premier film à gros budget, à l’étranger, avec une star montante, Daniel Day-Lewis. Là aussi j’ai été choisie une semaine avant le tournage et les scènes nues étaient nombreuses… Même sur ce film, le réalisateur est entré dans ma caravane pour me peloter. Je l’ai repoussé, il n’a pas insisté. Lena Olin, qui tenait l’autre rôle féminin, m’a dit qu’elle avait eu droit aux mêmes tentatives. «Au fond, tout est pardonné. Tout est transformé, tout m’a sculpté» «Toutes ces blessures provoquent une rage, une révolte. Mais aucune envie d’arrêter. Les coups bas, les gestes déplacés, les remarques sexistes : je ne les oublie pas, elles empoisonnent la vie, mais elles restent secondaires. Au fond, tout est pardonné. Tout est transformé, tout m’a sculpté. Le désir de me donner à travers le jeu reste plus fort, l’art du jeu est une forme de connaissance jubilatoire secrète, impossible à saisir, à voler. «Je n’ai pas toujours su protéger mes camarades. Avant Rendez-vous, j’avais rendu visite sur un tournage à une amie actrice de mon âge alors très en vogue. Son partenaire de jeu avait sa tête dans son entre-jambe. Elle était nue sans aucune protection. Ils filmaient sans gêne, je suis restée sans voix. Je n’ai pas su trouver les mots, elle semblait si insouciante. Je suis partie vite, défaite. Une autre fois, j’ai compris avec le recul, c’était à peine perceptible, qu’une figurante se faisait violer par un acteur dans les Enfants du siècle au cours d’une scène d’opium dans un bordel. J’ai aperçu la jeune femme partir sonnée une fois le tournage terminé, comme si elle avait reçu un coup de poing. J’avais la haine. Cet acteur est mort aujourd’hui. «Peut-être en raison de mon histoire personnelle, j’ai vécu dans une idéalisation du metteur en scène et défendu les cinéastes auteurs et indépendants. Avec une certaine soumission que j’associais à de la protection. J’avais le sentiment d’appartenir à une caste, d’approcher au plus près une forme artistique, nouvelle, vibrante. Obéir était une façon aussi de ne pas être totalement moi-même, d’être dans une dépendance qui me rassurait. Au fil du temps, cette relation est devenue plus égalitaire, circulaire. Mais j’ai dû gagner cette indépendance, par des combats, des crises, des séparations. J’ai encore du chemin à faire. Aujourd’hui je n’ai plus besoin d’être sauvée par cette image masculine du père protecteur ou de l’amant qu’il faut satisfaire. «A l’époque de Mauvais Sang, rien ne me semblait plus merveilleux que d’être filmée par Leos Carax, par l’homme que j’aimais et qui m’aimait, de faire œuvre avec lui. Et de me battre pour notre film, notre enfant. Quand Téchiné a vu le film, il a critiqué fermement la façon dont Leos m’avait filmée, l’image de la femme parfaite, icône de beauté. J’étais idéalisée. Sans doute enorgueillie par cette nouvelle image, j’ai avancé dans le cinéma avec un certain poids : le désir de perfection. Par la suite, j’ai poussé Leos à créer des personnages plus réels, qui transpirent, qui se lavent, dans les Amants du Pont-Neuf. Leos avait horreur de toutes ces scènes nues “hystériques” comme il disait. Il n’en voulait pas. C’est moi qui lui ai demandé de tourner cette scène dans les Amants où je me lave dehors nue, de loin. Scène que j’avais vue dans la rue quand j’étais en préparation. «Sauter en parachute, plonger dans la Seine à 6 degrés, s’épuiser à la mesure des personnages qu’on joue : pendant des années, ne pas faire semblant était pour moi la moindre des choses. J’adorais ces challenges physiques. Sur les Amants du Pont-Neuf, pendant ma préparation du film, j’ai accompagné une jeune femme Véronique qui vivait dans la rue, ancienne toxico. Elle faisait la manche, pendant que je dessinais. J’avais gardé le patch sur l’œil que je porte dans le film. Ça me semblait important d’éprouver la vie de mon personnage, même si à la grande différence de tous ceux que je côtoyais, j’avais une carte de crédit dans la poche arrière de mon pantalon. Deux fois, durant ces immersions qui pouvaient durer plusieurs semaines, j’ai été agressée, et une autre fois, j’ai vraiment eu peur, j’ai failli me faire violer dans un hôtel misérable à Strasbourg-Saint-Denis qui s’est révélé être un hôtel de passe. «Maintenant, c’est la vie ! Rien que la vie» «Sur les Amants du Pont-Neuf, un événement fatidique est survenu. Lestée de douze kilos autour de la taille pour pouvoir descendre cinq mètres sous l’eau, d’une perruque, d’un lourd manteau, de bottes, j’ai échappé d’un cheveu à la noyade. Denis Lavant et moi étions censés être en sécurité, sous le regard de deux plongeurs professionnels. Il était convenu qu’on fasse le mouvement de la main des plongeurs si on manquait d’oxygène. Quand je suis arrivée au fond de l’eau, je n’avais plus du tout d’air. J’ai fait le signe. En vain. J’ai été obligée de batailler de toutes mes forces en apnée, sans qu’aucun secours ne me soit apporté, pour parvenir à la surface malgré mon barda et les cinq mètres d’eau au-dessus de moi. Au moment de la remontée, qui m’a parue si longue, j’ai pris une décision : “Maintenant, c’est la vie ! Rien que la vie !” Le premier assistant me voit bouleversée en train de reprendre mon souffle difficilement : “On y retourne. — Sans moi.” Non seulement personne ne m’a présentée d’excuses ou a paru comprendre à quoi je venais de réchapper, mais quand je suis allée voir le plongeur responsable de ma vie, il m’a expliqué qu’il avait ordre d’attendre que le metteur en scène lui donne l’autorisation pour venir à mon secours. Et quand j’en ai parlé à Leos, il m’a dit ne pas s’en souvenir. Etait-ce imputable à la mauvaise organisation du premier assistant ? Etait-ce autre chose ? Je ne le saurais jamais mais ce jour-là, mes limites encore mal définies jusqu’alors sont devenues brusquement nettes. «La solidarité entre actrices n’a pas attendu ces dernières années pour se manifester. En 2003, je devais travailler avec Arnaud Desplechin. Mais lorsque j’ai découvert le scénario de Rois et Reine – il m’est apparu flagrant que certains épisodes de la vie de son ancienne compagne, l’actrice Marianne Denicourt, étaient utilisés et instrumentalisés. Il me paraissait évident qu’il fallait que je m’assure que Marianne était au courant de ce projet et pleinement en accord. Son fils n’étant pas encore majeur, les conséquences pouvaient être dramatiques. Je l’ai appelée, elle ignorait tout du film en préparation et était extrêmement blessée. Je n’ai pas eu d’autre choix que de refuser ce projet quoi qu’il m’en coûte. Comme d’ailleurs l’avait fait Emmanuelle Béart avant moi. Comme l’ont fait après d’autres actrices. «Je suis soulagée de voir et d’entendre les témoignages de femmes et d’hommes qui osent exposer les abus qu’elles et qu’ils ont subis. Ce n’est pas facile d’exposer sa vie intime, et nous devrions tous les remercier. C’était une première notable et très joyeuse qu’aux césars, les cinq actrices en lice pour la meilleure interprétation le soient pour des films signés par cinq femmes et pour des rôles étonnamment forts. «Quand on est acteur on signe un contrat d’amour avec un metteur en scène, qu’il soit homme ou femme, qu’on forme un couple ou pas, peu importe, il y a cette joie d’élever une partie de soi vers un ailleurs, vers soi-même aussi, mais unis dans un mystère, qu’on découvrira plus tard. Ne pas se méprendre : je sais très bien quels abus sont susceptibles de générer ce pacte, quelles impostures aussi. On développe une intuition de plus en plus fine du seuil à ne pas laisser franchir. J’ai dû apprendre à dire non, à reconnaître ce que je devais quitter. «Quand la jeune actrice, mutante, hésitante se donne à travers un rôle, elle se tend vers son réalisateur pour avoir son approbation. Entière, elle est à lui, à elle-même, au monde. Cette demande de la jeune actrice ne donne-t-elle pas l’illusion au cinéaste que tout est pour lui ? N’a-t-il pas perçu que cet extrême désir de l’actrice en cache un autre, qui n’est pas forcément charnel, mais invisible, intouchable, un désir d’absolu qui le dépasse et la dépasse ? Peut-être se joue un nouvel horizon, un désir de connaissance, une consécration qui échappe, par une grâce inexplicable. Il ne voit pas encore l’artiste dans l’actrice. Il croit l’actrice instrument de possession. Il ne voit pas encore une égale. Faire le chemin ensemble, unis dans l’œuvre, est long, ardu et parfois si simple. Si par bonheur on trouve ce chemin, on se dit que rien n’est plus beau.» Légende photo : Juliette Binoche à Paris, le 17 avril. (Jérôme Bonnet/Modds pour Libération)
Par Lucile Commeaux dans Libération - 26 avril 2024 La metteuse en scène Silvia Costa propose une adaptation amputée de la tragédie shakespearienne à la scénographie trop solennelle, heureusement contrebalancée par la justesse de l’interprétation. Devant le fastueux rideau de la salle Richelieu, Lady Macbeth s’arrache les cheveux, au sens propre. La couleur du tissu qui plisse derrière elle est rouge sang, comme celui qu’elle et son époux verseront, de plus en plus épais, de plus en plus coupable, le long de ces quelque deux heures d’un spectacle hybride, une hybridité pas tout à fait shakespearienne, pas tout à fait maîtrisée peut-être. Silvia Costa a tranché cruellement dans le texte comme le seigneur Macbeth dans le corps de ses ennemis. Réduite à une poignée de personnages dont certains débarquent tardivement sur scène, rendant l’intrigue dangereusement arbitraire, la fable shakespearienne semble tenir en quelques lignes, concentrée en une fatale mécanique. Macbeth victorieux au combat se voit promis à un avenir royal. Pour accélérer son destin, son ambitieuse et terrible épouse le convainc de tuer Duncan, roi d’Ecosse. Mais c’est encore trop peu pour s’assurer le pouvoir, il faut tuer l’ami, puis l’allié, peut-être même toute sa descendance. Le spectacle, très peu bavard et qui troue les scènes de longues séquences silencieuses, réduit à ces étapes principales, écartant grandes tirades et atermoiements, condamne le récit à n’être qu’une suite de crimes, sans qu’on ne saisisse bien l’évolution des personnages, l’abolition de leurs craintes ou la naissance de leur folie. Dans la grammaire de Silvia Costa, qui collabore par ailleurs aux spectacles de Romeo Castellucci, très plastique et chorégraphiée, Shakespeare se trouve réduit à une mécanique scénique certes spectaculaire mais qui prend trop de place, d’autant qu’elle manque parfois d’élégance. Le hiératisme en est la règle clé : chaque scène réglée comme un tableau, dans lequel circulent des silhouettes ecclésiastiques aux superbes capuches et aux mouvements lents, rythmés par des tambours japonisants et des cloches funestes. Tout y est rouge, noir blanc et doré, encodant un peu grossièrement les couleurs de l’intrigue. Tout surtout y est grave et solennel, contraignant ainsi la fable baroque à un gothisme froid, qui manque de bouffonnerie et de chair. La terreur, grande affaire de Macbeth, opère parfois, dans la sonorisation des voix ou de savants jeux d’ombres. Mais point de fureur dans le récit, pour cela il aurait fallu davantage de rythme, davantage d’inquiétude, or les signes de la cruauté font défaut, réduits bien souvent à des représentations figées par la culture populaire – Lady Macbeth dans sa fameuse scène finale de la tâche a quelques inflexions de sorcière Disney, ce qui confirme malheureusement l’impression de circuler doucement dans un train fantôme de luxe. C’est quand la langue reprend le dessus, dans la bouche des comédiens du Français – notamment l’excellent Noam Morgensztern qui interprète le rôle-titre – que la complexité et l’épaisseur dramatique de Macbeth surgissent enfin, et terrifient bien davantage. Macbeth d’après William Shakespeare, traduction Yves Bonnefoy, adaptation, mise en scène et scénographie Silvia Costa. Jusqu’au 20 juillet à la Comédie-Française. Légende photo : La mécanique scénique de «Macbeth» est spectaculaire. (Christophe Raynaud de Lage)
Par Christine Friedel dans Théâtre du blog - 25/04/2024 Avertissement: l’autrice elle-même exige que son nom et les titres de ses pièces soient écrits sans majuscules. Elle n’en demande pas autant aux différents créateurs du spectacle. Dont acte. On s’en rendra compte, en voyant ce spectacle: il n’a rien d’un caprice d’autrice très jouée et avec grand succès en Grande-Bretagne mais il fait partie d’une politique du théâtre, plus encore que d’un théâtre politique On a déjà pu l’observer dans mauvaise, mise en scène de Sébastien Derrey (voir Le Théâtre du Blog), même si le spectacle n’a pas eu la carrière qu’il méritait vu l’épidémie de Covid et du confinement. Sans majuscules, sans préambule, sans indulgence, debbie tucker green entre dans le vif -on a envie de dire « dans le lard»-de la société. n parallélépipède parfaitement lisse, blanc, froid, éclairé de tubes fluo fonctionnels alignés, avec une table, un tableau aussi blanc qui ne sera pas utilisé, un jeu de chaises empilables et une fontaine à eau chaude ou froide (scénographie de Mathieu Lorry-Dupuy). N’importe quelle salle d’interrogatoire, consultations, réunions d’équipe, ou rendez-vous individuels dans n’importe quelle administration. On verra se décliner toutes les précautions oratoires de Une et Deux, les employés ou fonctionnaires, ou agents, qui reçoivent Trois dans ce bureau anonyme. Ici, nous nous autorisons les majuscules pour désigner ces personnages, ou fonctions. D’un côté, Une et Deux redoublent de formules « politiquement correctes » pour mettre à l’aise Trois, et pouvoir dérouler le protocole dont ils ont la charge et qui les porte. Fonctionnement absurde, évidemment voué à l’échec. Trois résiste, Trois est en colère, une colère qu’elle ne lâchera pas de toute la pièce. Une et Deux tentent de se cramponner au dit protocole. Évidemment encore, arrive le moment où ils craquent, y compris à coups de gaffes ou lapsus. De quoi est-il question ? On nous le dira à la fin, donc nous ne vous en dirons rien ; pas question de « spoiler », ou « divulgâcher ». La pièce, construite et jouée comme une rigoureuse partition musicale fonctionne si bien… qu’elle n’a presque pas besoin de fin. Les répliques parfois s’interrompent, se chevauchent avec une habileté diabolique et on reconnaît la nécessité du dialogue multiple, dialectique et peut-être « agonique » entre les trois traducteurs.
Et ce n’est pas pour rien : cette machine bureaucratique, ces services, prétendus efficaces que l’autrice voit dans un avenir dystopique proche, nous les connaissons déjà. Rigides, en principe bien huilés, ils coincent et butent pourtant. La musique de la pièce le fait entendre et la scène le montre.
Ce qui cloche, qui ne va pas, c’est l’humain. La colère puissante de Trois contre cette chose (qu’on ne nous dit pas) qui a détruit, sa famille, son couple ; la « décision » qu’elle doit signer en quatre exemplaires à la fin, mais qu’elle avait prise dès avant son entrée dans le bureau : cette colère-là lui donne une telle force de résistance qu’elle fait craquer les protocoles. Une et Deux ont beau chercher à revenir à la charge, le réel-parce que ce « non », c’est le réel-, les fait échouer, comme leur propre fragilité sous l’armure.
Certains passages font penser à Elle est là de Nathalie Sarraute, dans la quête sinueuse et obstinée du bon argument. Et soudain la comédie pure et simple fait irruption. L’échec, le désordre de ces pauvres technocrates si fiers de leur ordre, si soucieux de ne jamais perdre le Nord et soudain déboussolés, cela fait rire : c’est inévitable. Et pas seulement comme à Guignol : c’est plus qu’une revanche contre le bâton du gendarme, face au drame de Trois toujours présent. C’est un rire à la Bergson, devant le dérèglement de la puissante machine soudain en perdition. Tout simplement le rire qui reconnaît le vrai, qui pointe et dénonce le mensonge permanent de cette organisation qui, encore une fois ressemble terriblement à celles d’un monde que nous connaissons. Lætitia Lalle Bi Benie (Trois) et Frédérique Loliée (Une) et Quentin Raymond, le bien nommé Deux, qui suit sa N+1 et lui met des bâtons dans les roues sont impeccables : ils jouent tout le texte, rien que le texte mais avec un petit quelque chose en plus, une très légère accentuation, la première dans le registre de la tragédie qu’elle tient sans faiblir, les deux autres dans la maladresse cachée de « responsables » qui porteraient un habit un peu trop grand-ou trop petit- pour eux. À voir, donc. Christine Friedel / Théâtre du blog Jusqu’au 5 mai, Théâtre de la Tempête, Cartoucherie de Vincennes, route du Champ de manœuvre. Métro: Château de Vincennes+navette T. :01 43 28 36 36.
Par Joëlle Gayot dans Le Monde - 24 avril 2024
A 84 ans, la comédienne argentine vue notamment chez Alfredo Arias, Arthur Nauzyciel ou Georges Lavaudant fait l’objet d’un documentaire de Sandrine Dumas, « Marilu. Rencontre avec une femme remarquable ». Lire l'article sur le site du "Monde" :
https://www.lemonde.fr/culture/article/2024/04/24/marilu-marini-actrice-en-mouvement-perpetuel_6229687_3246.html
Marilu Marini se maquille dans « Marilu. Rencontre avec une femme remarquable », documentaire de Sandrine Dumas. DEAN MEDIAS Chapeau large sur la tête, sourire ravageur et pommettes rosies, la comédienne Marilù Marini apparaît et avec elle surgit cette « femme remarquable » que filme si bien la réalisatrice Sandrine Dumas dans un documentaire délicat et joyeux : Marilù. Rencontre avec une femme remarquable, en salle mercredi 24 avril. De 2016 à 2022, Sandrine Dumas a suivi son héroïne de chaque côté de l’Atlantique. Un pied en France et l’autre en Argentine, là où est née l’actrice en 1940. Et où elle a vécu jusqu’en 1975, avant de prendre l’avion pour fuir, à 35 ans, la violence d’une dictature subie dans sa chair : vingt-cinq jours d’isolement pour avoir montré son nombril en public. Enfermée dans une cellule trop basse pour se tenir debout, Marilù Marini fabriquait des roses avec de la mie de pain pour, nous raconte-t-elle, « ne pas sombrer dans le désespoir ». Elle qui dansait sur les scènes de Buenos Aires atterrit à Paris pour ne plus en partir et y apprendre le français même si elle rêve en espagnol. Elle vient rejoindre la « bande des Argentins ». Une troupe d’artistes compatriotes, eux aussi émigrés, et qui, comme elle, veulent casser les codes de la représentation à grand renfort d’esthétiques tapageuses. Réunis autour du metteur en scène Alfredo Arias, les exilés du groupe TSE font effraction dans le paysage hexagonal avec sensualité, outrance et outrecuidance. Clown et tragédienne « Nous avions en partage notre jeunesse indifférente à l’ordre moral », raconte l’actrice qu’anime, depuis toujours, un désir d’émancipation. Adolescente déjà, elle avait refusé d’être « la fille de bonne famille » dont rêvaient ses parents. Echapper à la petite bourgeoisie, se sauver de la répression militaire, envoyer valser les frontières et les cadres : elle opte pour la vie d’artiste, synonyme de mouvement perpétuel et de libres envolées dans les sphères poétiques : « Ce qui me terrifie, c’est de ne pas bouger intérieurement », explique-t-elle lorsque nous la rencontrons un matin frais de printemps. Pour ne pas sombrer dans l’immobilité, Marilù Marini travaille. Le travail est « présent à chaque seconde », confie-t-elle. Depuis ses débuts, en 1968, elle a joué dans près d’une cinquantaine de spectacles dont une vingtaine avec Alfredo Arias, complice de longue date jusqu’à leur séparation professionnelle, en 2008 : « J’avais besoin d’un autre monde. » Besoin, sans doute, d’en finir pour de bon avec les créatures d’Arias, parmi lesquelles l’iconique Femme assise (le texte était de Copi), qui aura nourri la légende de l’hebdomadaire Le Nouvel Observateur avant de conquérir les plateaux de théâtre. Jacques Vincey, Yves Beaunesne, Michel Didym ou Georges Lavaudant : les metteurs en scène savent que, chez cette interprète à l’accent chantant, le clown et la tragédienne se côtoient. Ils la veulent fantasque mais ils recherchent sa gravité. Il se trouve qu’elle sait être les deux en même temps. La jeune génération ne s’y trompe pas. A Buenos Aires, en 2003, Arthur Nauzyciel l’enferme dans un mamelon. Elle devient la Winnie d’Oh les beaux jours, de Samuel Beckett. Avec Pierre Maillet, elle noue, dès 2013, une fraternité imperméable aux écarts d’âge : « J’adore sa personnalité sans chichi, ses goûts intellectuels, son indépendance vis-à-vis des modes, sa loyauté. J’ai besoin d’aimer les gens avec qui je travaille, ainsi que les personnages que j’incarne. Sans cet amour, il n’y a pas de catharsis », explique-t-elle en mordant dans sa tartine de confiture. Corps outil A 84 ans, Marilu Marini consomme le présent avec délectation, sans rien céder à un corps qui parfois la trahit. Une crise d’arthrose la surprend en pleine répétition ? Pas question d’abdiquer. Le corps est un partenaire à qui elle impose sa loi. « Quoi qu’il me dise, il est possible de faire quelque chose de lui en étant créative et courageuse. » Grimé, costumé, délié ou claudiquant, ce corps outil n’a pas échappé à la caméra de Sandrine Dumas qui le traque en France et en Argentine, des coulisses aux scènes, et jusque dans la cuisine de l’actrice où on la regarde apprivoiser les nuances entre les « on » et les « an ». « La langue française est plus symbolique que la langue espagnole. Pour la parler sur un plateau, je dois me fabriquer une colonne vertébrale où circule le souffle. » C’est là qu’au fil des années sont venus se lover les mots des auteurs : Genet, Shakespeare, Copi, Beckett, Mishima ou encore Fassbinder. « Leurs textes ouvrent vers l’inconnu. On ne les comprend que si on fait abstraction des règles. Seul compte le fait d’être juste avec soi-même. » Le théâtre, tel que le pratique Marilu Marini, est un apprentissage humble, un artisanat acharné, un don de soi « éthique », ajoute la comédienne, qui, deux heures après le rendez-vous, envoie par SMS la photo d’une fleur jaune poussée entre la rue et le trottoir : « Cette fleur, c’est la Winnie d’Oh les beaux jours. » Elle a beau être enfermée dans le bitume, rien, jamais, ne l’empêchera de se déployer. Marilu. Rencontre avec une femme remarquable, film français de Sandrine Dumas (1 h 25). Sortie le 24 avril. Festival Théâtre & Cinéma : projection suivie d’une conversation avec Sandrine Dumas, Marilu Marini et Pierre Maillet. Le 25 avril à 18 heures. Ferme du Buisson, à Noisiel (Seine-et-Marne). Joëlle Gayot Bande-annonce du film Marilù
Par Nadja Pobel dans Sceneweb - 23 avril 2024 Fidèle à la profonde nature de vaudeville qu’est Le Mandat, Patrick Pineau livre une mise en scène échevelée pour ses retrouvailles avec Erdman. Derrière les rires en cascade, la terreur des personnages face au nouvel ordre politique est abyssale. Rien ne ressemble plus à un Labiche que cette pièce de Nicolaï Erdman. Et rien ne lui ressemble moins. Le Mandat a la structure des vaudevilles, ce parfait enchainement des situations qui pousse constamment au rire avec les personnages cachés (derrière une porte, sous un tapis, dans une malle…) qui déclenchent ou achèvent des quiproquos à une folle allure. Mais Le Mandat a un propos bien plus ambitieux et raide que celui d’une comédie de mœurs entre bourgeois de la fin XIXe. 1900 a été enjambé. Cela fait sept ans que le tsar est tombé en Russie, la Nouvelle politique économique (NEP) est enclenchée et tout l’ordre social est à terre. Les possédants n’ont plus droit de cité, la propriété est interdite et le nouvel horizon est d’avoir sa carte au parti communiste, un « mandat ». Ainsi donc deux familles, l’une bourgeoise ruinée par les révolutions de 1917 et d’anciens tsaristes encore riches trouvent un arrangement : marier leurs enfants. La dot ? le frère de la future mariée qui s’engage à s’encarter au PCUS pour assurer la protection de tous dès lors qu’il aura entre les mains le fameux mandat. Jouer sur les apparences Dans l’espace réduit d’un appartement communautaire, les hystéries s’enchainent les unes aux autres tant la matriarche Nadejda Goulatchkine est inquiète. Il n’y a plus aucun repère. L’affolement est général, toute action prend des proportions immenses à commencer par ce voisin qui ne décolère pas que sa casserole de vermicelles au lait ait fini sur sa tête parce que Pavel, le fils Goulatchkine, donnait des coups de marteaux de l’autre côté du mur (fin) pour accrocher maladroitement des peintures. Tout est en place dans cette scène d’ouverture avec ce personnage qui sera le plus lucide d’entre tous déjouant tous les faux-semblants que Pavel entretient avec un tableau réversible : Marx d’un côté, des paysages de l’autre et une représentation religieuse pour combler les ecclésiastiques. Contenter tout le monde, ne froisser personne. Pas pour le plaisir gratuit de duper ses visiteurs mais pour survivre dans une URSS naissante dont ils ne connaissent pas encore tous les codes mais ont saisi violemment les changements. Ce texte de Nicolaï Erdman ne sera pas publié avant la perestroïka mais joué 350 fois en 1925 alors que son écriture n’a pas eu le temps de sécher tant Meyerhold réclame à ce jeune auteur né en 1900 de la lui livrer. Dans la salle, les spectateurs crient « Ah bas Staline ! » Le succès est total, l’arrêt brutal. Elle ne sera reprise qu’à la mort du dictateur. Mais elle existera tout de même plus que la seule autre pièce que fera Erdman, Le Suicidé, interdite avant même d’être jouée et qui vaudra à son auteur non pas la déportation comme Daniil Harms ou Mandelstam mais d’être réduit à ne plus participer qu’à des scénarii de films et mourir en 1970 sans avoir produit d’autres grandes œuvres. Sur les fiches techniques du Théâtre Meyerhold (TIM) de Moscou, figurent les réactions des spectateurs et ceux-ci riaient plus de 350 fois sur la durée du spectacle ! ; l’acteur incarnant Pavel deviendra célèbre du jour au lendemain. La pièce sera jouée dans de nombreuses autres villes russes, dans différentes mises en scène jusqu’en 1930 rappelle Jean-Philippe Jaccard, dans la première traduction française qu’il fait de ce texte et publié en 1998. Sauve qui peut La version que monte Patrick Pineau est celle d’André Markowicz qui a enrichi son propre travail avec des scènes supplémentaires. Avec sa troupe conséquente de 13 personnes (beaucoup pour aujourd’hui, nettement moins pour l’époque de Erdman), il manie au millimètre la cadence infernale de la terreur, sachant déborder dans la salle, parfois éclairée, pour établir un lien avec les musiciens – cette catégorie sociale qui ne change pas vraiment de statut en passant d’un régime à l’autre – avant que tout le monde ne soit assis ou quand le dénouement approche et que les vérités se resserrent. Le metteur en scène et surtout acteur est aussi à l’aise là qua dans des formes plus modestes, au service des mots de Serge Valletti (John a-dream) récemment sous les indications de sa complice de longue date Sylvie Orcier. Leurs enfants, comme dans Black March sont avec eux au plateau dans ce travail d’une véritable famille d’artistes bien au-delà des liens sanguins (les anciens comme Yasmine Modestine et Aline Le Berre ou les plus nouveaux comme Ahmed Hammadi-Chassin en Pavel déboussolé et pilier ou Virgil Leclaire, locataire des Goulatchkine). Avec les pantomimes autour de la vraie/fausse robe de la vraie/fausse impératrice, les balbutiements de prières autour d’un électrophone qu’écrit Erdman, les clins d’œil que rajoute Patrick Pineau via l’intervention de la régie qui lance « la lutte finale » au moment du triomphe des petits arrangements ou les amorces de pas dansés d’Anatole Smetanitch comme un aveu supplémentaire de perdition, cette adaptation du Mandat est fluide et comme pouvait l’être Un chapeau de paille d’Italie quand Georges Lavaudant dirigeait un certain… Patrick Pineau. L’acteur n’a rien perdu de cette dextérité qu’il met ici au service d’un texte infiniment sombre sous sa drôlerie. « Ils refusent de nous arrêter » dit au final Pavel. Il ne leur reste plus rien dans la vie. Erdman et Pineau font exister celles et ceux qui ont été asphyxiés par la folie du pouvoir dans une Russie « qui n’existe plus » disent-ils, à cette époque-là… Nadja Pobel – www.sceneweb.fr Le Mandat
De Nicolaï Erdman
Mise en scène : Patrick Pineau / Compagnie Pipo
Avec François Caron, Ahmed Hammadi-Chassin, Marc Jeancourt, Aline Le Berre, Nadine Moret, Sylvie Orcier, Elliot Pineau-Orcier, Yasmine Modestine, Lauren Pineau-Orcier, Jean-Philippe Levêque, Virgile Leclaire, Arthur Orcier, Patrick Pineau
Traduction : André Markowicz
Dramaturgie : Magali Rigaill
Costumes : Gwendoline Bouget
Scénographie : Sylvie Orcier
Création lumières : Christian Pinaud
Création sonore : Jean-Philippe François
Régie générale : Florent Fouque
Production déléguée : Théâtre-Sénart, Scène nationale
Production : Théâtre-Sénart, Scène nationale
Coproduction : Les Célestins, Théâtre de Lyon, Espace Des Arts — Scène nationale de Chalon-Sur-Saône, Maison de la Culture de Bourges, L’Azimut — Antony / Châtenay-Malabry, Compagnie Pipo
Durée 2h15 Au théâtre des Célestins – Lyon
Du 6 au 16 mars 2024 Au Théâtre-Sénart, Scène nationale
Du 26 au 29 mars 2024 du 2 au 4 avril 2024
L’Azimut – Antony / Châtenay-Malabry du 18 avril au 5 mai 2024
Théâtre de la Tempête – Paris https://www.la-tempete.fr/saison/2023-2024/spectacles/le-mandat-714 dates en cours
Maison de la Culture – Bourges
Espace des Arts – Châlon-sur-Saône
Par Armelle Héliot dans son blog - 22 avril 2024 A La Flèche, il donne vie à un scénario presque sans paroles qu’il a mis au point avec son ami de vingt ans, Alexandre Philip. Dans tes rêves ! est un spectacle étourdissant. Un homme seul. Seul sur le plateau de La Flèche. A proximité des spectateurs. Seul, accompagné des lumières d’Anne-Laurence Badin, et suivant la mise en scène d’Alexandre Philip, l’un des acteurs de la série Machine, actuellement diffusée sur Arte ou encore de Marianne, de Balle perdue. Alexandre Philip écrit des scénarios, réalise (Handicops). Il est un metteur en scène qui sait qu’il peut demander et rapidité et énergie à l’époustouflant Matthieu Lemeunier. Ensemble, ils ont écrit Dans tes rêves ! Une promenade dans les pensées et l’imagination délirante d’un personnage qu’incarne Matthieu Lemeunier. Sans aucun accessoire. Ou presque. Une heure durant, il est cet homme qui se bat avec ses rêves, mais qui joue toutes les figures qui s’y présentent. Animaux, humains, objets…Il les joue de tout son corps et aussi de sa voix, sans tenir en place. Une heure durant, il court, il vole, il traverse le plateau, il se plie, se déplie, se ploie, se casse, prend des airs, saute. Il mime toutes ses aventures et l’on comprend tout. Il est la bande-son du spectacle. Souffle et sifflements, borborygmes et autres gazouillis, émissions sonores dont on ne comprend pas d’où elles naissent, bruitages, soupirs, chuchotis, cris, chant montant jusqu’aux sommets lyriques, tout est convoqué. On saisit ses regards, ses mimiques : son visage, cadré par une barbe taillée de près, cheveux courts, regard ferme et tendre, est tout aussi expressif que son corps. Le « personnage » ne parle presque pas, il nous observe parfois, nous prend à témoins sans un mot. Et l’on comprend tout, bousculé que l’on est d’aventure en aventure, précipité que l’on est dans ces rêves, ces bouffées de cauchemars, ces angoisses, ces paniques. On sourit tout le temps, et l’on rit énormément. Qui résisterait à un talent aussi formidable, aussi rare ! Comment fait-il pour exécuter cette danse hallucinante, d’une précision rigoureuse, d’une fluidité fascinante, et toujours accompagnée des prouesses de sa voix, comment fait-il pour ne même pas donner le sentiment du moindre essoufflement, à la fin, aux saluts ? Avouons-le, on ne connaissait pas Matthieu Lemeunier, et pourtant, puisqu’il a travaillé avec Olivier Py, on l’a sans doute déjà vu ! Alexandre Philip, et lui, se sont connus il y a vingt ans au Conservatoire de Tours. L’un est donc plutôt du côté de l’écriture. L’autre est un athlète des plateaux qui s’était frotté aux difficiles défis des (bonnes) improvisations et est passé par l’Erac, l’école de Cannes, en 2005, travaillant tous les registres de la comédie, de l’art dramatique. On peut prendre la mesure de sa forte personnalité dans certains sketches de Groland et dans des réalisations de Samuel Bodin. La compagnie qui les accompagne à La Fièche, leur compagnie sans doute, s’intitule « Elucubrations tragi-comiques (etc) ». Tout un programme ! Il faut courir les applaudir et donner à ce moment exceptionnel la large audience qu’il mérite ! Armelle Héliot https://www.billetreduc.com/341321/evt.htm Théâtre La Flèche, 77 rue de Charonne, 75011 Paris. Chaque jeudi à 19h00, jusqu’au 6 juin 2024. Durée : 1h00. Tél : 01 40 09 70 40. info@theatrelafleche.fr
Par Marie-José Sirach dans L'Humanité - 21 avril 2024 Patrick Pineau met en scène avec brio la pièce de Nicolaï Erdman. Écrit en 1924, censuré en 1930, le Mandat est un vaudeville soviétique, une tragi-comédie féroce et salutaire. Voilà sept ans que la révolution d’Octobre a ébranlé le monde. Chez les tenants de l’ancien régime, tsaristes convaincus ou reconvertis et autres petits-bourgeois, on cherche à sauver sa peau. Le mariage entre la fille Goulatchkine et le fils Smetanitch avec, pour dot, un communiste, ferait bien les affaires des uns et des autres. Comme aucun d’eux ne connaît de communiste dans son entourage, qu’on ne va pas « en prendre un dans la rue, ça ne se fait pas », le fiston Goulatchkine est tout désigné pour devenir cet homme nouveau, ce communiste prêt à servir de dot à sa sœur. Les préparatifs du mariage vont bon train, mais, de quiproquos en malentendus, de petits mensonges en vérité arrangée, rien ne se déroule comme prévu. Vrais et faux communistes, vraie robe impériale et fausse tsarine, tout ce petit monde se croise à vive allure, parlant, piaillant, piaffant à tout bout de champ. Les portes claquent, les entrées et sorties se font au pas de charge, on se cache sous les tapis, on accroche au mur des icônes du Christ qui, si on les retourne, dévoilent un portrait de Karl Marx. Ne pas s’en tenir à la bienséance Le temps est compté. Le fameux mandat est une sorte de sauf-conduit, une carte du parti qui n’en est pas une, un bout de papier. Lorsque Pavel Goulatchkine le brandit à la barbe du voisin (prolétaire) et au nez des Smetanitch (tsaristes), il claque le bec au premier et rassure les seconds. Mais rien ne va se dérouler comme prévu. C’est tout l’art de Nicolaï Erdman de ne jamais s’en tenir aux évidences ou à la bienséance ; de se saisir de la moindre faille ou défaillance de ses personnages pour dérouler, sans temps mort ni accroc, la mécanique du rire. Nous sommes en 1924 et dans la Russie post-tsariste et encore révolutionnaire, on peut rire de (presque) tout et même avec n’importe qui. C’est dans cet interstice de l’Histoire qu’Erdman va écrire ses deux seules pièces, le Mandat en 1924, à tout juste 24 ans, et le Suicidé en 1928. Deux pièces irrévérencieuses, infiniment drôles, qui se jouent de l’absurde de situation, se moquent allègrement de la bureaucratie qui commence à gangrener la révolution. Erdman n’en écrira pas d’autres. Rattrapées par la machine stalinienne à broyer les hommes et la liberté, ses pièces seront censurées à partir des années 1930. Celui qui faisait dire à ses personnages : « Vous croyez en Dieu, jeune homme ? – À la maison oui, pas au travail » (dans le Mandat), ou encore « Camarades ! Je vous en supplie, au nom des millions de gens, accordez-nous le droit de chuchoter » (dans le Suicidé), passera sous les fourches caudines du stalinisme mais mourra, en 1970, sans jamais avoir vu ses pièces rejouées. L’esprit farcesque conservé En 2011, Patrick Pineau avait monté le Suicidé au Festival d’Avignon, à la Carrière de Boulbon. Aujourd’hui, c’est le Mandat qu’il met en scène. Avec, toujours, cette même furieuse énergie, cette joie de jouer sans cesse renouvelée. Sa mise en scène est montée sur ressorts, rien n’est laissé au hasard, entrées et sorties sont réglées au cordeau. Chaque réplique, chaque déplacement, chaque geste relance la machine, tout s’accélère. Entre la première partie, l’appartement étroit, légèrement décati des Goulatchkine, et la deuxième, qui se déroule dans celui des Smetanitch, grand, vide, sombre, l’histoire s’emballe. Il faut une grande maîtrise, connaissance et compréhension du théâtre d’Erdman pour ne pas se laisser dominer par cette mécanique et préserver l’esprit farcesque et clownesque de la pièce. C’est comme si le Mandat avait été taillé sur mesure pour Pineau. Avec Sylvie Orcier, qui joue et signe la scénographie, on retrouve des acteurs compagnons de longue date et on découvre de nouveaux venus. Chacun est en place, dans la place, à sa place. Il y a là, dans ce théâtre de saltimbanques, un esprit de troupe comme on en voit peu, un travail collectif où s’entremêlent complicité et générosité. Légende photo : Deux pièces irrévérencieuses, infiniment drôles, qui se jouent de l’absurde de situation.
©Simon Gosselin service de presse
|






 Your new post is loading...
Your new post is loading...